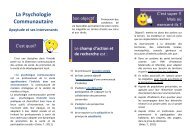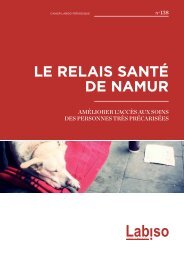Groupe de travail - Psychologie communautaire
Groupe de travail - Psychologie communautaire
Groupe de travail - Psychologie communautaire
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
plus souvent) mais également <strong>de</strong>s accueils spécialisés avec les parents et les professionnels. Elles offrent égalementformation et <strong>travail</strong> en réseau (le plus souvent avec un temps dédié <strong>de</strong> coordonnateur). Un tiers <strong>de</strong>s MDA dispose d’uneéquipe mobile.Ce lieu ne se substitue pas aux acteurs existants mais tente <strong>de</strong> redonner du sens à la trajectoire <strong>de</strong> l’adolescent et par làassure une fonction <strong>de</strong> réseau tout en garantissant un accueil non stigmatisant à <strong>de</strong>s populations potentiellement précaires.3.1.5 Mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong> ville, réseaux <strong>de</strong> soins, centres <strong>de</strong> santé, maisons <strong>de</strong> santépluridisciplinairesSelon les termes du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la santé publique : « Le système <strong>de</strong> santé garantit à tous les mala<strong>de</strong>s etusagers, à proximité <strong>de</strong> leur lieu <strong>de</strong> vie ou <strong>de</strong> <strong>travail</strong>, dans la continuité, l’accès à <strong>de</strong>s soins <strong>de</strong> premierrecours ». Le mé<strong>de</strong>cin généraliste en est l’acteur pivot, et se trouve le plus souvent choisi commemé<strong>de</strong>cin traitant. En effet les soins primaires peuvent contribuer à réduire les inégalités <strong>de</strong> santé 34On compte près <strong>de</strong> 55 000 mé<strong>de</strong>cins généralistes en France (métropole et outre-mer) ; 94 % d’entreeux sont en secteur 1 et ne pratiquent donc pas <strong>de</strong> dépassements. De fait, on compte en moyenne unemoindre <strong>de</strong>nsité <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins généralistes <strong>de</strong> secteur 1, contre celle <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins tous secteurs (66ETP pour 100 000 habitants contre 71 ETP pour 100 000 habitants). Cependant cette différence estnettement plus marquée dans les grands pôles urbains où le dépassement d’honoraires est unepratique potentiellement plus fréquente (source : DREES à paraître).Selon l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’IRDES en 2008, un quart <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins refusent <strong>de</strong>s patients parce qu'ils sontbénéficiaires <strong>de</strong> la CMU. Mais ces refus <strong>de</strong> soins sont le fait <strong>de</strong> moins <strong>de</strong> 10 % <strong>de</strong>s omnipraticiens <strong>de</strong>secteur 1. Il reste que la parution du décret d’application <strong>de</strong> l’article 54 <strong>de</strong> la loi HPST pourrait permettreaux CPAM <strong>de</strong> sanctionner les mé<strong>de</strong>cins et professionnels <strong>de</strong> santé refusant les soins.Ainsi la proportion <strong>de</strong> bénéficiaires <strong>de</strong> la CMU complémentaire (CMUC) dans la clientèle <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cinsgénéralistes, spécialistes ou <strong>de</strong>ntistes, varie fortement d’un praticien à l’autre. En <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> larépartition <strong>de</strong>s bénéficiaires <strong>de</strong> la CMUC sur le territoire, cette variabilité s’explique en partie par lanature <strong>de</strong>s besoins <strong>de</strong> soins <strong>de</strong> cette population. L’environnement socio-économique <strong>de</strong>s communesd’exercice <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins joue également. On constate une « spécialisation » relative <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong>scommunes les plus défavorisées, celles-ci attirant les bénéficiaires CMUC <strong>de</strong>s communes avoisinantesplus riches.Les mé<strong>de</strong>cins généralistes constituent l’une <strong>de</strong>s chevilles ouvrières <strong>de</strong>s réseaux <strong>de</strong> santé. Ceux-cibien qu’émergeant <strong>de</strong> logiques <strong>de</strong> création diverses (VIH/SIDA, maladies chroniques...) apportent uneréelle plus-value dans la prise en charge <strong>de</strong>s patients en situation <strong>de</strong> précarité. L’articulation qu’ilsoffrent aux patients accueillis permet <strong>de</strong> sécuriser leur parcours, en particulier pour <strong>de</strong>s publics qui sontloin <strong>de</strong>s soins, et peu enclins à s’inscrire dans une continuité. Ils permettent une prise en chargeglobale <strong>de</strong>s personnes en situation <strong>de</strong> précarité. Le réseau remet en cause une organisation <strong>de</strong> l’offre<strong>de</strong> soins trop segmentée pour adopter une structuration horizontale <strong>de</strong> l’offre <strong>de</strong> soins par pathologie oupar population l’articulation avec l’ensemble du système <strong>de</strong> soins incluant la mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> ville, lesecteur médico-social et la psychiatrie doit être développée. Les réseaux sont aussi divers dans leurforme que dans leur composition, leur aire d’activité... Ils ne sont pas dénombrables.Le développement <strong>de</strong>s réseaux <strong>de</strong> santé a d’ailleurs constitué un axe important <strong>de</strong> la politique <strong>de</strong> santépublique (cf. article 84 <strong>de</strong> la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002). Les réseaux permettent unetransversalité d’action en mêlant sanitaire et social d’une part, en favorisant le partenariat et lacohérence d’action <strong>de</strong>s différents acteurs <strong>de</strong> la santé d’autre part. Cependant les réductions34QES n°179, septembre 2012.23