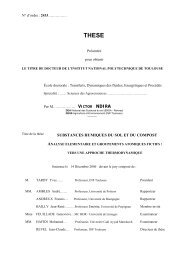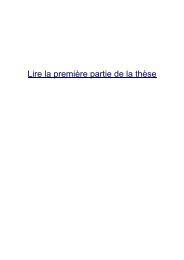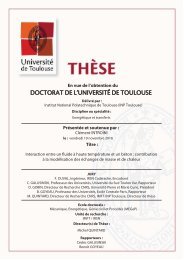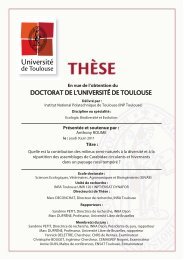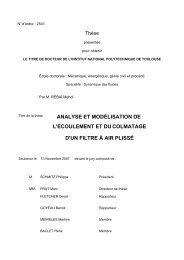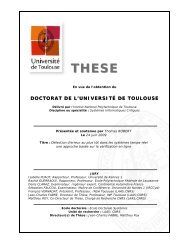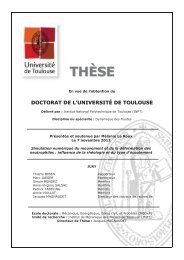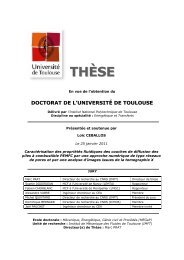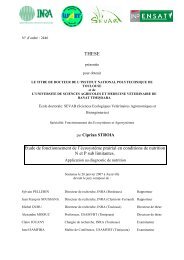- Page 1 and 2: THÈSEprésentéepour obtenirLE TIT
- Page 3 and 4: Table des matièresIntroduction 1I
- Page 5 and 6: local 1419.1 Introduction . . . . .
- Page 7 and 8: IntroductionLe refroidissement d’
- Page 9: Première partieEtude Phénoménolo
- Page 13 and 14: CHAPITRE 1Ce phénomène qui est ap
- Page 15 and 16: Chapitre 2Description du phénomèn
- Page 17 and 18: CHAPITRE 2Notre travail portera ess
- Page 19 and 20: CHAPITRE 2FIG. 2.5 - Courbe d’éb
- Page 21 and 22: CHAPITRE 22Flux (MW/m )grande sous
- Page 23 and 24: CHAPITRE 2Flux de condensationPSfra
- Page 25 and 26: CHAPITRE 2Comme l’état est stati
- Page 27 and 28: CHAPITRE 2augmentation du flux éva
- Page 29 and 30: Chapitre 3Modélisation du phénom
- Page 31 and 32: γ tot£ γCHAPITRE 32 jd h(3.2)Vav
- Page 33 and 34: ∆PCHAPITRE 3puisque dans cette ap
- Page 35 and 36: CHAPITRE 3P 2l[Ul]2U lP1l[Ul] 1Liqu
- Page 37 and 38: CHAPITRE 33.3 Modélisation du flux
- Page 39 and 40: CHAPITRE 3Nom de l’expérience V
- Page 41 and 42: CHAPITRE 3inertielle de la densité
- Page 43 and 44: A@ @? B ε£ 0©085.CCHAPITRE 3Disc
- Page 45 and 46: CHAPITRE 3R crit ( mm) τ (ms) K’
- Page 47 and 48: CHAPITRE 3des deux approches préc
- Page 49 and 50: CHAPITRE 3FIG. 3.5 - Courbes d’é
- Page 51 and 52: CHAPITRE 33.5.2 Etudes transitoires
- Page 53 and 54: CHAPITRE 3TAB. 3.8 - Les flux de pl
- Page 55 and 56: CHAPITRE 3talement est aussi bien r
- Page 57 and 58: CHAPITRE 3TAB. 3.11 - R crit¢k 1 ,
- Page 59 and 60: CHAPITRE 3Les flux de plateau obser
- Page 61 and 62:
CHAPITRE 3FIG. 3.17 - Courbe d’é
- Page 63 and 64:
CHAPITRE 3TAB. 3.14 - Les flux de p
- Page 65 and 66:
CHAPITRE 3FIG. 3.21 - Comparaison d
- Page 67 and 68:
CHAPITRE 3γ tot&ρ l¤A£ )σg(3.6
- Page 69 and 70:
Chapitre 4Modélisation du phénom
- Page 71 and 72:
CHAPITRE 4Expérience T wA V n V j
- Page 73 and 74:
TCHAPITRE 4La dépendance de δ l
- Page 75 and 76:
FπαCHAPITRE 4bulle de vapeur ne s
- Page 77 and 78:
CHAPITRE 4Expérience T wB (4C) T i
- Page 79 and 80:
:δCHAPITRE 4résolvons donc l’é
- Page 81 and 82:
CHAPITRE 4Expérience τ δ l T wB
- Page 83 and 84:
CHAPITRE 4Pour T wA§ T wB , T wA p
- Page 85 and 86:
CHAPITRE 4qui représentent le flux
- Page 87 and 88:
CHAPITRE 4Flux (MW/m )2PSfrag repla
- Page 89 and 90:
FπαCHAPITRE 4l’équation (4.16)
- Page 91 and 92:
Chapitre 5Approche phénoménologiq
- Page 93 and 94:
CHAPITRE 5donc également une trans
- Page 95 and 96:
CHAPITRE 5Nom de l’expérience q
- Page 97 and 98:
CHAPITRE 5Expérience 5T MFBKT sat7
- Page 99 and 100:
93Expérience Flux (MW/m 2 ) Flux E
- Page 101 and 102:
CHAPITRE 5140012001000∆T sub=5 o
- Page 103 and 104:
CHAPITRE 5MFBK ∆T sub V j 5T T sa
- Page 105 and 106:
dCHAPITRE 5Ochi et al. [119]Les flu
- Page 107 and 108:
CHAPITRE 5800700V j=2,12 m/sV j=3,0
- Page 109 and 110:
CHAPITRE 5MFBK V j ∆T sub d h 5T
- Page 111 and 112:
CHAPITRE 5FIG. 5.8 - q MFB calculé
- Page 113 and 114:
CHAPITRE 5La relation (5.19) relèv
- Page 115 and 116:
Chapitre 6Conclusion de l’étudep
- Page 117 and 118:
CHAPITRE 6vers l’ébullition en f
- Page 119 and 120:
CHAPITRE 6M>k énergie cinétique t
- Page 121:
Deuxième partieEtude Numérique115
- Page 124 and 125:
CHAPITRE 7En mécanique polyphasiqu
- Page 126 and 127:
CHAPITRE 88.2 Equations de bilan au
- Page 128 and 129:
uuuχσCHAPITRE 8Avec ces notations
- Page 130 and 131:
\BilanI01=i I02=i InCHAPITRE 8avec
- Page 132 and 133:
ρCHAPITRE 8en évitant d’avoir l
- Page 134 and 135:
\Bilan α u uCHAPITRE 8est représe
- Page 136 and 137:
ΓαααΠ0k ΓCHAPITRE 8q k et q t
- Page 138 and 139:
CHAPITRE 8La résolution éventuell
- Page 140 and 141:
CHAPITRE 8Pour un modèle eau/vapeu
- Page 142 and 143:
LSiFπaCHAPITRE 8où k l (W/m/K) es
- Page 144 and 145:
LaL’airerlerrLaStCHAPITRE 8densit
- Page 146 and 147:
140CHAPITRE 8
- Page 148 and 149:
CHAPITRE 9b) Nous devons détermine
- Page 150 and 151:
|Approche|Inversion.VCHAPITRE 9Eule
- Page 152 and 153:
CHAPITRE 9et d’énergie pour chaq
- Page 154 and 155:
FπaCHAPITRE 9qui est essentielleme
- Page 156 and 157:
La.VVB @? A@CHAPITRE 9avec V l la c
- Page 158 and 159:
f£4StCHAPITRE 9fréquence des osci
- Page 160 and 161:
CHAPITRE 9Utilisation des tables CA
- Page 162 and 163:
£ACHAPITRE 99.3.5 Implantation de
- Page 164 and 165:
CHAPITRE 9maillage beaucoup moins f
- Page 166 and 167:
CHAPITRE 9et ∆T 16 o C) et infér
- Page 168 and 169:
162CHAPITRE 9
- Page 170 and 171:
CHAPITRE 1010.2.1 Données de la si
- Page 172 and 173:
CHAPITRE 104000.8300impact3 mm0.6im
- Page 174 and 175:
CHAPITRE 1018e+6impact3 mmimpact3 m
- Page 176 and 177:
1©013CHAPITRE 10D’après la figu
- Page 178 and 179:
CHAPITRE 105e+064e+06Φ (W/m 2 )3e+
- Page 180 and 181:
CHAPITRE 1045 Pour T T sat 100 o C,
- Page 182 and 183:
CHAPITRE 105e+064e+06Simulations- i
- Page 184 and 185:
CHAPITRE 10∆T sub =15 o C, V n =3
- Page 186 and 187:
CHAPITRE 10le cas de la simulation
- Page 188 and 189:
CHAPITRE 108e+06V n =1 m/sV n =3,17
- Page 190 and 191:
CHAPITRE 10rant, deux vitesses diff
- Page 192 and 193:
CHAPITRE 11dû implanter un modèle
- Page 194 and 195:
CHAPITRE 11u>yPr nombre de PrandtlP
- Page 196 and 197:
CHAPITRE 11Fin finalefrag de fragme
- Page 198 and 199:
CONCLUSION ET PERSPECTIVESlume liqu
- Page 200 and 201:
UnLLesLCONCLUSION ET PERSPECTIVESNo
- Page 202 and 203:
BIBLIOGRAPHIE[13] J. BOREE, G. CHAR
- Page 204 and 205:
BIBLIOGRAPHIE[47] N. HATTA, J. KOKA
- Page 206 and 207:
BIBLIOGRAPHIE[80] , Heat Transfer i
- Page 208 and 209:
BIBLIOGRAPHIE[109] M. MONDE AND Y.
- Page 210 and 211:
BIBLIOGRAPHIE[142] L. SCHILLER AND
- Page 212 and 213:
BIBLIOGRAPHIE[172] D.C. WADSWORTH A
- Page 214 and 215:
IIANNEXE A
- Page 216 and 217:
ANNEXE AFIG. A.1 - Distributions de
- Page 218 and 219:
ANNEXE Asurface sont observables si
- Page 220 and 221:
h&TANNEXE AFlux critiqueRégime d
- Page 222 and 223:
ANNEXE Adépendance peut s’écrir
- Page 224 and 225:
ANNEXE A†‰‰…„ƒmm-- - -
- Page 226 and 227:
ANNEXE ACette équation est caract
- Page 228 and 229:
ANNEXE Apartielle. L’établisseme
- Page 230 and 231:
’“’“’••-••“--
- Page 232 and 233:
ANNEXE Atempérature en paroi reste
- Page 234 and 235:
˜˜˜˜šš “˜˜˜˜šANNEXE AA
- Page 236 and 237:
0=5£ANNEXE Aempiriques suivantes o
- Page 238 and 239:
ANNEXE Ad’eau sous-saturée. Les
- Page 240 and 241:
Ÿž¡¥ Ÿ{˜˜žAuteurs Type de j
- Page 242 and 243:
ANNEXE AAinsi, dans la zone d’éc
- Page 244 and 245:
ANNEXE Aaugmente, l’importance de
- Page 246 and 247:
¥¥ ¥¥¥¨¥§¨§ª ªª ª¦©
- Page 248 and 249:
ANNEXE ACette approche a été vali
- Page 250 and 251:
ANNEXE Aoù δ c décroît avec l
- Page 252 and 253:
6©10¦ANNEXE A[101] et Monde et al
- Page 254 and 255:
ANNEXE Ajets circulaires à surface
- Page 256 and 257:
ANNEXE Avers le centre du jet. Pour
- Page 258 and 259:
ANNEXE Avase et sous un jet impacta
- Page 260 and 261:
ANNEXE Asaturée (figures A.16 et A
- Page 262 and 263:
ANNEXE AFIG. A.15 - Variation du fl
- Page 264 and 265:
ANNEXE AAuteurs Type de jet ∆T su
- Page 266 and 267:
ANNEXE ACORRÉLATIONS EN ÉBULLITIO
- Page 268 and 269:
ANNEXE AFIG. A.18 - Schéma du disp
- Page 270 and 271:
ANNEXE Asurface est peu épaisse. E
- Page 272 and 273:
ANNEXE APar contre, le flux corresp
- Page 274 and 275:
ANNEXE A% inférieurs aux flux extr
- Page 276 and 277:
ANNEXE Asion dans le cas de l’éb
- Page 278 and 279:
ANNEXE AMinimum de l’ébullition
- Page 280 and 281:
ANNEXE AT min£ 326 17©6 ∆T 0=8s
- Page 282 and 283:
ANNEXE AÂÂAuteurs Ishigai et al.
- Page 284 and 285:
½½ANNEXE APSfrag replacementsfilm
- Page 286 and 287:
&T min¤ T min=BerP £}&T0©42ANNEX
- Page 288 and 289:
ANNEXE AAuteurs Type de jet ∆T su
- Page 290 and 291:
ANNEXE ACORRÉLATIONS EN ÉBULLITIO
- Page 292 and 293:
ANNEXE A†††††Ï× ÑÓÖ
- Page 294:
ANNEXE ANomenclature de l’annexe
- Page 297 and 298:
η£ aAnnexe BInstabilités interfa
- Page 299 and 300:
i% "$# !ii% "'# !iii% "'# !U0iv% ¤
- Page 301 and 302:
σgCρ1ρ3D *ANNEXE BFIG. B.2 - Ond
- Page 303 and 304:
Annexe CAutre approche : instabilit
- Page 305 and 306:
∆P&tR4πRANNEXE CAfin d’analyse
- Page 307 and 308:
ANNEXE CC.0.8Comparaison avec la se
- Page 309 and 310:
Annexe DRésultats des comparaisons
- Page 311 and 312:
àXCIXExpérience Vader Wolf Zumbru
- Page 313 and 314:
ANNEXE DExpérience Vader (A.12) Mc
- Page 315 and 316:
ANNEXE DExpérience Monde Copeland
- Page 317 and 318:
ANNEXE DExpérience Katto et Ishiga
- Page 319 and 320:
ANNEXE DExpérience Robidou (A.58)
- Page 321 and 322:
ANNEXE DExpérience Hatta et Osakab
- Page 323 and 324:
Annexe EEtudes expérimentales réa
- Page 325 and 326:
ANNEXE EFIG. E.2 - Montage expérim
- Page 327 and 328:
ANNEXE EFIG. E.4 - Jet impactantFIG
- Page 329 and 330:
ANNEXE Ek (W/m.C) ρ, 10 3 (kg/m 3
- Page 331 and 332:
ANNEXE Epoint par point la courbe d
- Page 333 and 334:
ANNEXE EFIG. E.8 - Schéma de princ
- Page 335 and 336:
ANNEXE ED’après la figure E.10,
- Page 337 and 338:
ANNEXE Elui permet de sauvegarder c
- Page 339 and 340:
Annexe FDifférents modèles de tur
- Page 341 and 342:
ANNEXE FF.0.19Modèle k-ε avec cor
- Page 343 and 344:
ANNEXE FLe terme restant est diffic
- Page 345 and 346:
φAnnexe GEquation de Transport d
- Page 347 and 348:
LFragmentationANNEXE GDn 2φ nucnDt
- Page 349 and 350:
CongrèsInternational‚3‚‚PUBL
- Page 351 and 352:
Congrès français de Thermique, SF
- Page 353 and 354:
Congrès français de Thermique, SF
- Page 355 and 356:
Congrès français de Thermique, SF
- Page 357 and 358:
SNA 2003, Palais des Congrès, 22-2
- Page 359 and 360:
SNA 2003, Palais des Congrès, 22-2
- Page 361 and 362:
SNA 2003, Palais des Congrès, 22-2
- Page 363 and 364:
SNA 2003, Palais des Congrès, 22-2
- Page 365 and 366:
SNA 2003, Palais des Congrès, 22-2
- Page 367 and 368:
SNA 2003, Palais des Congrès, 22-2
- Page 369 and 370:
SNA 2003, Palais des Congrès, 22-2
- Page 371 and 372:
second part, this modelling is impl
- Page 373 and 374:
q sh exp. relative deviation,MW/m 2
- Page 375 and 376:
Cp specific heat, J/kgKD bubbles di
- Page 377 and 378:
fer in longitudinal direction. The
- Page 379 and 380:
touches the hot plate, is evaporate
- Page 381 and 382:
We evaluate the liquid thickness δ
- Page 383 and 384:
shoulder could be related to a tran
- Page 385 and 386:
5,04,5Critical Heat FluxShoulder of
- Page 387 and 388:
Table 1 : Experimental conditions a
- Page 389 and 390:
Fig. 8 : Sketch of the energy store
- Page 391 and 392:
4,54,03,5Heat flux (MW/m 2 )3,02,52
- Page 393:
Titre : Modélisation et Simulation