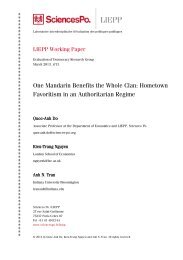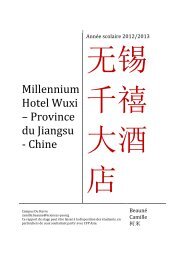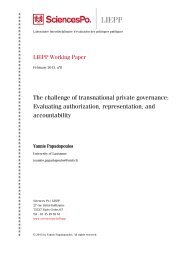Iran: vers un espace public confessionnel? - Sciences Po
Iran: vers un espace public confessionnel? - Sciences Po
Iran: vers un espace public confessionnel? - Sciences Po
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
et réciproquement ; et tel diplômé sera visité par son beau-père déf<strong>un</strong>t, entouré d’<strong>un</strong>groupe de hauts dignitaires religieux de toutes confessions rendant hommage à sa qualitéde dévot et à sa pureté. Le récitatif des rêves est <strong>un</strong> fait social à part entière : il meten scène l’<strong>Iran</strong> moderne avec ses dirigeants actuels — et non ceux du temps de Médine— avec ses routes, ses avions, ses usines et ses nouveaux lieux de pèlerinage, telle tombeau de l’Imam au sud de Téhéran, et également avec ses contradictions et sa di<strong>vers</strong>ité.A tra<strong>vers</strong> leur activité onirique, les acteurs sociaux tissent la trame de l’avenir :déjà le hejâb, dont on sait combien il a servi l’homogénéisation socio-culturelle du pays,avait souvent été revêtu par les femmes islamiques à la suite d’<strong>un</strong> songe au cours duquelFatemeh en personne les habillait.Conclusion<strong>Po</strong>ur peu que l’on tienne compte de ces phénomènes religieux, l’<strong>Iran</strong> contemporain estbeaucoup moins désenchanté et contrôlé qu’on ne le suppose parfois et que ne pourraitle suggérer l’ampleur des processus de rationalisation, de bureaucratisation, de marchandisation.Il apparaît comme <strong>un</strong>e société très “ post-moderne ” où les rapports, éventuellementmais non forcément conflictuels, entre le savant, le politique et le populaire sontlargement gérés sur <strong>un</strong> mode individuel et volontiers imaginaire.Néanmoins, insistons <strong>un</strong>e dernière fois sur le rôle des pratiques religieuses dans la formationd’<strong>un</strong> <strong>espace</strong> <strong>public</strong> qui est, de ce fait, <strong>confessionnel</strong>. Le paradoxe n’est qu’apparentcar on sait depuis Tocqueville que l’idée d’<strong>espace</strong> <strong>public</strong> relève de l’imaginaire, étantentendu que l’imaginaire est indissociable de son rapport à la matérialité 12 . De ce fait, l’<strong>espace</strong><strong>public</strong> relève de l’ordre de la croyance, et pourquoi pas de la croyance religieuse.On retrouve en <strong>Iran</strong> plusieurs des processus religieux dont les historiens ont montré qu’ilscontribuaient à la formation de la cité. Selon Peter Brown, les évêques chrétiens d’Europeoccidentale, au V ème siècle, “ fondaient (...) des cités dans les cimetières ” : “ [ils] finirentpar orchestrer le culte des saints de façon à asseoir leur propre pouvoir à l’intérieurdes vieilles cités romaines sur ces nouvelles villes hors de la ville. La résidence de l’évêqueet sa basilique principale se trouvaient toujours dans les murs. Néanmoins, c’était par desrelations soigneusement articulées avec les grands sanctuaires situés à quelque distancede la cité — Saint-Pierre sur la colline du Vatican, à l’extérieur de Rome, Saint-Martin<strong>un</strong> peu à l’écart de Tours — que les évêques des anciennes cités de l’Empire romainassurèrent leur supériorité dans l’Europe du haut Moyen Âge ” 13 . L’analogie est évidenteavec le complexe de Marqad-e emêm/Behesht-e Zahra, géré respectivement par la familleKhomeyni pour ce qui est du mausolée de l’Imam et par la m<strong>un</strong>icipalité de Téhéranpour ce qui est du grand cimetière. Depuis que l’Imam s’y est rendu a la descente de l’avion12 Jean-François Bayart, L'illusion identitaire, Paris, Fayard, 1996, p. 142.13 Peter Brown, Le culte des saints. Son essor et sa fonction dans la chrétienté latine, Paris, Cerf, 1996, p.20.Les Etudes du CERI - n ° 27 - juin 1997 28