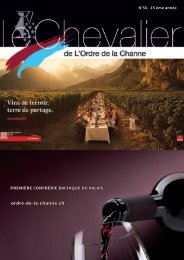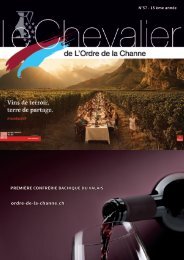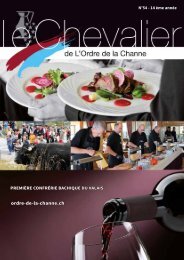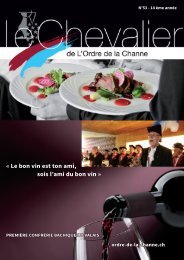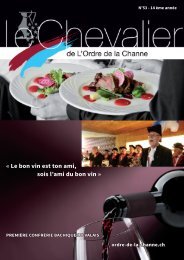Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Au milieu du XVIIe siècle, les vignes se trouvent<br />
donc entre les mains d’un spécialiste. Cela<br />
indique de la part des chanoines, une volonté<br />
de profiter au mieux de leurs vastes vignobles.<br />
Un livre de raison tenu dans le dernier quart du<br />
XVIIe siècle entrouvre une fenêtre sur la ruche<br />
abbatiale. On y voit plusieurs personnages<br />
travailler dans les vignes, participer aux vendanges<br />
et oeuvrer à la cave. Certains ne font<br />
que passer, d’autres sont là régulièrement. Par<br />
exemple, Humbert Munier travaille dans les<br />
vignes en octobre 1678. En 1679, il vendange<br />
5 jours à Saint-Maurice et 3 jours à Martigny.<br />
Faire le vin et le<br />
conserver<br />
Il semblerait logique que la chaîne d’opérations<br />
tendue entre l’extraction du jus des grappes<br />
et le soin du vin soit concentrée à l’Abbaye,<br />
à proximité des consommateurs. Cela ne se<br />
vérifie que partiellement. Un inventaire dressé<br />
en1646 décrit dans le monastère un local<br />
appelé «le pressoir». On y trouve «le pressoir<br />
fait par l’abbé Odet» ainsi que «quatre grandes<br />
et belles tines pour réduire la vendange, l’une<br />
d’elle est toutefois moindre que les autres». La<br />
cure de Notre-Dame de Sous-le-Bourg possède<br />
une de ces cuves, une autre appartient à<br />
l’aumônier du monastère et les deux dernières<br />
à son chantre. L’inventaire mentionne aussi des<br />
ustensiles de vendange dans la cave abbatiale:<br />
«cinq gerles pour la vendange, tant grandes<br />
que petites, dont trois sont en mélèze et deux<br />
en sapin», quatre brantes «propres à porter<br />
vendanges» et deux entonnoirs.<br />
Cuver et presser sur<br />
place<br />
<strong>Le</strong>s chanoines préfèrent cependant adopter,<br />
pour organiser le temps et les déplacements,<br />
une logique différente, assez courante dans<br />
le Valais médiéval. Comme les ‘vignobles les<br />
plus importants se trouvent à quelque distance<br />
du monastère, dans les collines qui séparent<br />
Saint-Maurice et Bex, on y construit des installations<br />
de cuvage et de pressage, que les textes<br />
signalent depuis le XIIIe siècle en ces lieux. L’un<br />
de ces édifices élevé dans le vignoble de Cries,<br />
ressort assez bien des textes modernes. L’inventaire<br />
abbatiale de 1646 y recense «quatre<br />
grandes tines ou cuves, dont l’une est d’environ<br />
17 ou 18 chars, l’autre de 12, l’autre de 8,<br />
l’autre de 5 ou de 6», et un «grand pressoir»<br />
installé par Martin Duplâtre, abbé de 1527 à<br />
1587. <strong>Le</strong> bâtiment abrite aussi huit brantes et<br />
six «grandes et moyennes».<strong>Le</strong>s brantes servent<br />
à transporter le raisin de la vigne vers un lieu<br />
de collecte où on les vide dans les gerles. Une<br />
fois pleines, celles-ci seront vidées dans des<br />
récipients montés sur des chars qui conduiront<br />
la vendange vers les cuves et le pressoir.<br />
Une cave de 50’000<br />
litres en 1646<br />
<strong>Le</strong>s vins tirés des vignes du monastère et des<br />
redevances foncières s’élèvent et reposent<br />
dans la vaste cave de l’Abbaye. En 1646, un<br />
inventaire recense 29 tonneaux dénommés<br />
«bosses» et «22 tonneaux de charge». <strong>Le</strong>ur<br />
capacité est donnée parfois en setiers, mais le<br />
plus souvent en «charrets de vin», sans doute<br />
des tonneaux construits pour être installés<br />
sur un char. <strong>Le</strong>ur contenance est grossièrement<br />
mesurable: cet inventaire signale trois<br />
pièces de tonnellerie «faites à façon de demichar<br />
contenant chacune 8 setiers», le tonneau<br />
de charge contiendrait donc 16 setiers,<br />
soit quelque 550 litres. Cette cave peut donc<br />
accueillir quelque 28’000 litres dans ses tonneaux<br />
ordinaires, plus14’000 litres environ<br />
dans les «22 tonneaux de charge», soit en tout<br />
42’000 litres; les adjonctions représentent au<br />
minimum 5’800 litres, ce qui amène la capacité<br />
de la cave à environ 50’000 litres.<br />
Extraits de textes provenant de «Histoire de la<br />
Vigne et du Vin du Valais» publiés avec l’aimable<br />
autorisation de Mme Anne-Dominique<br />
Zufferey, directrice du Musée Valaisan de la<br />
Vigne et du Vin)<br />
7