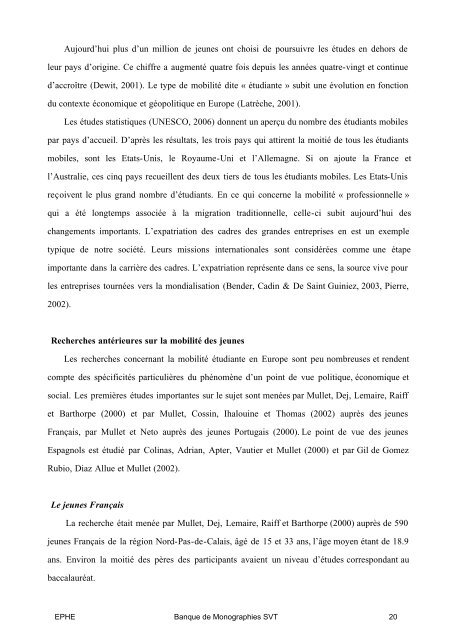Tsveta MLADENOVA - EPHE
Tsveta MLADENOVA - EPHE
Tsveta MLADENOVA - EPHE
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Aujourd’hui plus d’un million de jeunes ont choisi de poursuivre les études en dehors de<br />
leur pays d’origine. Ce chiffre a augmenté quatre fois depuis les années quatre-vingt et continue<br />
d’accroître (Dewit, 2001). Le type de mobilité dite « étudiante » subit une évolution en fonction<br />
du contexte économique et géopolitique en Europe (Latrèche, 2001).<br />
Les études statistiques (UNESCO, 2006) donnent un aperçu du nombre des étudiants mobiles<br />
par pays d’accueil. D’après les résultats, les trois pays qui attirent la moitié de tous les étudiants<br />
mobiles, sont les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne. Si on ajoute la France et<br />
l’Australie, ces cinq pays recueillent des deux tiers de tous les étudiants mobiles. Les Etats-Unis<br />
reçoivent le plus grand nombre d’étudiants. En ce qui concerne la mobilité « professionnelle »<br />
qui a été longtemps associée à la migration traditionnelle, celle-ci subit aujourd’hui des<br />
changements importants. L’expatriation des cadres des grandes entreprises en est un exemple<br />
typique de notre société. Leurs missions internationales sont considérées comme une étape<br />
importante dans la carrière des cadres. L’expatriation représente dans ce sens, la source vive pour<br />
les entreprises tournées vers la mondialisation (Bender, Cadin & De Saint Guiniez, 2003, Pierre,<br />
2002).<br />
Recherches antérieures sur la mobilité des jeunes<br />
Les recherches concernant la mobilité étudiante en Europe sont peu nombreuses et rendent<br />
compte des spécificités particulières du phénomène d’un point de vue politique, économique et<br />
social. Les premières études importantes sur le sujet sont menées par Mullet, Dej, Lemaire, Raiff<br />
et Barthorpe (2000) et par Mullet, Cossin, Ihalouine et Thomas (2002) auprès des jeunes<br />
Français, par Mullet et Neto auprès des jeunes Portugais (2000). Le point de vue des jeunes<br />
Espagnols est étudié par Colinas, Adrian, Apter, Vautier et Mullet (2000) et par Gil de Gomez<br />
Rubio, Diaz Allue et Mullet (2002).<br />
Le jeunes Français<br />
La recherche était menée par Mullet, Dej, Lemaire, Raiff et Barthorpe (2000) auprès de 590<br />
jeunes Français de la région Nord-Pas-de-Calais, âgé de 15 et 33 ans, l’âge moyen étant de 18.9<br />
ans. Environ la moitié des pères des participants avaient un niveau d’études correspondant au<br />
baccalauréat.<br />
<strong>EPHE</strong> Banque de Monographies SVT 20