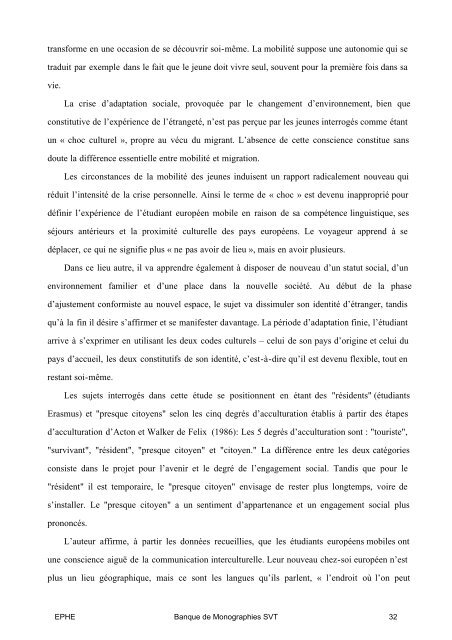Tsveta MLADENOVA - EPHE
Tsveta MLADENOVA - EPHE
Tsveta MLADENOVA - EPHE
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
transforme en une occasion de se découvrir soi-même. La mobilité suppose une autonomie qui se<br />
traduit par exemple dans le fait que le jeune doit vivre seul, souvent pour la première fois dans sa<br />
vie.<br />
La crise d’adaptation sociale, provoquée par le changement d’environnement, bien que<br />
constitutive de l’expérience de l’étrangeté, n’est pas perçue par les jeunes interrogés comme étant<br />
un « choc culturel », propre au vécu du migrant. L’absence de cette conscience constitue sans<br />
doute la différence essentielle entre mobilité et migration.<br />
Les circonstances de la mobilité des jeunes induisent un rapport radicalement nouveau qui<br />
réduit l’intensité de la crise personnelle. Ainsi le terme de « choc » est devenu inapproprié pour<br />
définir l’expérience de l’étudiant européen mobile en raison de sa compétence linguistique, ses<br />
séjours antérieurs et la proximité culturelle des pays européens. Le voyageur apprend à se<br />
déplacer, ce qui ne signifie plus « ne pas avoir de lieu », mais en avoir plusieurs.<br />
Dans ce lieu autre, il va apprendre également à disposer de nouveau d’un statut social, d’un<br />
environnement familier et d’une place dans la nouvelle société. Au début de la phase<br />
d’ajustement conformiste au nouvel espace, le sujet va dissimuler son identité d’étranger, tandis<br />
qu’à la fin il désire s’affirmer et se manifester davantage. La période d’adaptation finie, l’étudiant<br />
arrive à s’exprimer en utilisant les deux codes culturels – celui de son pays d’origine et celui du<br />
pays d’accueil, les deux constitutifs de son identité, c’est-à-dire qu’il est devenu flexible, tout en<br />
restant soi-même.<br />
Les sujets interrogés dans cette étude se positionnent en étant des "résidents" (étudiants<br />
Erasmus) et "presque citoyens" selon les cinq degrés d’acculturation établis à partir des étapes<br />
d’acculturation d’Acton et Walker de Felix (1986): Les 5 degrés d’acculturation sont : "touriste",<br />
"survivant", "résident", "presque citoyen" et "citoyen." La différence entre les deux catégories<br />
consiste dans le projet pour l’avenir et le degré de l’engagement social. Tandis que pour le<br />
"résident" il est temporaire, le "presque citoyen" envisage de rester plus longtemps, voire de<br />
s’installer. Le "presque citoyen" a un sentiment d’appartenance et un engagement social plus<br />
prononcés.<br />
L’auteur affirme, à partir les données recueillies, que les étudiants européens mobiles ont<br />
une conscience aiguë de la communication interculturelle. Leur nouveau chez-soi européen n’est<br />
plus un lieu géographique, mais ce sont les langues qu’ils parlent, « l’endroit où l’on peut<br />
<strong>EPHE</strong> Banque de Monographies SVT 32