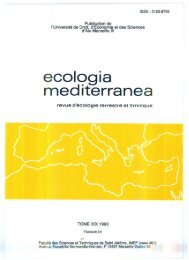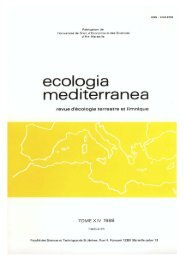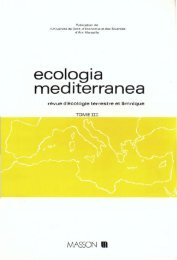Vol. 35 – 2009 - Ecologia Mediterranea - Université d'Avignon et des ...
Vol. 35 – 2009 - Ecologia Mediterranea - Université d'Avignon et des ...
Vol. 35 – 2009 - Ecologia Mediterranea - Université d'Avignon et des ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
l’exception de la survie <strong>des</strong> semences dans le sol. Cependant,<br />
les analyses de la régression <strong>et</strong> de la rar<strong>et</strong>é soulignent<br />
toutes les deux le rôle important du P/O <strong>–</strong> traceur <strong>des</strong><br />
échanges génétiques via le pollen <strong>–</strong> pour la rar<strong>et</strong>é <strong>et</strong> la<br />
régression <strong>des</strong> espèces messicoles.<br />
En conclusion, les espèces à forte mortalité séminale dans<br />
le sol <strong>et</strong> à P/O faible sont les plus menacées de disparition<br />
locale <strong>et</strong> devront être ciblées prioritairement pour la conservation.<br />
L’écologie de la germination <strong>et</strong> de la survie de<br />
graines dans le sol indique que la variabilité temporelle<br />
mésologique <strong>et</strong> <strong>des</strong> années défavorables peuvent augmenter<br />
la diversité <strong>des</strong> messicoles au travers de l’eff<strong>et</strong> de stockage.<br />
Néanmoins, <strong>des</strong> différences fortes existent entre<br />
espèces. Pour les espèces les plus menacées un maintien<br />
de l’utilisation de semences fermières non triées semble<br />
nécessaire pour leur maintien à long terme dans les agroécosystèmes.<br />
Alice SCHAFFHAUSER <strong>2009</strong><br />
Impacts de la récurrence <strong>des</strong> incendies<br />
sur la végétation, son inflammabilité<br />
<strong>et</strong> sa combustibilité.<br />
Application en Provence cristalline<br />
(massif <strong>des</strong> Maures, Var, France)<br />
224 p. + annexes, 295 p.<br />
Thèse d'université soutenue le 15 juin <strong>2009</strong> à l'université<br />
Paul Cézanne (Aix-Marseille), site de Saint-Jérôme (Institut<br />
méditerranéen d'écologie <strong>et</strong> de paléoécologie <strong>–</strong> IMEP, CNRS<br />
UMR 6116, 13397 Marseille cedex 20, France ; Institut de<br />
recherche pour l’ingénierie de l’agriculture <strong>et</strong> de l’environnement,<br />
CEMAGREF, UR Écosystèmes méditerranéens <strong>et</strong><br />
risques, 3275, route de Cézanne, CS 40061, 13182 Aix-en-<br />
Provence cedex 5, France).<br />
Jury <strong>–</strong> Alexandre BUTTLER (EPFL) <strong>et</strong> Roger PRODON (EPHE), rapporteurs.<br />
Christelle HÉLY-ALLEAUME, présidant le jury (CEREGE) <strong>et</strong><br />
Jean-Luc DUPUY (INRA), examinateurs. Thierry TATONI (IMEP) <strong>et</strong> Thomas<br />
CURT (CEMAGREF), codirecteurs.<br />
Mots clés : récurrence <strong>des</strong> incendies, végétation, structure,<br />
inflammabilité, combustibilité, résilience, fond floristique<br />
commun, suberaie (Quercus suber L.), maquis méditerranéen.<br />
La question centrale de la thèse est l’impact de la récurrence<br />
<strong>des</strong> feux sur la végétation, son inflammabilité <strong>et</strong><br />
sa combustibilité à travers l’analyse de la boucle de rétroaction<br />
entre feu <strong>et</strong> végétation, dont la compréhension est<br />
essentielle pour la gestion durable <strong>des</strong> écosystèmes méditerranéens.<br />
C<strong>et</strong>te thèse croise donc les apports de deux spécialités<br />
que sont l’écologie végétale <strong>et</strong> la physique du feu.<br />
Si les eff<strong>et</strong>s <strong>des</strong> feux à court <strong>et</strong> moyen terme sont assez bien<br />
connus, principalement au niveau floristique <strong>et</strong> plus sou-<br />
ecologia mediterranea <strong>–</strong> <strong>Vol</strong>. <strong>35</strong> <strong>–</strong> <strong>2009</strong><br />
Résumés de thèses<br />
vent sur sol calcaire que sur sol acide, les eff<strong>et</strong>s de la récurrence<br />
<strong>des</strong> feux sont beaucoup moins étudiés en raison <strong>des</strong><br />
difficultés d’accessibilité aux données historiques <strong>des</strong> feux<br />
sur une période <strong>et</strong> une aire d’étude déterminées. La<br />
démarche particulière visant à mesurer <strong>et</strong> à prédire, à partir<br />
d’une formation végétale observée à l’instant t, ce que<br />
pourront être l’ignition, la propagation <strong>des</strong> feux <strong>et</strong> les faciès<br />
de végétation futurs en fonction de différents contextes, est<br />
nécessaire dans un contexte de changement climatique avec<br />
une probable synergie <strong>des</strong> feux <strong>et</strong> de la sécheresse sur la<br />
végétation.<br />
La thèse repose sur deux parties principales : les impacts<br />
<strong>des</strong> incendies sur la végétation puis les impacts de c<strong>et</strong>te<br />
végétation sur les feux futurs. Sont ainsi étudiés les impacts<br />
de la récurrence <strong>des</strong> incendies sur la végétation, l’inflammabilité<br />
<strong>des</strong> litières <strong>et</strong> la combustibilité <strong>des</strong> peuplements,<br />
sur un intervalle d’une cinquantaine d’années sur substrat<br />
siliceux en région méditerranéenne française (massif <strong>des</strong><br />
Maures, Var). Une mosaïque de formations végétales a été<br />
décrite en réponse à une mosaïque de feux. Cinq modalités<br />
de récurrence ont été définies, de zéro à quatre feux<br />
avec <strong>des</strong> intervalles de temps différents entre ces feux.<br />
Les analyses floristiques réalisées sur 102 plac<strong>et</strong>tes ont<br />
confirmé le concept d’auto-succession selon lequel la végétation<br />
méditerranéenne adaptée au feu depuis au moins<br />
l’Holocène peut se reproduire quasiment à l’identique au<br />
niveau spécifique après perturbation. Cela a notamment été<br />
démontré par l’existence d’un fond floristique commun qui<br />
peut être utile aux caractérisations <strong>des</strong> suberaies (formations<br />
à Quercus suber L.) <strong>et</strong> maquis sur le pourtour méditerranéen.<br />
Toutefois, certains traits de vie <strong>des</strong> plantes sont<br />
négativement affectés par la récurrence <strong>des</strong> feux, telles que<br />
la stratégie compétitive <strong>et</strong> la zoochorie. La baisse générale<br />
de richesse, de diversité <strong>et</strong> d’équitabilité spécifique <strong>et</strong> fonctionnelle<br />
de certains sites nous perm<strong>et</strong> d’introduire une<br />
notion de résilience partielle : la résilience par rapport à un<br />
stade initial de maquis arboré est maintenue, tout au moins<br />
au niveau floristique, grâce à <strong>des</strong> stratégies de régénération<br />
de plantes bien adaptées au feu (« seeders » ou grainiers <strong>et</strong><br />
« resprouters » ou rej<strong>et</strong>eurs), excepté les maquis bas pour<br />
lesquels l’état initial de structure n’est pas reconstitué, ainsi<br />
que les richesse <strong>et</strong> diversité. L’étude structurale montre une<br />
évolution différenciée <strong>des</strong> formations végétales selon la<br />
récurrence <strong>des</strong> feux par un gradient de développement du<br />
sous-étage. Si les maquis bas perm<strong>et</strong>tent l’installation <strong>des</strong><br />
herbacées rudérales immédiatement après le feu, les<br />
maquis matures représentent ensuite <strong>des</strong> sta<strong>des</strong> de ralentissement<br />
au sein de l’équilibre dynamique (<strong>et</strong> non véritablement<br />
de « dégradation » végétale). Généralement observés<br />
après un feu intense datant de 1990, les maquis hauts<br />
sont caractérisés par une accumulation forte de végétaux<br />
plus ou moins sénescents dominés par une espèce particulièrement<br />
structurante <strong>et</strong> longévive, la bruyère arborescente<br />
(Erica arborea L.), qui limite la luminosité pour le sousbois<br />
<strong>et</strong> l’espace pour l’ensemble <strong>des</strong> espèces, entraînant<br />
une diminution de la diversité fonctionnelle, <strong>et</strong> un ralentissement<br />
dans la dynamique. D’autre part, certaines<br />
variables structurales perm<strong>et</strong>tent de souligner <strong>des</strong> diversités<br />
fortes dans d’autres formations que les suberaies sub-<br />
103