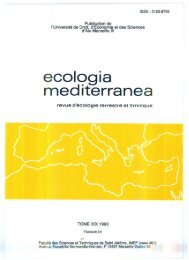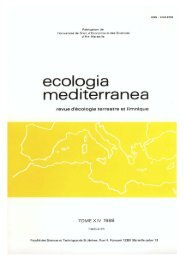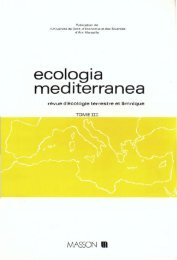Vol. 35 – 2009 - Ecologia Mediterranea - Université d'Avignon et des ...
Vol. 35 – 2009 - Ecologia Mediterranea - Université d'Avignon et des ...
Vol. 35 – 2009 - Ecologia Mediterranea - Université d'Avignon et des ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
cinement est adapté pour valoriser les faibles<br />
réserves hydriques du sol (Neffati <strong>et</strong> al. 1993).<br />
Les conditions climatiques sévères peuvent<br />
avoir une certaine influence sur la dynamique<br />
de la végétation steppique. Pour Rodin <strong>et</strong> al.<br />
(1970) cités par Aidoud (1983), l’espèce<br />
Lygeum spartum peut dépérir presque entièrement<br />
si la sécheresse de l’été continue<br />
durant l’automne <strong>et</strong> une partie de l’hiver.<br />
L’amplification de la sécheresse estivale qui<br />
est passé de 5 à 10 mois (voir Sites <strong>et</strong><br />
métho<strong>des</strong>, 3. Bioclimatologie) a contribué à<br />
une aridification saisonnière du climat qui, au<br />
moins pour les zones de l’ouest algérien, a pu<br />
influer sur une restructuration du matériel biologique<br />
de c<strong>et</strong> écosystème steppique en modifiant<br />
les processus de concurrence interspécifique<br />
<strong>et</strong> en favorisant, comme c’est le cas<br />
aujourd’hui dans les vieux peuplements, la<br />
constitution de formations steppiques mélangées.<br />
Les travaux antérieurs dont ceux de<br />
Hirche (1987) <strong>et</strong> Melzi (1995) ont mis l’accent<br />
sur ce phénomène. Plus récemment<br />
Hirche <strong>et</strong> al. (2007) dans leurs travaux sur<br />
quelques stations ari<strong>des</strong> du centre <strong>et</strong> de l’ouest<br />
de l’Algérie (Djelfa, Saida, Mechria <strong>et</strong> El<br />
Bayadh) montrent l’existence d’une tendance<br />
à la sécheresse sur les trente dernières années<br />
en particulier aux décennies allant de 1980 à<br />
fin 2000. Selon ces mêmes auteurs l’assèchement<br />
augmente à mesure que l’on se dirige<br />
vers l’Afrique du Nord occidentale.<br />
Actions anthropiques<br />
Le tableau 7 montre une n<strong>et</strong>te régression qui<br />
semble être liée au facteur anthropique.<br />
L’homme exerce en eff<strong>et</strong> continuellement son<br />
action sur ces hautes plaines en particulier à<br />
Hassi Mellah par l’intermédiaire du pastoralisme<br />
<strong>et</strong> de l’agriculture. L’action du troupeau<br />
sur les parcours modifie considérablement la<br />
composition floristique. Les animaux choisissent<br />
les espèces <strong>et</strong> par conséquent imposent<br />
à la biomasse consommable offerte une action<br />
sélective importante. Il s’agit là de l’appétence<br />
<strong>des</strong> espèces qui représente le degré de<br />
préférence qu’accorde le bétail aux différentes<br />
espèces (Bouazza <strong>et</strong> Benabadji 1998). Achour<br />
<strong>et</strong> al. (1983) confirmaient que les faciès à<br />
sparte constituaient cependant <strong>des</strong> parcours<br />
d’assez bonne qualité en général. Leurs intérêts<br />
proviennent de leur diversité floristique<br />
<strong>et</strong> de leur productivité relativement élevée<br />
(100 kg MS/ha/an en moyenne).<br />
ecologia mediterranea <strong>–</strong> <strong>Vol</strong>. <strong>35</strong> <strong>–</strong> <strong>2009</strong><br />
La régression <strong>des</strong> steppes méditerranéennes : le cas d’un faciès à Lygeum spartum L. d’Oranie (Algérie)<br />
Ces pâturages permanents <strong>et</strong> incontrôlés du<br />
parcours entraînent donc la diminution d’espèces<br />
appétentes qui sont remplacées par<br />
d’autres espèces rudérales peu appétentes,<br />
délaissées en général par le bétail (Grime<br />
1977 ; Ferchichi <strong>et</strong> Abdelkebir 2003 ; Kadi<br />
Hanifi 2003 ; Fikri Benbrahim <strong>et</strong> al. 2004).<br />
La diminution de ce couvert végétal semble<br />
trouver son explication par un prélèvement de<br />
végétaux dépassant largement leur capacité de<br />
reproduction (Aidoud-Lounis 1997). À travers<br />
un suivi dans le temps <strong>et</strong> dans l’espace<br />
de la steppe à Stipa tenacissima située dans le<br />
sud oranais sous climat aride, Aidoud <strong>et</strong> Touff<strong>et</strong><br />
(1996) montrent que la régression du couvert<br />
alfatier est due essentiellement au surpâturage.<br />
Selon Aidoud <strong>et</strong> Aidoud-Lounis<br />
(1991), la dégradation du tapis végétal s’accompagne<br />
globalement d’une baisse de la biomasse,<br />
de la productivité <strong>et</strong> de la richesse floristique.<br />
Lorsque la pression pastorale augmente, l’espèce<br />
de meilleure valeur fourragère, donc la<br />
plus exploitée, est remplacée par d’autres<br />
d’intérêt moindre. Ceci se traduit dans notre<br />
cas par la diminution de fréquence de Lygeum<br />
spartum <strong>et</strong> d’Artemisia herba-alba, <strong>et</strong> la disparition<br />
de Stipa tenacissima qui est bien<br />
signalée dans les travaux de Bouazza <strong>et</strong> al.<br />
(2004). En revanche, les espèces épineuses<br />
Noaea mucronata <strong>et</strong> Atractylis serratuloi<strong>des</strong>,<br />
caractéristiques de la dégradation <strong>et</strong> qui occupent<br />
les anciens faciès à Lygeum spartum<br />
selon Kadi Hanifi (2003), voient leur fréquence<br />
augmenter. L’apparition de Peganum<br />
harmala (espèce toxique se développant<br />
lorsque le taux de nitrates dans le sol est<br />
important <strong>et</strong> se localisant surtout au niveau<br />
<strong>des</strong> stationnements d’animaux, Aimé 1988)<br />
est un indice de surpâturage affectant le secteur.<br />
Les sta<strong>des</strong> finaux de dégradation révèlent<br />
ainsi une augmentation de la pauvr<strong>et</strong>é floristique<br />
<strong>et</strong> une dégradation <strong>des</strong> parcours. Ce<br />
qui est fort inquiétant, c’est la <strong>des</strong>truction<br />
quasi totale <strong>des</strong> ressources biologiques dans<br />
beaucoup d’endroits, <strong>et</strong> on se trouve parfois<br />
en présence d’un faciès sol nu, caillouteux <strong>et</strong><br />
érodé. À Hassi Mellah <strong>et</strong> plus au sud dans la<br />
steppe (Méchria, El Aricha <strong>et</strong> Abdelmoula…)<br />
le couvert végétal <strong>et</strong> le sol ont été largement<br />
affectés. La sédentarisation <strong>des</strong> populations<br />
conduit à la surcharge pastorale sur <strong>des</strong> surfaces<br />
parfois de plus en plus réduites <strong>et</strong> provoque<br />
une dégradation accélérée du milieu<br />
naturel, notamment par compactage <strong>des</strong> sols,<br />
ce qui réduit la capacité d’infiltration d’eau <strong>et</strong><br />
85