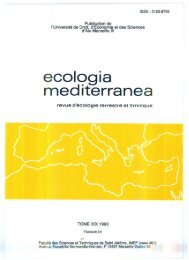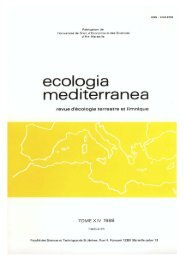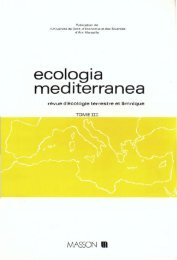Vol. 35 – 2009 - Ecologia Mediterranea - Université d'Avignon et des ...
Vol. 35 – 2009 - Ecologia Mediterranea - Université d'Avignon et des ...
Vol. 35 – 2009 - Ecologia Mediterranea - Université d'Avignon et des ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Résumés de thèses<br />
matures non brûlées depuis au moins cinquante ans. À partir<br />
d’un même stade initial dans <strong>des</strong> conditions stationnelles<br />
comparables, la récurrence <strong>des</strong> feux conduit ainsi à différencier<br />
la végétation.<br />
Les expérimentations d’inflammabilité réalisées sur <strong>des</strong><br />
litières non perturbées <strong>et</strong> les simulations de comportement<br />
de feu réalisées avec le modèle FireTec ont permis d’apporter<br />
<strong>des</strong> résultats complémentaires. Si l’inflammabilité<br />
dépend de la biomasse de végétation combustible, elle<br />
dépend aussi de la composition <strong>et</strong> de la structure (<strong>et</strong> donc<br />
l’aération) <strong>des</strong> litières. Les protocoles d’étude perm<strong>et</strong>tant<br />
de conserver la litière constituent en cela une avancée significative.<br />
La <strong>des</strong>cription fine de la structure de la végétation<br />
sur pied est aussi importante en tant que variable d’entrée<br />
au modèle de comportement de feu choisi. Ainsi, les<br />
maquis moyens à forte biomasse présentent <strong>des</strong> inflammabilités<br />
fortes <strong>et</strong> <strong>des</strong> combustibilités moyennes à fortes,<br />
<strong>et</strong> les maquis hauts représentent les sta<strong>des</strong> à plus haut<br />
risque d’inflammabilité, à forte capacité de propagation<br />
verticale <strong>et</strong> à forte combustibilité. En outre, si certaines<br />
chênaies denses peuvent entraîner <strong>des</strong> niveaux élevés d’inflammabilité,<br />
elles ne perm<strong>et</strong>tent pas le plus souvent la propagation<br />
<strong>des</strong> feux. Les chênaies sur maquis induisent <strong>des</strong><br />
comportements variables en fonction de l’importance donnée<br />
aux strates haute <strong>et</strong> basse, <strong>et</strong> ainsi de la vitesse du vent<br />
influant sur la propagation <strong>et</strong> la nature <strong>des</strong> feux (notamment<br />
le passage en cime). Les maquis bas sont enfin les<br />
sta<strong>des</strong> au risque d’incendie le plus faible, principalement<br />
en raison de leur faible biomasse au sol <strong>et</strong> sur pied. La théorie<br />
de sélection de l’inflammabilité selon laquelle les feux<br />
favorisent c<strong>et</strong>te caractéristique est infirmée lorsque le<br />
régime est fort : soit ici trois à quatre feux en cinquante ans,<br />
constituant un seuil de reconstitution pour les formations<br />
observées.<br />
En conclusion, c<strong>et</strong>te thèse a contribué à démontrer que la<br />
récurrence <strong>des</strong> feux affecte de façon croissante la flore, la<br />
structure de la végétation <strong>et</strong> subséquemment le comportement<br />
<strong>des</strong> feux futurs. Les variables de feu influençant le<br />
plus ces composantes sont le temps depuis le dernier feu<br />
puis le nombre de feux. Cependant, les relations feu-végétation<br />
restent complexes. À partir d’un stade initial similaire,<br />
la végétation reste globalement résiliente mais sa<br />
maturation peut diverger en termes de risque d’incendie qui<br />
reste principalement temps-dépendant, le temps depuis le<br />
dernier feu conditionnant l’accumulation de matière végétale<br />
vivante <strong>et</strong> morte. Le travail abordé sur la dynamique<br />
végétale devra être poursuivi afin de prédire à plus ou<br />
moins long terme les évolutions de la végétation en fonction<br />
<strong>des</strong> régimes de feux dans un probable contexte de<br />
changement climatique <strong>et</strong> <strong>des</strong> perturbations.<br />
104<br />
Frédéric TRIBOIT <strong>2009</strong><br />
Les métaux dans les bassins<br />
autoroutiers du sud-est de la France.<br />
Potentialités de dépollution <strong>des</strong> eaux<br />
<strong>et</strong> <strong>des</strong> sédiments par les plantes<br />
217 p., 58 fig.<br />
Thèse d'université (contrat CIFRE ANRT/ASF n o 0083/05) soutenue<br />
le 29 juin <strong>2009</strong> à l'université de Provence, Centre<br />
Saint-Charles (Laboratoire biomarqueurs <strong>et</strong> bioindicateurs<br />
environnementaux, UMR CNRS IRD 6116 IMEP, Institut méditerranéen<br />
d’écologie <strong>et</strong> de paléoécologie, 3, place Victor<br />
Hugo, 13331 Marseille cedex 03, France).<br />
Jury <strong>–</strong> P r Gérard BLAKE (université de Savoie, Chambéry), président<br />
<strong>et</strong> rapporteur. Ingeborg SOULIÉ-MÄRSCHE (C.R. <strong>–</strong> université de Montpellier<br />
2), rapporteur. Pascale PRUDENT (MCF <strong>–</strong> université de Provence,<br />
Marseille) <strong>et</strong> P r Thierry TATONI (université Paul Cézanne,<br />
Marseille), examinateurs. P r Alain THIERY (université de Provence,<br />
Marseille), directeur de thèse. Isabelle LAFFONT-SCHWOB (MCF <strong>–</strong> université<br />
de Provence, Marseille), codirectrice de thèse <strong>et</strong> Marc DES-<br />
PREAUX (expert eau-air-risques pollution Société autoroutes du sud<br />
de la France), invité.<br />
Mots clés : bassins autoroutiers, cadmium, charophytes, cuivre,<br />
eau, hélophytes, plomb, polluants inorganiques, rhizosphère,<br />
sédiments, zinc.<br />
L a Société autoroutes du sud de la France (ASF), concessionnaire<br />
d’un réseau de plus de 2 600 km d’autoroutes<br />
à péage, intègre depuis les années 1980 la protection de la<br />
ressource en eau dans les équipements liés à l’assainissement<br />
routier. C<strong>et</strong>te société a construit près de 1 640 bassins<br />
<strong>et</strong> fossés de protection, <strong>des</strong>tinés à capter les polluants<br />
laissés par les véhicules <strong>et</strong>, qui, charriés par la pluie, pourraient<br />
polluer nappes phréatiques, rivières <strong>et</strong> ruisseaux. Ces<br />
ouvrages techniques sont nombreux à être, à plus ou moins<br />
long terme, colonisés spontanément par une flore de zones<br />
humi<strong>des</strong>. L’entr<strong>et</strong>ien <strong>et</strong> l’exploitation habituels <strong>des</strong> chaussées,<br />
<strong>des</strong> dépendances de ce réseau routier génèrent <strong>des</strong><br />
déch<strong>et</strong>s, notamment les boues de curage <strong>des</strong> bassins, qu’il<br />
convient de valoriser avec précaution selon leur degré de<br />
nocivité (JO, 2001). Les plantes, grâce à leurs capacités<br />
naturelles à stabiliser, accumuler <strong>et</strong> métaboliser divers polluants,<br />
peuvent contribuer à traiter les effluents de ruissellement<br />
de chaussées <strong>et</strong> valoriser les sous-produits de<br />
l’assainissement. La société ASF s’interroge sur les potentialités<br />
de phytoremédiation par ces espèces végétales pour<br />
les appliquer au contrôle de la pollution <strong>des</strong> eaux <strong>et</strong> sédiments<br />
<strong>des</strong> bassins d’autoroute. Afin d’apporter <strong>des</strong> éléments<br />
de réponse, l’objectif de mon suj<strong>et</strong> de recherche est<br />
donc d’évaluer les potentialités de phytoremédiation <strong>des</strong><br />
effluents routiers <strong>et</strong> <strong>des</strong> sédiments par les plantes colonisant<br />
spontanément les bassins d’eau pluviale. Avant d’atteindre<br />
c<strong>et</strong> objectif, il est apparu indispensable de caractériser<br />
précisément les facteurs abiotiques qui structurent le<br />
ecologia mediterranea <strong>–</strong> <strong>Vol</strong>. <strong>35</strong> <strong>–</strong> <strong>2009</strong>