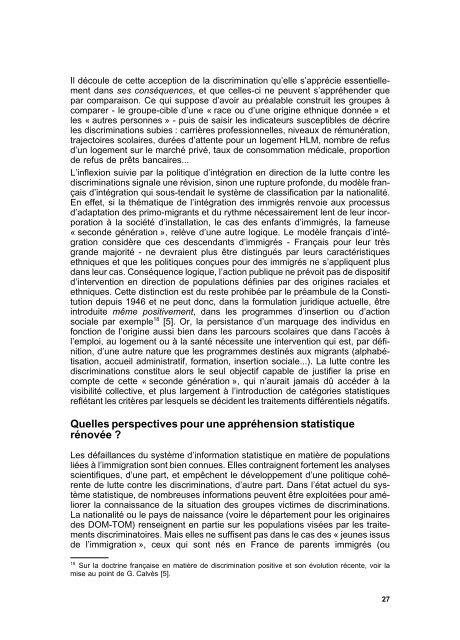Sida, immigration et inégalités : nouvelles réalités ... - ANRS
Sida, immigration et inégalités : nouvelles réalités ... - ANRS
Sida, immigration et inégalités : nouvelles réalités ... - ANRS
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Il découle de c<strong>et</strong>te acception de la discrimination qu’elle s’apprécie essentiellement<br />
dans ses conséquences, <strong>et</strong> que celles-ci ne peuvent s’appréhender que<br />
par comparaison. Ce qui suppose d’avoir au préalable construit les groupes à<br />
comparer - le groupe-cible d’une « race ou d’une origine <strong>et</strong>hnique donnée » <strong>et</strong><br />
les « autres personnes » - puis de saisir les indicateurs susceptibles de décrire<br />
les discriminations subies : carrières professionnelles, niveaux de rémunération,<br />
trajectoires scolaires, durées d’attente pour un logement HLM, nombre de refus<br />
d’un logement sur le marché privé, taux de consommation médicale, proportion<br />
de refus de prêts bancaires...<br />
L’inflexion suivie par la politique d’intégration en direction de la lutte contre les<br />
discriminations signale une révision, sinon une rupture profonde, du modèle français<br />
d’intégration qui sous-tendait le système de classification par la nationalité.<br />
En eff<strong>et</strong>, si la thématique de l’intégration des immigrés renvoie aux processus<br />
d’adaptation des primo-migrants <strong>et</strong> du rythme nécessairement lent de leur incorporation<br />
à la société d’installation, le cas des enfants d’immigrés, la fameuse<br />
« seconde génération », relève d’une autre logique. Le modèle français d’intégration<br />
considère que ces descendants d’immigrés - Français pour leur très<br />
grande majorité - ne devraient plus être distingués par leurs caractéristiques<br />
<strong>et</strong>hniques <strong>et</strong> que les politiques conçues pour des immigrés nes’appliquent plus<br />
dans leur cas. Conséquence logique, l’action publique ne prévoit pas de dispositif<br />
d’intervention en direction de populations définies par des origines raciales <strong>et</strong><br />
<strong>et</strong>hniques. C<strong>et</strong>te distinction est du reste prohibée par le préambule de la Constitution<br />
depuis 1946 <strong>et</strong> ne peut donc, dans la formulation juridique actuelle, être<br />
introduite même positivement, dans les programmes d’insertion ou d’action<br />
sociale par exemple 18 [5]. Or, la persistance d’un marquage des individus en<br />
fonction de l’origine aussi bien dans les parcours scolaires que dans l’accès à<br />
l’emploi, au logement ou à la santé nécessite une intervention qui est, par définition,<br />
d’une autre nature que les programmes destinés aux migrants (alphabétisation,<br />
accueil administratif, formation, insertion sociale...). La lutte contre les<br />
discriminations constitue alors le seul objectif capable de justifier la prise en<br />
compte de c<strong>et</strong>te « seconde génération », qui n’aurait jamais dû accéder à la<br />
visibilité collective, <strong>et</strong> plus largement à l’introduction de catégories statistiques<br />
reflétant les critères par lesquels se décident les traitements différentiels négatifs.<br />
Quelles perspectives pour une appréhension statistique<br />
rénovée?<br />
Les défaillances du système d’information statistique en matière de populations<br />
liées à l’<strong>immigration</strong> sont bien connues. Elles contraignent fortement les analyses<br />
scientifiques, d’une part, <strong>et</strong> empêchent le développement d’une politique cohérente<br />
de lutte contre les discriminations, d’autre part. Dans l’état actuel du système<br />
statistique, de nombreuses informations peuvent être exploitées pour améliorer<br />
la connaissance de la situation des groupes victimes de discriminations.<br />
La nationalité ou le pays de naissance (voire le département pour les originaires<br />
des DOM-TOM) renseignent en partie sur les populations visées par les traitements<br />
discriminatoires. Mais elles ne suffisent pas dans le cas des « jeunes issus<br />
de l’<strong>immigration</strong> », ceux qui sont nés en France de parents immigrés (ou<br />
18 Sur la doctrine française en matière de discrimination positive <strong>et</strong> son évolution récente, voir la<br />
mise au point de G. Calvès [5].<br />
27