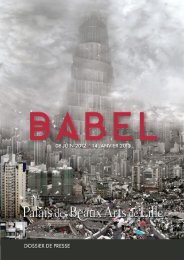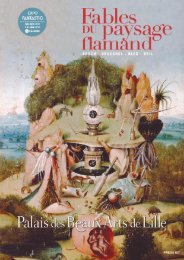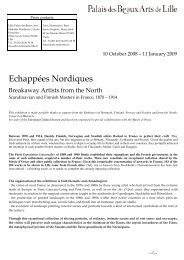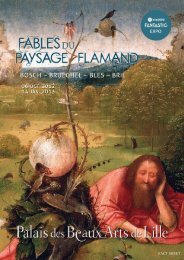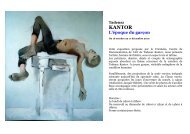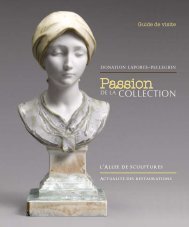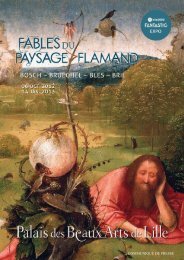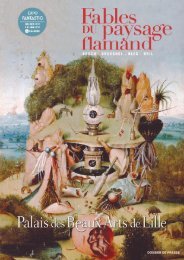journées d'étude - Palais des Beaux Arts de Lille
journées d'étude - Palais des Beaux Arts de Lille
journées d'étude - Palais des Beaux Arts de Lille
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
journées d’étu<strong>de</strong><br />
Histoire <strong>de</strong> l’Art | Histoire <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Arts</strong><br />
journées d’étu<strong>de</strong><br />
Histoire <strong>de</strong> l’Art | Histoire <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Arts</strong><br />
sont pas spécifiques. Je connais les objections :<br />
comment enseigner un champ dont on n’a pas<br />
la maîtrise ? à l’école primaire, la polyvalence<br />
permet cette richesse et cette ouverture. Pour<br />
nous, en collège, cela va nécessiter un travail<br />
collégial <strong>de</strong> groupe ainsi qu’un intérêt et une<br />
curiosité que l’on aimerait voir se développer<br />
chez l’élève. C’est donc un minima que <strong>de</strong> la<br />
développer chez les enseignants.<br />
Il existe trois niveaux <strong>de</strong> cursus scolaire pour<br />
l’Histoire <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Arts</strong>, l’école, le collège et le lycée<br />
et lycée professionnel, qui instaurent <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
situations pédagogiques pluridisciplinaires et<br />
partenariales en fonction <strong><strong>de</strong>s</strong> champs qui sont<br />
nommés. L’enseignant pourra construire <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
partenariats afin que les élèves rencontrent les<br />
œuvres dans le cadre <strong>de</strong> concerts, <strong>de</strong> la<br />
découverte <strong><strong>de</strong>s</strong> lieux tels que les musées, les<br />
centres d’art, les lieux <strong>de</strong> diffusion <strong>de</strong> l’art pour<br />
la vidéo, pour le cinéma puisque cela reste dans<br />
le champ <strong><strong>de</strong>s</strong> disciplines visuelles et cela<br />
implique la participation <strong>de</strong> tous les professeurs<br />
français, histoire, géographie, éducation<br />
physique et sportive, langue vivante et<br />
philosophie. De la même façon, pour les<br />
disciplines scientifiques, un encart a été réservé<br />
à l’explicitation <strong>de</strong> l’Histoire <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Arts</strong> ainsi que<br />
pour les disciplines économiques, sociales et<br />
techniques.<br />
Cet enseignement va instaurer <strong><strong>de</strong>s</strong> situations<br />
pédagogiques transdisciplinaires ou pluridisciplinaires<br />
en provoquant la rencontre avec<br />
l’œuvre et je voudrais insister sur la pratique :<br />
vous, dans vos écoles, vos élèves pratiquent.<br />
La dimension <strong>de</strong> l’Histoire <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Arts</strong> doit<br />
accompagner cette pratique <strong>de</strong> l’élève. Ce n’est<br />
pas un enseignement qui est déconnecté <strong>de</strong><br />
l’expérience, <strong><strong>de</strong>s</strong> créations, que les élèves<br />
peuvent conduire tout au long <strong>de</strong> leurs cursus.<br />
La difficulté pour la mise en œuvre en collège<br />
c’est que cet enseignement croise trois piliers.<br />
Le premier, c’est les gran<strong><strong>de</strong>s</strong> pério<strong><strong>de</strong>s</strong> historiques<br />
données par l’enseignement <strong>de</strong> l’histoire.<br />
Le second pilier sont les six grands domaines<br />
et le troisième pilier la liste <strong><strong>de</strong>s</strong> références. Ces<br />
thématiques suivent le programme d’histoire<br />
mais le cadre chronologique n’implique pas<br />
l’enfermement dans une pério<strong>de</strong> étroite. On a<br />
du mal au collège à faire travailler uniquement<br />
les élèves sur l’antiquité et <strong>de</strong> les couper<br />
d’autres formes <strong>de</strong> création artistique qui<br />
seraient postérieures à ces dates. La difficulté,<br />
donc, est <strong>de</strong> faire en sorte que les élèves créent<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> repères spatio-temporels qui sont liés à <strong>de</strong><br />
gran<strong><strong>de</strong>s</strong> pério<strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong> l’histoire. C’est une <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
préoccupations <strong>de</strong> cet enseignement mais elle<br />
doit permettre d’aller et venir dans l’histoire<br />
pour créer <strong><strong>de</strong>s</strong> liens et comprendre aussi les<br />
filiations. Les six grands domaines artistiques<br />
sont les arts <strong>de</strong> l’espace recouvrant<br />
l’architecture, l’urbanisme, l’art <strong><strong>de</strong>s</strong> jardins,<br />
le paysage aménagé. L’art du langage concerne<br />
la littérature écrite et orale, les romans, les<br />
nouvelles, les fables, les contes, les mythes, les<br />
poésies, les théâtres, les expressions épigraphiques,<br />
calligraphiques et typographiques. Les<br />
arts du quotidien concernent les arts appliqués,<br />
le <strong><strong>de</strong>s</strong>ign, les métiers d’art, les arts populaires,<br />
les arts du son relèvent <strong>de</strong> la musique vocale,<br />
musique instrumentale, <strong>de</strong> film, <strong><strong>de</strong>s</strong> bruitages,<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> technologies <strong>de</strong> création et diffusion<br />
musicale. Les arts du spectacle vivant<br />
concernent le théâtre, la musique, la danse,<br />
le mime, les arts du cirque, les arts <strong>de</strong> la rue,<br />
les marionnettes, les arts équestres, les feux<br />
d’artifice, les jeux d’eau. Et enfin, les arts<br />
du visuel concernent les arts plastiques tels<br />
que la peinture, la sculpture, la photographie<br />
et le cinéma ce qui est nouveau chez nous.<br />
Les objectifs <strong>de</strong> cet enseignement est <strong>de</strong> créer<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> situations <strong>de</strong> rencontres réfléchies et<br />
sensibles avec l’œuvre d’art. à travers ces<br />
rencontres, cet enseignement va nourrir l’élève<br />
<strong>de</strong> façon plus aiguisée. Cet enseignement<br />
conduit aussi à se construire une culture<br />
personnelle à valeur fondée et universelle<br />
même si les œuvres sont à caractère régional,<br />
local mais aussi national ou international. Cela<br />
permet aussi d’accé<strong>de</strong>r au rang d’amateur<br />
éclairé. M. Tapié disait que ce qui fon<strong>de</strong> le<br />
musée, c’est <strong>de</strong> créer <strong>de</strong> nouveaux publics et<br />
d’espérer que nos élèves arrivés à l’âge adulte<br />
puissent pousser la porte d’un musée sans<br />
complexe. Cette dimension d’ouverture au<br />
mon<strong>de</strong> et <strong>de</strong> maîtrise est éminemment<br />
citoyenne et va bien au <strong>de</strong>là <strong>de</strong> la culture, elle<br />
va donner à l’élève <strong><strong>de</strong>s</strong> outils <strong>de</strong> la création du<br />
mon<strong>de</strong>. Cela leur permet aussi <strong>de</strong> les ai<strong>de</strong>r à<br />
comprendre leur patrimoine pour mieux<br />
abor<strong>de</strong>r la création contemporaine. Il y a<br />
également une dimension liée à l’orientation<br />
qui est <strong>de</strong> bien comprendre la vocation <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
métiers d’art, métiers qui se font aussi à<br />
l’intérieur <strong><strong>de</strong>s</strong> musées et pas seulement les<br />
métiers <strong>de</strong> la création artistique.<br />
En ce qui concerne l’organisation : évi<strong>de</strong>mment,<br />
il y a l’étu<strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> œuvres qui s’organisent selon<br />
quatre axes : l’étu<strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> formes, l’étu<strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
techniques, l’étu<strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> significations et l’étu<strong>de</strong><br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> usages. On rejoint le propos <strong>de</strong> M r Tapié<br />
quant à l’étu<strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> formes car nous sommes là<br />
dans un apprentissage purement plastique <strong>de</strong><br />
la construction d’une œuvre. L’histoire <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
techniques permet <strong>de</strong> comprendre <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
phénomènes liés à <strong><strong>de</strong>s</strong> inventions techniques,<br />
je pense par exemple à l’invention du tube en<br />
étain au XIX e siècle qui va pouvoir permettre à<br />
l’école <strong>de</strong> Barbizon <strong>de</strong> pouvoir sortir et d’aller<br />
peindre sur le motif. Pour l’histoire <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
significations, à l’école primaire, on va être<br />
mo<strong><strong>de</strong>s</strong>te mais au collège et au lycée, on<br />
comprendra que le discours sur l’art n’est pas<br />
figé, qu’il évolue avec le temps et qu’il propose<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> approches qui sont complémentaires.<br />
Selon que l’on ait à faire avec un historien <strong>de</strong><br />
l’art, un sociologue ou un esthéticien, un<br />
psychanalyste ou un philosophe, les approches<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> œuvres seront <strong>de</strong> nature différente mais<br />
complémentaire d’où la nécessité <strong>de</strong> mettre en<br />
regard ces différentes approches. Evi<strong>de</strong>mment,<br />
un élève n’est pas obligé <strong>de</strong> connaître tous les<br />
discours sur l’art pour apprécier l’art, mais cela<br />
peut permettre <strong>de</strong> comprendre que l’œuvre<br />
d’art est réactualisée par le regard porté<br />
sur elle, notion importante qui permet <strong>de</strong><br />
comprendre la notion <strong>de</strong> chef-d’œuvre.<br />
Mentionnons l’histoire <strong><strong>de</strong>s</strong> commanditaires, il<br />
y a un ouvrage très intéressant <strong>de</strong> Baxandall<br />
« l’oeil du quattrocento » qui met l’accent sur<br />
l’œuvre dépendant <strong><strong>de</strong>s</strong> commanditaires. C’est<br />
une dimension qui va perdurer longtemps dans<br />
l’Histoire <strong>de</strong> l’Art. Evi<strong>de</strong>ment, l’objet va nous<br />
donner <strong><strong>de</strong>s</strong> émotions mais il faut aussi<br />
apprendre à les organiser, à les trier, à faire du<br />
lien avec les expériences que l’on a déjà vécues<br />
mais aussi avec les connaissances. La dimension<br />
partenarialle va se faire avec toutes les<br />
institutions artistiques et culturelles <strong>de</strong> l’Etat,<br />
les établissements <strong>de</strong> formation, les écoles<br />
d’art, les universités, les écoles d’architecture,<br />
les écoles d’art appliqué, les établissements<br />
publics à vocation artistique et culturel, les<br />
ensembles patrimoniaux, les lieux <strong>de</strong> mémoire,<br />
les chantiers <strong>de</strong> fouilles archéologiques,<br />
les villes d’Art et d’Histoire, l’ensemble <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
bâtiments civils religieux et militaire et les<br />
ouvrages d’art, avec les collectivités territoriales<br />
et les dispositifs artistiques qu’elles conduisent,<br />
qu’elles financent. Vous avez dû entendre parler<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> rési<strong>de</strong>nces-mission qui prennent peu à<br />
peu le pas sur les ateliers artistiques et puis<br />
l’ensemble <strong><strong>de</strong>s</strong> structures artistiques ou<br />
culturelles dont l’état partage la tutelle avec les<br />
collectivités territoriales.<br />
Les acquis attendus sont <strong>de</strong> trois types, articulés<br />
aux socles <strong><strong>de</strong>s</strong> compétences, <strong><strong>de</strong>s</strong> connaissances,<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> capacités et <strong><strong>de</strong>s</strong> attitu<strong><strong>de</strong>s</strong>.<br />
Les connaissances concernent un certain<br />
nombre d’œuvres paradigmatiques <strong>de</strong> notre<br />
culture occi<strong>de</strong>ntale. Il y plusieurs métho<strong><strong>de</strong>s</strong><br />
d’analyse <strong><strong>de</strong>s</strong> œuvres qu’il faut recontextualiser.<br />
On parlait <strong><strong>de</strong>s</strong> mouvements et <strong><strong>de</strong>s</strong> écoles tout<br />
à l’heure, <strong><strong>de</strong>s</strong> auteurs, <strong><strong>de</strong>s</strong> lieux, <strong><strong>de</strong>s</strong> repères<br />
historiques et artistiques mais aussi littéraire<br />
et artistiques et <strong><strong>de</strong>s</strong> métiers relevant <strong>de</strong> la<br />
création.<br />
En ce qui concerne les capacités, elles vont<br />
s’exercer dans l’observation ou dans l’écoute<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> œuvres d’art, dans l’édification <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
caractéristiques fondamentales, être capable<br />
<strong>de</strong> situer dans le temps ou dans l’espace <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
œuvres. M. Tapié parlait <strong>de</strong> la dimension<br />
politique et symbolique <strong>de</strong> l’érection <strong>de</strong> ce<br />
<strong>Palais</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Beaux</strong>-<strong>Arts</strong> face à la préfecture et<br />
les inci<strong>de</strong>nces que cela pouvait avoir dans la<br />
compréhension <strong>de</strong> l’organisation sociale.<br />
Dimension importante à enseigner en<br />
particulier dans l’architecture, les signes sont<br />
construits dans l’espace urbain et on peut les<br />
interpréter à d’autres niveaux que stylistiques.<br />
L’analyse <strong><strong>de</strong>s</strong> contextes, <strong><strong>de</strong>s</strong> environnements<br />
sociaux, techniques, économiques, culturels et<br />
donc la faculté à consulter les musées, les<br />
cinémas d’art et essai, etc.<br />
Et enfin, <strong><strong>de</strong>s</strong> attitu<strong><strong>de</strong>s</strong> qui impliquent une<br />
sensibilité et une création artistique, on dirait<br />
du sensible à l’intelligible. Rester strictement<br />
dans le sensible peut être très dangereux<br />
même avec <strong><strong>de</strong>s</strong> petits, aller du sensible à<br />
l’intelligible, être créateur, cela permet <strong>de</strong><br />
comprendre les processus <strong>de</strong> création. C’est<br />
important pour nos élèves qu’ils soient<br />
confrontés à la matière, à la résistance <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
matériaux, qu’ils soient dans une vraie<br />
expérience physique <strong>de</strong> la création et cela n’est<br />
pas remplaçable. Il est important <strong>de</strong> veiller à<br />
une création artistique, une curiosité et une<br />
ouverture d’esprit ainsi qu’un esprit critique.<br />
Pour la validation, on conseille à l’élève <strong>de</strong><br />
gar<strong>de</strong>r la mémoire <strong>de</strong> son parcours dans un<br />
cahier personnel d’Histoire <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Arts</strong>. Je ne sais<br />
pas ce que cela peut produire dans ce qui a été<br />
fait à l’école primaire, qui serait annoté par<br />
l’élève et visé par le professeur qui assure cet<br />
enseignement. L’évaluation sera portée sur le<br />
bulletin scolaire et il y aura une validation sur<br />
le bulletin national <strong><strong>de</strong>s</strong> brevets. Cela est reporté<br />
à la session <strong>de</strong> 2010, dont on ne connaît pas<br />
encore la forme.<br />
à l’école primaire, il s’agit surtout <strong>de</strong> travailler<br />
à partir du cycle 3 mais en cycle 1 et 2 les œuvres<br />
sont choisies <strong>de</strong> manière buissonnière.<br />
En cycle 3, l’enseignement se fon<strong>de</strong> sur les<br />
mêmes trois piliers : pério<strong><strong>de</strong>s</strong> historiques, les<br />
6 grands domaines artistiques et les listes<br />
<strong>de</strong> référence. Pério<strong>de</strong> historique <strong>de</strong> la préhistoire<br />
à l’antiquité romaine, le Moyen-Âge, les temps<br />
mo<strong>de</strong>rnes, le XIX e et le XX e siècle jusqu’à notre<br />
époque. Les six grands domaines sont les<br />
mêmes. La liste <strong><strong>de</strong>s</strong> références rejoint plus ou<br />
moins les périodisations historiques et les<br />
différents domaines artistiques et au niveau<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> acquis, on retrouve cette répartition<br />
tripartite <strong><strong>de</strong>s</strong> connaissances, <strong><strong>de</strong>s</strong> capacités et<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> attitu<strong><strong>de</strong>s</strong>. Dans les connaissances <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
formes d’expression, reconnaître <strong><strong>de</strong>s</strong> médiums,<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> techniques, <strong><strong>de</strong>s</strong> supports, <strong><strong>de</strong>s</strong> formes<br />
d’expression, <strong><strong>de</strong>s</strong> matériaux, <strong><strong>de</strong>s</strong> techniques,<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> outils, acquérir un premier vocabulaire<br />
spécifique pour <strong><strong>de</strong>s</strong> œuvres d’art appartenant<br />
à différents domaines artistiques et à <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
grands repères historiques. Pour les capacités,<br />
c’est surtout ce qui relève <strong>de</strong> la verbalisation<br />
c’est à dire la capacité <strong>de</strong> l’élève à nommer ce<br />
qu’il voit, à dire ce qu’il ressent face à une<br />
œuvre. Dans les capacités, on retrouve aussi la<br />
faculté d’i<strong>de</strong>ntifier une œuvre par le titre, par<br />
leur auteur, par rapport à leur contexte <strong>de</strong><br />
nature différente. Pour les attitu<strong><strong>de</strong>s</strong>, il s’agit<br />
<strong>de</strong> valoriser une curiosité et une créativité<br />
artistique, une initiation au dialogue et à<br />
l’échange et une première découverte <strong>de</strong> la<br />
diversité culturelle <strong><strong>de</strong>s</strong> arts et <strong><strong>de</strong>s</strong> hommes.<br />
J’espère qu’on aura un peu <strong>de</strong> temps pour<br />
échanger. J’aimerais avoir votre sentiment par<br />
rapport à cet enseignement puisque vous l’avez<br />
testé. Je voudrais continuer avec la distinction<br />
entre l’Histoire <strong>de</strong> l’Art et l’Histoire <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Arts</strong>.<br />
Je parle pour ma discipline en arts plastiques.<br />
La répartition <strong>de</strong> la prise en charge <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
enseignements est quantifiable dans les textes,<br />
on retrouve 50 % <strong>de</strong> l’enseignement d’art<br />
plastique dévolu à l’histoire <strong><strong>de</strong>s</strong> arts, 50 % du<br />
programme à l’éducation musicale et 25 %<br />
à l’enseignement <strong>de</strong> l’histoire. On ne va pas<br />
découper ces faibles séances d’arts plastiques<br />
au collège (55 minutes) pour introduire <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
cours magistraux, ce serait revenir en arrière<br />
par rapport à l’évolution <strong>de</strong> nos enseignements<br />
et cet enseignement culturel existe déjà, il fait<br />
une partie consubstantielle <strong>de</strong> la pratique, la<br />
pratique n’existe que par ce qu’il existe <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
œuvres. Les situations pédagogiques ne sont<br />
construites qu’à partir d’un corpus que l’on<br />
appelle le champ référentiel d’où l’on part pour<br />
construire une situation <strong>de</strong> cours. Aucune<br />
pratique artistique ne se fait au collège sans<br />
l’ancrage par rapport à <strong><strong>de</strong>s</strong> problématiques<br />
répertoriées dans le champ <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong> l’art,<br />
cette dimension culturelle existe déjà. Une<br />
séquence d’art plastique se termine toujours<br />
par une séance <strong>de</strong> diapositives montrée aux<br />
élèves qui va les conforter dans leurs recherches<br />
personnelles et c’est au moment <strong>de</strong> l’évaluation<br />
que l’élève va retrouver <strong><strong>de</strong>s</strong> problématiques<br />
vécues par <strong><strong>de</strong>s</strong> artistiques proches <strong><strong>de</strong>s</strong> siennes.<br />
C’est <strong>de</strong> cette façon là que l’éducation artistique<br />
se construit dans notre discipline qui n’est<br />
jamais déconnecté <strong>de</strong> la pratique <strong>de</strong> l’élève.<br />
C’est la pratique qui fon<strong>de</strong> la culture <strong>de</strong> l’élève<br />
et pas le contraire. Petite parenthèse pour<br />
vous indiquer comment fonctionnent nos<br />
enseignements d’art plastique : la dimension<br />
culturelle existe, mais ce que j’observe en<br />
inspection, c’est qu’elle est rarement formalisée.<br />
Les élèves voient <strong><strong>de</strong>s</strong> œuvres <strong>de</strong> toutes natures,<br />
<strong>de</strong> toutes pério<strong><strong>de</strong>s</strong>, <strong>de</strong> tous médiums mais ils<br />
n’en gar<strong>de</strong>nt pas beaucoup <strong>de</strong> traces et<br />
n’arrivent pas à construire <strong><strong>de</strong>s</strong> repères spatiaux<br />
temporels à cause <strong>de</strong> problèmes <strong>de</strong> méthodologie,<br />
d’outillage mais aussi parce que les<br />
enseignants n’en éprouvent pas la volonté en<br />
collège. Au lycée, c’est différent puisqu’on a<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> programmes limitatifs, on outille les<br />
élèves pour se repérer dans les pério<strong><strong>de</strong>s</strong>, les<br />
mouvements, pour comprendre les filiations.<br />
Cet enseignement d’Histoire <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Arts</strong> va inscrire<br />
la dimension culturelle dans les enseignements<br />
dans la perspective <strong>de</strong> l’utilisation dans<br />
l’analyse critique, dans la comparaison, dans<br />
une meilleure compréhension <strong><strong>de</strong>s</strong> phénomènes<br />
du mon<strong>de</strong> et pas pour construire une culture<br />
stricto-sensu. C’est cette dimension qui fait la<br />
distinction avec l’Histoire <strong>de</strong> l’Art. L’Histoire <strong>de</strong><br />
l’Art, elle, a toujours pour objet l’étu<strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
œuvres ainsi que l’analyse du sens qu’elles<br />
peuvent prendre. La dimension d’approche<br />
par contexte qu’a cité M. Tapié ai<strong>de</strong> à la<br />
compréhension <strong><strong>de</strong>s</strong> phénomènes artistiques.<br />
L’Histoire <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Arts</strong> a pour objet, au sein d’un<br />
enseignement scolaire obligatoire, l’étu<strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
œuvres liées aux catégories, son objectif est <strong>de</strong><br />
créer un contact sensible et approfondi, direct<br />
avec les œuvres, d’analyser ces œuvres ou les<br />
objets artistiques <strong>de</strong> différents arts et <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
différents domaines <strong>de</strong> la culture, en mettant<br />
en évi<strong>de</strong>nce la relation entre les formes, les<br />
techniques, les significations et les usages et<br />
14 | 29-30 janvier 2009 • lille, palais <strong><strong>de</strong>s</strong> beaux-arts lille, palais <strong><strong>de</strong>s</strong> beaux-arts • 29-30 janvier 2009 | 15