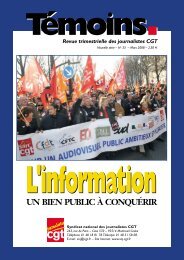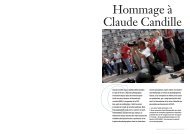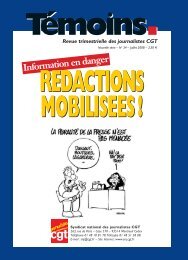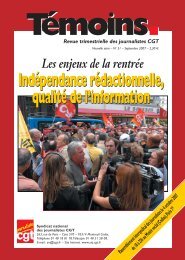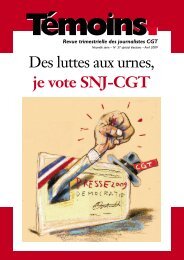pages simples - Snj-cgt
pages simples - Snj-cgt
pages simples - Snj-cgt
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
dans la rue. Il y a tout d’abord ces affiches de<br />
mai qui, réalisées de mi-mai à fin juin, avec peu<br />
de moyens et beaucoup d’imagination, par les<br />
étudiants de l’atelier populaire des Beaux-Arts<br />
et grâce à la technique nouvelle et artisanale de<br />
la sérigraphie, vont passer à la postérité. Le dessin<br />
y est stylisé. Pas question ici de discours politique<br />
langue de bois car le texte y est rare et percutant,<br />
lourd de sens.<br />
Avec les graffiti anonymes et sobres (par opposition<br />
aux tags qui aujourd’hui envahissent<br />
les murs dans une sorte d’exhibitionnisme<br />
artistique), on est aux franges d’une sorte<br />
de poésie pure. Une poésie dont les mille<br />
fleurs (« sous les pavés, la plage », « soyons réalistes,<br />
demandons l’impossible », « l’imagination<br />
au pouvoir ») continuent à habiter<br />
notre imaginaire collectif et militant.<br />
En marge de ces radios périphériques et<br />
de cette radio d’État que les affiches de<br />
mai critiquent allègrement (« on vous<br />
intoxique », « mouton, radio, télévision »),<br />
commencent à émerger des radios<br />
pirates, souvent éphémères, comme<br />
Radio Sorbonne que les étudiants de mai tentent<br />
de détourner à leur profit. Mais le mouvement<br />
est lancé, qui se traduira par l’apparition<br />
de quantité de radios pirates dont certaines<br />
seront légalisées en 1981 lorsque le pouvoir<br />
socialiste décidera de libérer les ondes. Créée<br />
en 1969, Radio Campus à Lille, qui est la plus<br />
ancienne des radios associatives et qui existe<br />
toujours, est le trait d’union emblématique de<br />
cette histoire qui débouchera sur un bouleversement<br />
complet du paysage audiovisuel.<br />
Quelques itinéraires<br />
médiatiques de révoltés<br />
Mais cette conquête du pouvoir de la parole,<br />
c’est également au travers de la presse de mai,<br />
une presse particulièrement abondante et foisonnante,<br />
qu’elle se manifestera. Des dizaines<br />
de bulletins naissent, qui vont d’une simple<br />
feuille ronéotée recto verso au canard qui n’a<br />
pas à rougir de la comparaison avec un vrai<br />
journal fait par des vrais professionnels de l’information.<br />
Certains titres ne franchiront pas le<br />
cap de l’année 1968, d’autres feront la jonction<br />
avec les années soixante-dix. L’un d’entre eux,<br />
qui existe toujours, traversera toute cette<br />
période qui va de la guerre d’Algérie à nos jours.<br />
Né en 1960, Hara Kiri prendra, après Mai 68,<br />
un contenu plus politique. Pendant les événements<br />
de mai, on retrouvera les dessinateurs de<br />
Hara Kiri aussi bien à Action qu’à l’Enragé. Les<br />
dessinateurs de Hara Kiri renouvelleront le<br />
genre du dessin de presse politique. Mai 1968<br />
les avait mis en appétit et le mensuel deviendra<br />
hebdomadaire quelques mois en 1970 avant<br />
d’être interdit, victime de la censure, et de reparaître<br />
aussitôt sous le nom de Charlie Hebdo.<br />
Parce qu’il n’est lié à aucun mouvement politique<br />
et qu’il est soutenu par l’UNEF, le SNE-<br />
SUP, les comités d’action lycéens et le Comité<br />
du 22 mars, Action sera la figure emblématique<br />
de cette presse éphémère. Vendu à la criée, il<br />
deviendra même quotidien courant juin, avant<br />
de continuer sous la forme d’un hebdomadaire<br />
qui disparaîtra à la fin de l’année 1969.<br />
C’est en 1973 que les Cahiers de mai disparaîtront,<br />
au moment où éclate l’affaire Lip. La<br />
période est riche de ces militants que l’action<br />
transforme bientôt en journalistes professionnels<br />
et qui apporteront leur savoir aux<br />
rédacteurs de Lip Unité ou qui intégreront le<br />
journal Libération.<br />
Publiée de 1968 à 1970, la Cause du peuple avait<br />
fini par être interdite et par disparaître. Le goût<br />
de l’aventure journalistique avait laissé de nombreux<br />
militants maoïstes sur leur faim. C’est le<br />
tabassage d’un journaliste du Nouvel Observateur<br />
par des policiers qui sera à l’origine d’une<br />
réaction de la profession, qui finira par déboucher,<br />
courant 1971, sur l’APL, l’Agence de<br />
presse Libération, qui ambitionne de donner la<br />
parole au peuple. Deux ans plus tard, en<br />
mai 1973, Sartre et Clavel lanceront Libération,<br />
le quotidien qui renouvellera le journalisme de<br />
reportage avant de devenir le journal branché<br />
des années Mitterrand et de tomber dans l’escarcelle<br />
du baron de Rothschild.<br />
Enfin, après 1968, les révoltés de mai essaimeront<br />
sur de nombreux fronts. À côté des journaux<br />
d’organisation (Rouge ou Tribune socialiste<br />
qui n’a pas survécu à la disparition du PSU), Politique<br />
hebdo, né en 1970 et disparu en 1978,<br />
incarne une presse engagée politiquement sans<br />
être pour autant partisane. Sa création est en<br />
partie le fait de dissidents du Nouvel Observateur.<br />
Quant à Actuel, né de la transformation d’un<br />
journal de jazz, il incarnera la culture underground<br />
jusqu’en 1975. Disparu une première<br />
fois, il renaîtra en 1979 pour accompagner les<br />
années Mitterrand et disparaître à nouveau.<br />
C’est après 1968 que va aussi fleurir tout une<br />
presse de la contestation, engagée dans des<br />
luttes spécifiques, sur des fronts divers, ceux<br />
de la médecine ou de l’éducation, des<br />
sciences ou de la sexualité, du féminisme<br />
ou de l’antimilitarisme, de la<br />
contre-information locale ou des cultures<br />
régionales sans oublier bien sûr<br />
l’écologie politique, dont la Gueule<br />
ouverte puis le Sauvage accompagnent<br />
l’émergence.<br />
Qu’en reste-t-il aujourd’hui? Cet irrésistible<br />
besoin de prendre la parole,<br />
pour le meilleur comme pour le pire,<br />
que l’on retrouve dans ces blogs et ces<br />
sites collaboratifs que la révolution<br />
Internet a rendu possibles. Avec sans<br />
doute de vraies différences du point de vue<br />
des projets et des motivations.<br />
Et, par une curieuse ironie de l’histoire, c’est<br />
dans la critique des médias que l’on retrouve<br />
le plus la presse engagée aujourd’hui.<br />
Comme si, quarante ans après, un conformisme<br />
médiatique d’un nouveau genre suscitait<br />
à nouveau ce besoin d’une information<br />
libérée, que les révoltés de mai allaient exprimer<br />
avec leur imagination fertile. Et si le<br />
temps était venu de redire « Chiche ! » ■<br />
P.S. Sans doute la débauche d’articles, de<br />
revues, d’ouvrages consacrés à Mai 68 a-t-elle<br />
à voir avec la volonté affirmée par Nicolas Sarkozy<br />
pendant la campagne électorale présidentielle<br />
de l’an dernier de liquider Mai 68.<br />
■ Références bibliographiques<br />
– La France des années 1968, sous la<br />
direction d’Antoine Artous, Didier Epsztein et<br />
Patrick Silberstein, éditions Syllepse.<br />
– Dictionnaire de Mai 68, sous la direction de<br />
Jacques Capdevielle et Henri Rey, Larousse.<br />
– 68 Une histoire collective (1962-1981),<br />
sous la direction de Philippe Artières et<br />
Michelle Zancarini-Fournel, La Découverte.<br />
– Les Années 68, Charlotte et Patrick Rotman,<br />
Le Seuil.<br />
– Mai 68, l’héritage impossible, Jean-Pierre<br />
Le Goff, La Découverte.<br />
Photos : Bernard Perrine<br />
TÉMOINS<br />
N° 34 / JUILLET 2008 27