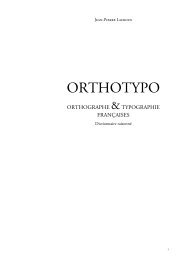En question : la grammaire typographique - Liste Typographie
En question : la grammaire typographique - Liste Typographie
En question : la grammaire typographique - Liste Typographie
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Ici, ce n'est pas <strong>la</strong> lisibilite¨ <strong>typographique</strong><br />
2.<br />
(ou legibility)quiesten<br />
mais bien <strong>la</strong> lisibilite¨ linguistique<br />
cause,<br />
(ou readability).<br />
Meª me e¨ nonce¨ page æò (note "â) :<br />
3.<br />
Remarquons que, suivant le meª me<br />
û<br />
le point-virgule, les deux<br />
code,<br />
[apparemment, ce ne sont pas<br />
points<br />
meª mes ; page æã², l'auteur compose<br />
les<br />
: deux-points], le point d'exc<strong>la</strong>-<br />
et le point d'interrogation ^<br />
mation<br />
deux derniers pourtant plus visi-<br />
ces<br />
parës du mot qui<br />
bles^sont,eux,se¨<br />
pre¨ ce© de par une espace. Aé quelle<br />
les<br />
obe¨ issent ces re© gles conside¨<br />
logique<br />
re¨ es comme sacrëes par toute une<br />
ý ( Je me suis exprime¨<br />
profession<br />
cette logique dans mon rapport.)<br />
sur<br />
Page æå : û On pourrait me reprocher<br />
4.<br />
un certain illogisme en col<strong>la</strong>nt<br />
point et autres signes contre le mot<br />
le<br />
ce¨ dent; et dans les trois der-<br />
pre¨<br />
cas en les faisant toujours prëceniers<br />
der et suivre d'une espace. [²]. ý<br />
lucidite¨ !(Voire¨ galement les<br />
Quelle<br />
richaudiennes, p. "æ.)<br />
propositions<br />
La premie© re parenthe© se est compose¨<br />
5.<br />
e en romain, mais <strong>la</strong> deuxie© me<br />
Richaudeau Franc° ois, Manuel<br />
6.<br />
typographie et de mise en page,p.ää.<br />
de<br />
e¨ galement ce qu'il e¨ crit au<br />
(Voir<br />
suivant.)<br />
paragraphe<br />
Permettez-moi d'ironiser. Au<br />
7.<br />
: , , , , ² (voir page á").<br />
choix<br />
C'est comme avec les pre¨ servatifs,<br />
9.<br />
y en a qui pensent que c'est plus<br />
il<br />
La simplicite¨ ,voi<strong>la</strong>© ce qui caracte¨<br />
10.<br />
rise un professionnel. Ajoutez des<br />
le¨ ments a© une charpente rëalise¨ e<br />
e¨<br />
les re© gles de l'art, c'est tout l'e¨ di-<br />
dans<br />
qui est fragilise¨ .Lanatureutilise<br />
¢ce<br />
le syste© me le plus simple,<br />
toujours<br />
plus e¨ conomique, pour parvenir<br />
le<br />
ses ¢ns. a©<br />
Re<strong>la</strong>tivement a© l'û esthe¨ tique ý<br />
11.<br />
R. Chate<strong>la</strong>in e¨ crit<br />
richaudienne,<br />
åæ : û [²] notre me¨ moire stocke ces chi¡res en les groupant<br />
Page<br />
par blocs ( ou chunks )e¨ quivalents a© des mots [²]. ý L'auteur<br />
crit dans son Manuel de typographie et de mise en page (Retz, Paris,<br />
e¨<br />
p."åò) : û Pourquoi re¨ pudier le frang<strong>la</strong>is et pas le fran<strong>la</strong>tin. ý<br />
"ñðñ,<br />
ææ : û Lorsque les tirets marquent les de¨ buts de chacune<br />
Page<br />
lignes d'une suite d'e¨ nume¨ rations, faire suivre chacun d'eux<br />
des<br />
espace-mots si possible ¢xe, a¢n que les premie© res lettres<br />
d'une<br />
premiers mots de chaque ligne soient alignës[sic] verticale-<br />
des<br />
ý Eè nume¨ rer, c'est e¨ noncer une a© une (successivement) des<br />
mentÃ.<br />
faisant partie d'un tout; c'est les passer en revue. Eè numë-<br />
choses<br />
: action d'e¨ nume¨ rer; re¨ sultat de cette action (l'exemple de<br />
ration<br />
pre¨ ce¨ dente ^ emprunte¨ a© Patricia H.Weistheimer ^ com-<br />
<strong>la</strong>page<br />
une e¨ nume¨ ration). L'expression : û une suite d'e¨ nume¨ rations ý<br />
porte<br />
donc impropre. Il semblerait que dans le syste© me richaudien<br />
est<br />
tirets soient ne¨ cessaires pour marquer le de¨ but de chaque<br />
plusieurs<br />
nonce¨ .Demeª me, chacun de ces e¨ nonce¨ s comporterait plusieurs<br />
e¨<br />
Quant aux û premie© res lettres des premiers mots de chaque<br />
dëbuts.<br />
ý!² Quelle abondance Ä! Moi, c° a me donne le tournis.<br />
ligne<br />
contradictions, etc.<br />
Incohërences,<br />
åò, apre© savoirde¨ nonce¨ l'incohe¨ rence et <strong>la</strong> complexite¨ de<br />
Page<br />
re© gles, l'auteur fait remarquer que û [²] pour marquer<br />
certaines<br />
¢n d'une phrase, un point d'exc<strong>la</strong>mation est se¨ pare¨ du dernier<br />
<strong>la</strong><br />
par une espace, alors qu'un simple point ^ pourtant moins<br />
mot<br />
lui ^ est colle¨ contre ce motÅ ý. Dans ce cas, pourquoi<br />
visible,<br />
page æã que ^ comme le point ^ le point d'interrogation,<br />
exiger<br />
point d'exc<strong>la</strong>mation, le deux-points et le point-virgule soient<br />
le<br />
saumotquipre¨ ce© de et soient suivis de deux espaces-mots<br />
colle¨<br />
Pourquoi ne pas faire comme certains imprimeurs du<br />
variables.<br />
qui encadraient ces signes d'une espace La© , je comprendrais<br />
passe¨<br />
<strong>la</strong> logique de l'auteur. Et c'est lui qui reproche un manque<br />
mieux<br />
logique aux auteurs de codesÆ. (Pour le moment, je passe sur<br />
de<br />
autres propositions d'espace avant et apre© s <strong>la</strong> ponctuation.)<br />
les<br />
Italique<br />
åå, on compose en italique : û [²] ^ un dialogue; ô ^ une<br />
Page<br />
( et dans ces deux derniers cas, ce<strong>la</strong> n'exclut pas d'encadrer ces<br />
citation<br />
par des guillemets )Ç. ý Dans les ouvrages qu'il consacre a© <strong>la</strong><br />
textes<br />
, l'auteur n'omet jamais de faire remarquer que û les mots<br />
lisibilite¨<br />
s en italique sont le¨ ge© rement moins lisibles que s'ils<br />
compose¨<br />
taient en romainÈ. ý Un dialogue, c° a peut nëcessiter de nombreuses<br />
l'e¨<br />
pages. Or, contrairement aux autres codes, il demande a©<br />
que ces derniers ^ comme les citations ^ soient compose¨ sen<br />
ce<br />
Parmi ses cris de guerre : simpli¢ons! Estimant qu'un<br />
italiqueÉ.<br />
pourrait ne pas su¤re, pourquoi ^ au nom de <strong>la</strong> sacrosainte<br />
signal<br />
lisibilite¨ ʲ ^ ne pas rajouter des guillemetsË. N'est-ce pas<br />
que d'aucuns appellent : û redondance <strong>typographique</strong> ýÃÂ.<br />
ce<br />
åå : û L'idëal pour les textes [italiques] en petit corps<br />
Page<br />
de composer ces mots dans un corps supe¨ rieur a© celui du<br />
serait<br />
courant ² et tant pis pour l'esthëtique <strong>typographique</strong>ÃÃ ²<br />
texte<br />
appre¨ cieront! [²] L'importance<br />
cinquante,<br />
de l'homoge¨ ne¨ ite¨ d'un<br />
texte, dans <strong>la</strong> cre¨ ation typogra-<br />
l'aspect visuel, gëomëtrique<br />
phique,<br />
<strong>la</strong> composition, e¨ chappent-ils a©<br />
de<br />
<strong>la</strong> sensibilite¨ de Richaudeau ý "<br />
<strong>En</strong> <strong>question</strong> : <strong>la</strong> <strong>grammaire</strong> <strong>typographique</strong> "ò<br />
1. Ici, je n'analyse que le franc° ais.<br />
en italique.<br />
8. Aé chacun ses manies, ses idoles²<br />
suª r s'ils en mettent deux²<br />
LeGutenberg (n‘ "æ) : û Ceux qui<br />
dans<br />
attache¨ sa© <strong>la</strong> ligne grise, fon-<br />
sont<br />
dement de l'e¨ cole baª loise des anne¨ es