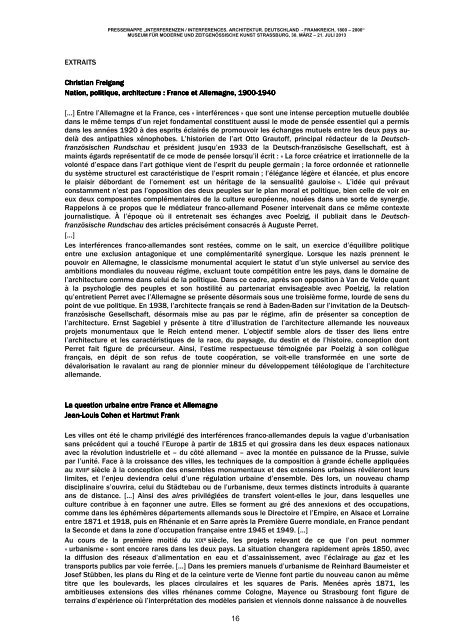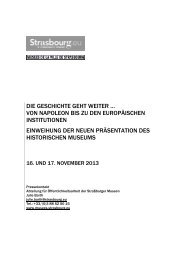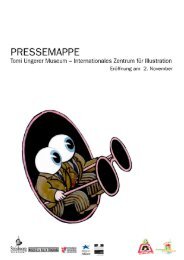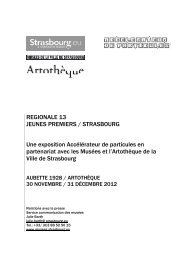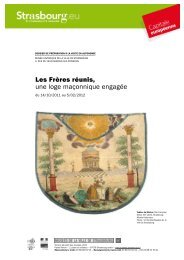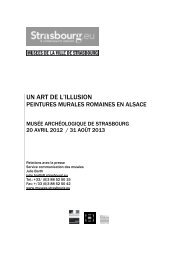Pressemappe - Musées de Strasbourg
Pressemappe - Musées de Strasbourg
Pressemappe - Musées de Strasbourg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
PRESSEMAPPE „INTERFERENZEN / INTERFERENCES. ARCHITEKTUR. DEUTSCHLAND - FRANKREICH, 1800 – 2000“<br />
MUSEUM FÜR MODERNE UND ZEITGENÖSSISCHE KUNST STRASSBURG, 30. MÄRZ – 21. JULI 2013<br />
EXTRAITS<br />
Christian Freigang<br />
Nation, politique, architecture : France et Allemagne, 1900-1940<br />
1940<br />
[…] Entre l’Allemagne et la France, ces « interférences » que sont une intense perception mutuelle doublée<br />
dans le même temps d’un rejet fondamental constituent aussi le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> pensée essentiel qui a permis<br />
dans les années 1920 à <strong>de</strong>s esprits éclairés <strong>de</strong> promouvoir les échanges mutuels entre les <strong>de</strong>ux pays au<strong>de</strong>là<br />
<strong>de</strong>s antipathies xénophobes. L’historien <strong>de</strong> l’art Otto Grautoff, principal rédacteur <strong>de</strong> la Deutschfranzösischen<br />
Rundschau et prési<strong>de</strong>nt jusqu’en 1933 <strong>de</strong> la Deutsch-französische Gesellschaft, est à<br />
maints égards représentatif <strong>de</strong> ce mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> pensée lorsqu’il écrit : « La force créatrice et irrationnelle <strong>de</strong> la<br />
volonté d’espace dans l’art gothique vient <strong>de</strong> l’esprit du peuple germain ; la force ordonnée et rationnelle<br />
du système structurel est caractéristique <strong>de</strong> l’esprit romain ; l’élégance légère et élancée, et plus encore<br />
le plaisir débordant <strong>de</strong> l’ornement est un héritage <strong>de</strong> la sensualité gauloise ». L’idée qui prévaut<br />
constamment n’est pas l’opposition <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux peuples sur le plan moral et politique, bien celle <strong>de</strong> voir en<br />
eux <strong>de</strong>ux composantes complémentaires <strong>de</strong> la culture européenne, nouées dans une sorte <strong>de</strong> synergie.<br />
Rappelons à ce propos que le médiateur franco-allemand Posener intervenait dans ce même contexte<br />
journalistique. À l’époque où il entretenait ses échanges avec Poelzig, il publiait dans le Deutschfranzösische<br />
Rundschau <strong>de</strong>s articles précisément consacrés à Auguste Perret.<br />
[…]<br />
Les interférences franco-alleman<strong>de</strong>s sont restées, comme on le sait, un exercice d’équilibre politique<br />
entre une exclusion antagonique et une complémentarité synergique. Lorsque les nazis prennent le<br />
pouvoir en Allemagne, le classicisme monumental acquiert le statut d’un style universel au service <strong>de</strong>s<br />
ambitions mondiales du nouveau régime, excluant toute compétition entre les pays, dans le domaine <strong>de</strong><br />
l’architecture comme dans celui <strong>de</strong> la politique. Dans ce cadre, après son opposition à Van <strong>de</strong> Vel<strong>de</strong> quant<br />
à la psychologie <strong>de</strong>s peuples et son hostilité au partenariat envisageable avec Poelzig, la relation<br />
qu’entretient Perret avec l’Allemagne se présente désormais sous une troisième forme, lour<strong>de</strong> <strong>de</strong> sens du<br />
point <strong>de</strong> vue politique. En 1938, l’architecte français se rend à Ba<strong>de</strong>n-Ba<strong>de</strong>n sur l’invitation <strong>de</strong> la Deutschfranzösische<br />
Gesellschaft, désormais mise au pas par le régime, afin <strong>de</strong> présenter sa conception <strong>de</strong><br />
l’architecture. Ernst Sagebiel y présente à titre d’illustration <strong>de</strong> l’architecture alleman<strong>de</strong> les nouveaux<br />
projets monumentaux que le Reich entend mener. L’objectif semble alors <strong>de</strong> tisser <strong>de</strong>s liens entre<br />
l’architecture et les caractéristiques <strong>de</strong> la race, du paysage, du <strong>de</strong>stin et <strong>de</strong> l’histoire, conception dont<br />
Perret fait figure <strong>de</strong> précurseur. Ainsi, l’estime respectueuse témoignée par Poelzig à son collègue<br />
français, en dépit <strong>de</strong> son refus <strong>de</strong> toute coopération, se voit-elle transformée en une sorte <strong>de</strong><br />
dévalorisation le ravalant au rang <strong>de</strong> pionnier mineur du développement téléologique <strong>de</strong> l’architecture<br />
alleman<strong>de</strong>.<br />
La question urbaine entre France et Allemagne<br />
Jean-Louis Cohen et Hartmut Frank<br />
Les villes ont été le champ privilégié <strong>de</strong>s interférences franco-alleman<strong>de</strong>s <strong>de</strong>puis la vague d’urbanisation<br />
sans précé<strong>de</strong>nt qui a touché l’Europe à partir <strong>de</strong> 1815 et qui grossira dans les <strong>de</strong>ux espaces nationaux<br />
avec la révolution industrielle et – du côté allemand – avec la montée en puissance <strong>de</strong> la Prusse, suivie<br />
par l’unité. Face à la croissance <strong>de</strong>s villes, les techniques <strong>de</strong> la composition à gran<strong>de</strong> échelle appliquées<br />
au XVIII e siècle à la conception <strong>de</strong>s ensembles monumentaux et <strong>de</strong>s extensions urbaines révéleront leurs<br />
limites, et l’enjeu <strong>de</strong>viendra celui d’une régulation urbaine d’ensemble. Dès lors, un nouveau champ<br />
disciplinaire s’ouvrira, celui du Städtebau ou <strong>de</strong> l’urbanisme, <strong>de</strong>ux termes distincts introduits à quarante<br />
ans <strong>de</strong> distance. […] Ainsi <strong>de</strong>s aires privilégiées <strong>de</strong> transfert voient-elles le jour, dans lesquelles une<br />
culture contribue à en façonner une autre. Elles se forment au gré <strong>de</strong>s annexions et <strong>de</strong>s occupations,<br />
comme dans les éphémères départements allemands sous le Directoire et l’Empire, en Alsace et Lorraine<br />
entre 1871 et 1918, puis en Rhénanie et en Sarre après la Première Guerre mondiale, en France pendant<br />
la Secon<strong>de</strong> et dans la zone d’occupation française entre 1945 et 1949. […]<br />
Au cours <strong>de</strong> la première moitié du XIX e siècle, les projets relevant <strong>de</strong> ce que l’on peut nommer<br />
« urbanisme » sont encore rares dans les <strong>de</strong>ux pays. La situation changera rapi<strong>de</strong>ment après 1850, avec<br />
la diffusion <strong>de</strong>s réseaux d’alimentation en eau et d’assainissement, avec l’éclairage au gaz et les<br />
transports publics par voie ferrée. […] Dans les premiers manuels d’urbanisme <strong>de</strong> Reinhard Baumeister et<br />
Josef Stübben, les plans du Ring et <strong>de</strong> la ceinture verte <strong>de</strong> Vienne font partie du nouveau canon au même<br />
titre que les boulevards, les places circulaires et les squares <strong>de</strong> Paris. Menées après 1871, les<br />
ambitieuses extensions <strong>de</strong>s villes rhénanes comme Cologne, Mayence ou <strong>Strasbourg</strong> font figure <strong>de</strong><br />
terrains d’expérience où l’interprétation <strong>de</strong>s modèles parisien et viennois donne naissance à <strong>de</strong> nouvelles<br />
16