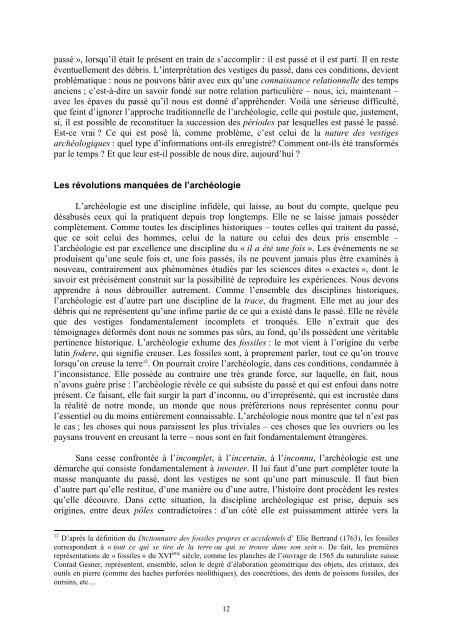Des vestiges
Des vestiges
Des vestiges
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
passé », lorsqu’il était le présent en train de s’accomplir : il est passé et il est parti. Il en reste<br />
éventuellement des débris. L’interprétation des <strong>vestiges</strong> du passé, dans ces conditions, devient<br />
problématique : nous ne pouvons bâtir avec eux qu’une connaissance relationnelle des temps<br />
anciens ; c’est-à-dire un savoir fondé sur notre relation particulière – nous, ici, maintenant –<br />
avec les épaves du passé qu’il nous est donné d’appréhender. Voilà une sérieuse difficulté,<br />
que feint d’ignorer l’approche traditionnelle de l’archéologie, celle qui postule que, justement,<br />
si, il est possible de reconstituer la succession des périodes par lesquelles est passé le passé.<br />
Est-ce vrai ? Ce qui est posé là, comme problème, c’est celui de la nature des <strong>vestiges</strong><br />
archéologiques : quel type d’informations ont-ils enregistré? Comment ont-ils été transformés<br />
par le temps ? Et que leur est-il possible de nous dire, aujourd’hui ?<br />
Les révolutions manquées de l’archéologie<br />
L’archéologie est une discipline infidèle, qui laisse, au bout du compte, quelque peu<br />
désabusés ceux qui la pratiquent depuis trop longtemps. Elle ne se laisse jamais posséder<br />
complètement. Comme toutes les disciplines historiques – toutes celles qui traitent du passé,<br />
que ce soit celui des hommes, celui de la nature ou celui des deux pris ensemble –<br />
l’archéologie est par excellence une discipline du « il a été une fois ». Les événements ne se<br />
produisent qu’une seule fois et, une fois passés, ils ne peuvent jamais plus être examinés à<br />
nouveau, contrairement aux phénomènes étudiés par les sciences dites « exactes », dont le<br />
savoir est précisément construit sur la possibilité de reproduire les expériences. Nous devons<br />
apprendre à nous débrouiller autrement. Comme l’ensemble des disciplines historiques,<br />
l’archéologie est d’autre part une discipline de la trace, du fragment. Elle met au jour des<br />
débris qui ne représentent qu’une infime partie de ce qui a existé dans le passé. Elle ne révèle<br />
que des <strong>vestiges</strong> fondamentalement incomplets et tronqués. Elle n’extrait que des<br />
témoignages déformés dont nous ne sommes pas sûrs, au fond, qu’ils possèdent une véritable<br />
pertinence historique. L’archéologie exhume des fossiles : le mot vient à l’origine du verbe<br />
latin fodere, qui signifie creuser. Les fossiles sont, à proprement parler, tout ce qu’on trouve<br />
lorsqu’on creuse la terre 12 . On pourrait croire l’archéologie, dans ces conditions, condamnée à<br />
l’inconsistance. Elle possède au contraire une très grande force, sur laquelle, en fait, nous<br />
n’avons guère prise : l’archéologie révèle ce qui subsiste du passé et qui est enfoui dans notre<br />
présent. Ce faisant, elle fait surgir la part d’inconnu, ou d’irreprésenté, qui est incrustée dans<br />
la réalité de notre monde, un monde que nous préférerions nous représenter connu pour<br />
l’essentiel ou du moins entièrement connaissable. L’archéologie nous montre que tel n’est pas<br />
le cas ; les choses qui nous paraissent les plus triviales – ces choses que les ouvriers ou les<br />
paysans trouvent en creusant la terre – nous sont en fait fondamentalement étrangères.<br />
Sans cesse confrontée à l’incomplet, à l’incertain, à l’inconnu, l’archéologie est une<br />
démarche qui consiste fondamentalement à inventer. Il lui faut d’une part compléter toute la<br />
masse manquante du passé, dont les <strong>vestiges</strong> ne sont qu’une part minuscule. Il faut bien<br />
d’autre part qu’elle restitue, d’une manière ou d’une autre, l’histoire dont procèdent les restes<br />
qu’elle découvre. Dans cette situation, la discipline archéologique est prise, depuis ses<br />
origines, entre deux pôles contradictoires : d’un côté elle est puissamment attirée vers la<br />
12 D’après la définition du Dictionnaire des fossiles propres et accidentels d’ Elie Bertrand (1763), les fossiles<br />
correspondent à « tout ce qui se tire de la terre ou qui se trouve dans son sein ». De fait, les premières<br />
représentations de « fossiles » du XVI ème siècle, comme les planches de l’ouvrage de 1565 du naturaliste suisse<br />
Conrad Gesner, représentent, ensemble, selon le degré d’élaboration géométrique des objets, des cristaux, des<br />
outils en pierre (comme des haches perforées néolithiques), des concrétions, des dents de poissons fossiles, des<br />
oursins, etc…<br />
12