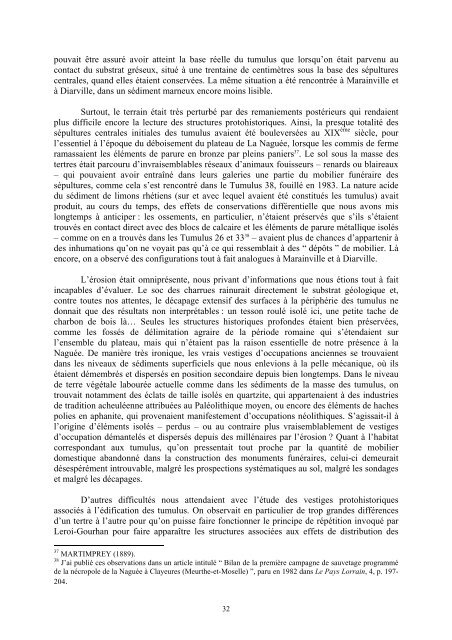Des vestiges
Des vestiges
Des vestiges
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
pouvait être assuré avoir atteint la base réelle du tumulus que lorsqu’on était parvenu au<br />
contact du substrat gréseux, situé à une trentaine de centimètres sous la base des sépultures<br />
centrales, quand elles étaient conservées. La même situation a été rencontrée à Marainville et<br />
à Diarville, dans un sédiment marneux encore moins lisible.<br />
Surtout, le terrain était très perturbé par des remaniements postérieurs qui rendaient<br />
plus difficile encore la lecture des structures protohistoriques. Ainsi, la presque totalité des<br />
sépultures centrales initiales des tumulus avaient été bouleversées au XIX ème siècle, pour<br />
l’essentiel à l’époque du déboisement du plateau de La Naguée, lorsque les commis de ferme<br />
ramassaient les éléments de parure en bronze par pleins paniers 37 . Le sol sous la masse des<br />
tertres était parcouru d’invraisemblables réseaux d’animaux fouisseurs – renards ou blaireaux<br />
– qui pouvaient avoir entraîné dans leurs galeries une partie du mobilier funéraire des<br />
sépultures, comme cela s’est rencontré dans le Tumulus 38, fouillé en 1983. La nature acide<br />
du sédiment de limons rhétiens (sur et avec lequel avaient été constitués les tumulus) avait<br />
produit, au cours du temps, des effets de conservations différentielle que nous avons mis<br />
longtemps à anticiper : les ossements, en particulier, n’étaient préservés que s’ils s’étaient<br />
trouvés en contact direct avec des blocs de calcaire et les éléments de parure métallique isolés<br />
– comme on en a trouvés dans les Tumulus 26 et 33 38 – avaient plus de chances d’appartenir à<br />
des inhumations qu’on ne voyait pas qu’à ce qui ressemblait à des “ dépôts ” de mobilier. Là<br />
encore, on a observé des configurations tout à fait analogues à Marainville et à Diarville.<br />
L’érosion était omniprésente, nous privant d’informations que nous étions tout à fait<br />
incapables d’évaluer. Le soc des charrues rainurait directement le substrat géologique et,<br />
contre toutes nos attentes, le décapage extensif des surfaces à la périphérie des tumulus ne<br />
donnait que des résultats non interprétables : un tesson roulé isolé ici, une petite tache de<br />
charbon de bois là… Seules les structures historiques profondes étaient bien préservées,<br />
comme les fossés de délimitation agraire de la période romaine qui s’étendaient sur<br />
l’ensemble du plateau, mais qui n’étaient pas la raison essentielle de notre présence à la<br />
Naguée. De manière très ironique, les vrais <strong>vestiges</strong> d’occupations anciennes se trouvaient<br />
dans les niveaux de sédiments superficiels que nous enlevions à la pelle mécanique, où ils<br />
étaient démembrés et dispersés en position secondaire depuis bien longtemps. Dans le niveau<br />
de terre végétale labourée actuelle comme dans les sédiments de la masse des tumulus, on<br />
trouvait notamment des éclats de taille isolés en quartzite, qui appartenaient à des industries<br />
de tradition acheuléenne attribuées au Paléolithique moyen, ou encore des éléments de haches<br />
polies en aphanite, qui provenaient manifestement d’occupations néolithiques. S’agissait-il à<br />
l’origine d’éléments isolés – perdus – ou au contraire plus vraisemblablement de <strong>vestiges</strong><br />
d’occupation démantelés et dispersés depuis des millénaires par l’érosion ? Quant à l’habitat<br />
correspondant aux tumulus, qu’on pressentait tout proche par la quantité de mobilier<br />
domestique abandonné dans la construction des monuments funéraires, celui-ci demeurait<br />
désespérément introuvable, malgré les prospections systématiques au sol, malgré les sondages<br />
et malgré les décapages.<br />
D’autres difficultés nous attendaient avec l’étude des <strong>vestiges</strong> protohistoriques<br />
associés à l’édification des tumulus. On observait en particulier de trop grandes différences<br />
d’un tertre à l’autre pour qu’on puisse faire fonctionner le principe de répétition invoqué par<br />
Leroi-Gourhan pour faire apparaître les structures associées aux effets de distribution des<br />
37 MARTIMPREY (1889).<br />
38 J’ai publié ces observations dans un article intitulé “ Bilan de la première campagne de sauvetage programmé<br />
de la nécropole de la Naguée à Clayeures (Meurthe-et-Moselle) ”, paru en 1982 dans Le Pays Lorrain, 4, p. 197-<br />
204.<br />
32