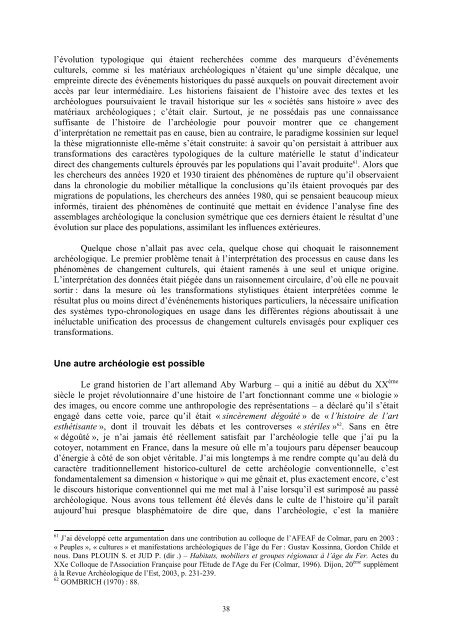Des vestiges
Des vestiges
Des vestiges
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
l’évolution typologique qui étaient recherchées comme des marqueurs d’événements<br />
culturels, comme si les matériaux archéologiques n’étaient qu’une simple décalque, une<br />
empreinte directe des événements historiques du passé auxquels on pouvait directement avoir<br />
accès par leur intermédiaire. Les historiens faisaient de l’histoire avec des textes et les<br />
archéologues poursuivaient le travail historique sur les « sociétés sans histoire » avec des<br />
matériaux archéologiques ; c’était clair. Surtout, je ne possédais pas une connaissance<br />
suffisante de l’histoire de l’archéologie pour pouvoir montrer que ce changement<br />
d’interprétation ne remettait pas en cause, bien au contraire, le paradigme kossinien sur lequel<br />
la thèse migrationniste elle-même s’était construite: à savoir qu’on persistait à attribuer aux<br />
transformations des caractères typologiques de la culture matérielle le statut d’indicateur<br />
direct des changements culturels éprouvés par les populations qui l’avait produite 61 . Alors que<br />
les chercheurs des années 1920 et 1930 tiraient des phénomènes de rupture qu’il observaient<br />
dans la chronologie du mobilier métallique la conclusions qu’ils étaient provoqués par des<br />
migrations de populations, les chercheurs des années 1980, qui se pensaient beaucoup mieux<br />
informés, tiraient des phénomènes de continuité que mettait en évidence l’analyse fine des<br />
assemblages archéologique la conclusion symétrique que ces derniers étaient le résultat d’une<br />
évolution sur place des populations, assimilant les influences extérieures.<br />
Quelque chose n’allait pas avec cela, quelque chose qui choquait le raisonnement<br />
archéologique. Le premier problème tenait à l’interprétation des processus en cause dans les<br />
phénomènes de changement culturels, qui étaient ramenés à une seul et unique origine.<br />
L’interprétation des données était piégée dans un raisonnement circulaire, d’où elle ne pouvait<br />
sortir : dans la mesure où les transformations stylistiques étaient interprétées comme le<br />
résultat plus ou moins direct d’événénements historiques particuliers, la nécessaire unification<br />
des systèmes typo-chronologiques en usage dans les différentes régions aboutissait à une<br />
inéluctable unification des processus de changement culturels envisagés pour expliquer ces<br />
transformations.<br />
Une autre archéologie est possible<br />
Le grand historien de l’art allemand Aby Warburg – qui a initié au début du XX ème<br />
siècle le projet révolutionnaire d’une histoire de l’art fonctionnant comme une « biologie »<br />
des images, ou encore comme une anthropologie des représentations – a déclaré qu’il s’était<br />
engagé dans cette voie, parce qu’il était « sincèrement dégoûté » de « l’histoire de l’art<br />
esthétisante », dont il trouvait les débats et les controverses « stériles » 62 . Sans en être<br />
« dégoûté », je n’ai jamais été réellement satisfait par l’archéologie telle que j’ai pu la<br />
cotoyer, notamment en France, dans la mesure où elle m’a toujours paru dépenser beaucoup<br />
d’énergie à côté de son objet véritable. J’ai mis longtemps à me rendre compte qu’au delà du<br />
caractère traditionnellement historico-culturel de cette archéologie conventionnelle, c’est<br />
fondamentalement sa dimension « historique » qui me gênait et, plus exactement encore, c’est<br />
le discours historique conventionnel qui me met mal à l’aise lorsqu’il est surimposé au passé<br />
archéologique. Nous avons tous tellement été élevés dans le culte de l’histoire qu’il paraît<br />
aujourd’hui presque blasphématoire de dire que, dans l’archéologie, c’est la manière<br />
61 J’ai développé cette argumentation dans une contribution au colloque de l’AFEAF de Colmar, paru en 2003 :<br />
« Peuples », « cultures » et manifestations archéologiques de l’âge du Fer : Gustav Kossinna, Gordon Childe et<br />
nous. Dans PLOUIN S. et JUD P. (dir .) – Habitats, mobiliers et groupes régionaux à l’âge du Fer. Actes du<br />
XXe Colloque de l'Association Française pour l'Etude de l'Age du Fer (Colmar, 1996). Dijon, 20 ème supplément<br />
à la Revue Archéologique de l’Est, 2003, p. 231-239.<br />
62 GOMBRICH (1970) : 88.<br />
38