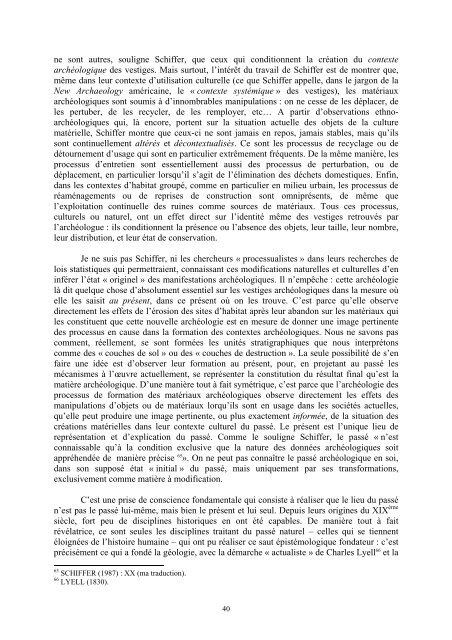Des vestiges
Des vestiges
Des vestiges
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ne sont autres, souligne Schiffer, que ceux qui conditionnent la création du contexte<br />
archéologique des <strong>vestiges</strong>. Mais surtout, l’intérêt du travail de Schiffer est de montrer que,<br />
même dans leur contexte d’utilisation culturelle (ce que Schiffer appelle, dans le jargon de la<br />
New Archaeology américaine, le « contexte systémique » des <strong>vestiges</strong>), les matériaux<br />
archéologiques sont soumis à d’innombrables manipulations : on ne cesse de les déplacer, de<br />
les pertuber, de les recycler, de les remployer, etc… A partir d’observations ethnoarchéologiques<br />
qui, là encore, portent sur la situation actuelle des objets de la culture<br />
matérielle, Schiffer montre que ceux-ci ne sont jamais en repos, jamais stables, mais qu’ils<br />
sont continuellement altérés et décontextualisés. Ce sont les processus de recyclage ou de<br />
détournement d’usage qui sont en particulier extrêmement fréquents. De la même manière, les<br />
processus d’entretien sont essentiellement aussi des processus de perturbation, ou de<br />
déplacement, en particulier lorsqu’il s’agit de l’élimination des déchets domestiques. Enfin,<br />
dans les contextes d’habitat groupé, comme en particulier en milieu urbain, les processus de<br />
réaménagements ou de reprises de construction sont omniprésents, de même que<br />
l’exploitation continuelle des ruines comme sources de matériaux. Tous ces processus,<br />
culturels ou naturel, ont un effet direct sur l’identité même des <strong>vestiges</strong> retrouvés par<br />
l’archéologue : ils conditionnent la présence ou l’absence des objets, leur taille, leur nombre,<br />
leur distribution, et leur état de conservation.<br />
Je ne suis pas Schiffer, ni les chercheurs « processualistes » dans leurs recherches de<br />
lois statistiques qui permettraient, connaissant ces modifications naturelles et culturelles d’en<br />
inférer l’état « originel » des manifestations archéologiques. Il n’empêche : cette archéologie<br />
là dit quelque chose d’absolument essentiel sur les <strong>vestiges</strong> archéologiques dans la mesure où<br />
elle les saisit au présent, dans ce présent où on les trouve. C’est parce qu’elle observe<br />
directement les effets de l’érosion des sites d’habitat après leur abandon sur les matériaux qui<br />
les constituent que cette nouvelle archéologie est en mesure de donner une image pertinente<br />
des processus en cause dans la formation des contextes archéologiques. Nous ne savons pas<br />
comment, réellement, se sont formées les unités stratigraphiques que nous interprétons<br />
comme des « couches de sol » ou des « couches de destruction ». La seule possibilité de s’en<br />
faire une idée est d’observer leur formation au présent, pour, en projetant au passé les<br />
mécanismes à l’œuvre actuellement, se représenter la constitution du résultat final qu’est la<br />
matière archéologique. D’une manière tout à fait symétrique, c’est parce que l’archéologie des<br />
processus de formation des matériaux archéologiques observe directement les effets des<br />
manipulations d’objets ou de matériaux lorqu’ils sont en usage dans les sociétés actuelles,<br />
qu’elle peut produire une image pertinente, ou plus exactement informée, de la situation des<br />
créations matérielles dans leur contexte culturel du passé. Le présent est l’unique lieu de<br />
représentation et d’explication du passé. Comme le souligne Schiffer, le passé « n’est<br />
connaissable qu’à la condition exclusive que la nature des données archéologiques soit<br />
appréhendée de manière précise 65 ». On ne peut pas connaître le passé archéologique en soi,<br />
dans son supposé état « initial » du passé, mais uniquement par ses transformations,<br />
exclusivement comme matière à modification.<br />
C’est une prise de conscience fondamentale qui consiste à réaliser que le lieu du passé<br />
n’est pas le passé lui-même, mais bien le présent et lui seul. Depuis leurs origines du XIX ème<br />
siècle, fort peu de disciplines historiques en ont été capables. De manière tout à fait<br />
révélatrice, ce sont seules les disciplines traitant du passé naturel – celles qui se tiennent<br />
éloignées de l’histoire humaine – qui ont pu réaliser ce saut épistémologique fondateur : c’est<br />
précisément ce qui a fondé la géologie, avec la démarche « actualiste » de Charles Lyell 66 et la<br />
65 SCHIFFER (1987) : XX (ma traduction).<br />
66 LYELL (1830).<br />
40