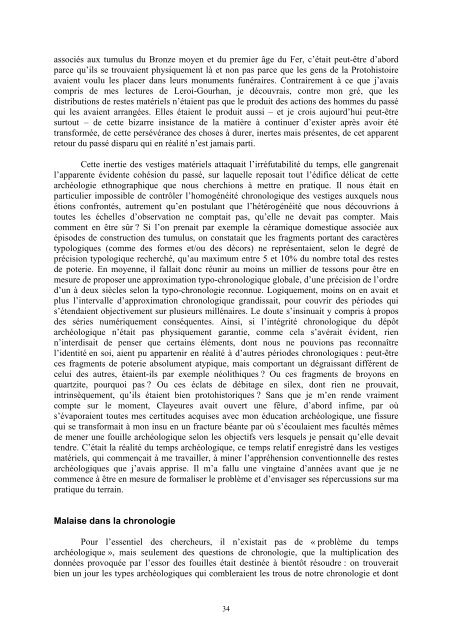Des vestiges
Des vestiges
Des vestiges
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
associés aux tumulus du Bronze moyen et du premier âge du Fer, c’était peut-être d’abord<br />
parce qu’ils se trouvaient physiquement là et non pas parce que les gens de la Protohistoire<br />
avaient voulu les placer dans leurs monuments funéraires. Contrairement à ce que j’avais<br />
compris de mes lectures de Leroi-Gourhan, je découvrais, contre mon gré, que les<br />
distributions de restes matériels n’étaient pas que le produit des actions des hommes du passé<br />
qui les avaient arrangées. Elles étaient le produit aussi – et je crois aujourd’hui peut-être<br />
surtout – de cette bizarre insistance de la matière à continuer d’exister après avoir été<br />
transformée, de cette persévérance des choses à durer, inertes mais présentes, de cet apparent<br />
retour du passé disparu qui en réalité n’est jamais parti.<br />
Cette inertie des <strong>vestiges</strong> matériels attaquait l’irréfutabilité du temps, elle gangrenait<br />
l’apparente évidente cohésion du passé, sur laquelle reposait tout l’édifice délicat de cette<br />
archéologie ethnographique que nous cherchions à mettre en pratique. Il nous était en<br />
particulier impossible de contrôler l’homogénéité chronologique des <strong>vestiges</strong> auxquels nous<br />
étions confrontés, autrement qu’en postulant que l’hétérogénéité que nous découvrions à<br />
toutes les échelles d’observation ne comptait pas, qu’elle ne devait pas compter. Mais<br />
comment en être sûr ? Si l’on prenait par exemple la céramique domestique associée aux<br />
épisodes de construction des tumulus, on constatait que les fragments portant des caractères<br />
typologiques (comme des formes et/ou des décors) ne représentaient, selon le degré de<br />
précision typologique recherché, qu’au maximum entre 5 et 10% du nombre total des restes<br />
de poterie. En moyenne, il fallait donc réunir au moins un millier de tessons pour être en<br />
mesure de proposer une approximation typo-chronologique globale, d’une précision de l’ordre<br />
d’un à deux siècles selon la typo-chronologie reconnue. Logiquement, moins on en avait et<br />
plus l’intervalle d’approximation chronologique grandissait, pour couvrir des périodes qui<br />
s’étendaient objectivement sur plusieurs millénaires. Le doute s’insinuait y compris à propos<br />
des séries numériquement conséquentes. Ainsi, si l’intégrité chronologique du dépôt<br />
archéologique n’était pas physiquement garantie, comme cela s’avérait évident, rien<br />
n’interdisait de penser que certains éléments, dont nous ne pouvions pas reconnaître<br />
l’identité en soi, aient pu appartenir en réalité à d’autres périodes chronologiques : peut-être<br />
ces fragments de poterie absolument atypique, mais comportant un dégraissant différent de<br />
celui des autres, étaient-ils par exemple néolithiques ? Ou ces fragments de broyons en<br />
quartzite, pourquoi pas ? Ou ces éclats de débitage en silex, dont rien ne prouvait,<br />
intrinsèquement, qu’ils étaient bien protohistoriques ? Sans que je m’en rende vraiment<br />
compte sur le moment, Clayeures avait ouvert une fêlure, d’abord infime, par où<br />
s’évaporaient toutes mes certitudes acquises avec mon éducation archéologique, une fissure<br />
qui se transformait à mon insu en un fracture béante par où s’écoulaient mes facultés mêmes<br />
de mener une fouille archéologique selon les objectifs vers lesquels je pensait qu’elle devait<br />
tendre. C’était la réalité du temps archéologique, ce temps relatif enregistré dans les <strong>vestiges</strong><br />
matériels, qui commençait à me travailler, à miner l’appréhension conventionnelle des restes<br />
archéologiques que j’avais apprise. Il m’a fallu une vingtaine d’années avant que je ne<br />
commence à être en mesure de formaliser le problème et d’envisager ses répercussions sur ma<br />
pratique du terrain.<br />
Malaise dans la chronologie<br />
Pour l’essentiel des chercheurs, il n’existait pas de « problème du temps<br />
archéologique », mais seulement des questions de chronologie, que la multiplication des<br />
données provoquée par l’essor des fouilles était destinée à bientôt résoudre : on trouverait<br />
bien un jour les types archéologiques qui combleraient les trous de notre chronologie et dont<br />
34