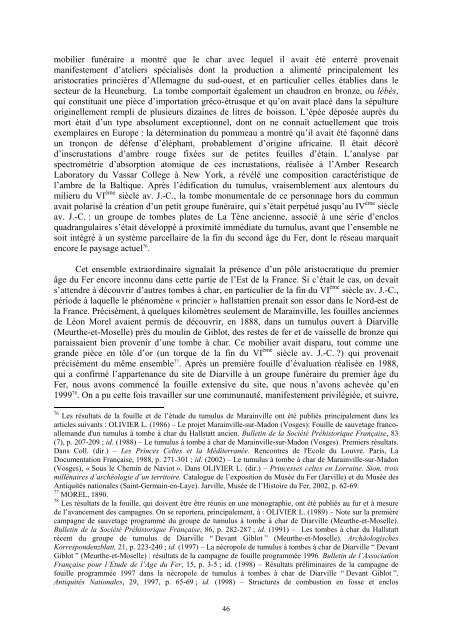Des vestiges
Des vestiges
Des vestiges
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
mobilier funéraire a montré que le char avec lequel il avait été enterré provenait<br />
manifestement d’ateliers spécialisés dont la production a alimenté principalement les<br />
aristocraties princières d’Allemagne du sud-ouest, et en particulier celles établies dans le<br />
secteur de la Heuneburg. La tombe comportait également un chaudron en bronze, ou lébès,<br />
qui constituait une pièce d’importation gréco-étrusque et qu’on avait placé dans la sépulture<br />
originellement rempli de plusieurs dizaines de litres de boisson. L’épée déposée auprès du<br />
mort était d’un type absolument exceptionnel, dont on ne connaît actuellement que trois<br />
exemplaires en Europe : la détermination du pommeau a montré qu’il avait été façonné dans<br />
un tronçon de défense d’éléphant, probablement d’origine africaine. Il était décoré<br />
d’inscrustations d’ambre rouge fixées sur de petites feuilles d’étain. L’analyse par<br />
spectrométrie d’absorption atomique de ces incrustations, réalisée à l’Amber Research<br />
Laboratory du Vassar College à New York, a révélé une composition caractéristique de<br />
l’ambre de la Baltique. Après l’édification du tumulus, vraisemblement aux alentours du<br />
milieru du VI ème siècle av. J.-C., la tombe monumentale de ce personnage hors du commun<br />
avait polarisé la création d’un petit groupe funéraire, qui s’était perpétué jusqu’au IV ème siècle<br />
av. J.-C. : un groupe de tombes plates de La Tène ancienne, associé à une série d’enclos<br />
quadrangulaires s’était développé à proximité immédiate du tumulus, avant que l’ensemble ne<br />
soit intégré à un système parcellaire de la fin du second âge du Fer, dont le réseau marquait<br />
encore le paysage actuel 76 .<br />
Cet ensemble extraordinaire signalait la présence d’un pôle aristocratique du premier<br />
âge du Fer encore inconnu dans cette partie de l’Est de la France. Si c’était le cas, on devait<br />
s’attendre à découvrir d’autres tombes à char, en particulier de la fin du VI ème siècle av. J.-C.,<br />
période à laquelle le phénomène « princier » hallstattien prenait son essor dans le Nord-est de<br />
la France. Précisément, à quelques kilomètres seulement de Marainville, les fouilles anciennes<br />
de Léon Morel avaient permis de découvrir, en 1888, dans un tumulus ouvert à Diarville<br />
(Meurthe-et-Moselle) près du moulin de Giblot, des restes de fer et de vaisselle de bronze qui<br />
paraissaient bien provenir d’une tombe à char. Ce mobilier avait disparu, tout comme une<br />
grande pièce en tôle d’or (un torque de la fin du VI ème siècle av. J.-C. ?) qui provenait<br />
précisément du même ensemble 77 . Après un première fouille d’évaluation réalisée en 1988,<br />
qui a confirmé l’appartenance du site de Diarville à un groupe funéraire du premier âge du<br />
Fer, nous avons commencé la fouille extensive du site, que nous n’avons achevée qu’en<br />
1999 78 . On a pu cette fois travailler sur une communauté, manifestement privilégiée, et suivre,<br />
76 Les résultats de la fouille et de l’étude du tumulus de Marainville ont été publiés principalement dans les<br />
articles suivants : OLIVIER L. (1986) – Le projet Marainville-sur-Madon (Vosges): Fouille de sauvetage francoallemande<br />
d'un tumulus à tombe à char du Hallstatt ancien. Bulletin de la Société Préhistorique Française, 83<br />
(7), p. 207-209 ; id. (1988) – Le tumulus à tombe à char de Marainville-sur-Madon (Vosges). Premiers résultats.<br />
Dans Coll. (dir.) – Les Princes Celtes et la Méditerranée. Rencontres de l'Ecole du Louvre. Paris, La<br />
Documentation Française, 1988, p. 271-301 ; id. (2002) – Le tumulus à tombe à char de Marainville-sur-Madon<br />
(Vosges), « Sous le Chemin de Naviot ». Dans OLIVIER L. (dir.) – Princesses celtes en Lorraine. Sion, trois<br />
millénaires d’archéologie d’un territoire. Catalogue de l’exposition du Musée du Fer (Jarville) et du Musée des<br />
Antiquités nationales (Saint-Germain-en-Laye). Jarville, Musée de l’Histoire du Fer, 2002, p. 62-69.<br />
77 MOREL, 1890.<br />
78 Les résultats de la fouille, qui doivent être être réunis en une monographie, ont été publiés au fur et à mesure<br />
de l’avancement des campagnes. On se reportera, principalement, à : OLIVIER L. (1989) – Note sur la première<br />
campagne de sauvetage programmé du groupe de tumulus à tombe à char de Diarville (Meurthe-et-Moselle).<br />
Bulletin de la Société Préhistorique Française, 86, p. 282-287 ; id. (1991) – Les tombes à char du Hallstatt<br />
récent du groupe de tumulus de Diarville “ Devant Giblot ” (Meurthe-et-Moselle). Archäologisches<br />
Korrespondenzblatt, 21, p. 223-240 ; id. (1997) – La nécropole de tumulus à tombes à char de Diarville “ Devant<br />
Giblot ” (Meurthe-et-Moselle) : résultats de la campagne de fouille programmée 1996. Bulletin de l’Association<br />
Française pour l’Etude de l’Age du Fer, 15, p. 3-5 ; id. (1998) – Résultats préliminaires de la campagne de<br />
fouille programmée 1997 dans la nécropole de tumulus à tombes à char de Diarville “ Devant Giblot ”.<br />
Antiquités Nationales, 29, 1997, p. 65-69 ; id. (1998) – Structures de combustion en fosse et enclos<br />
46