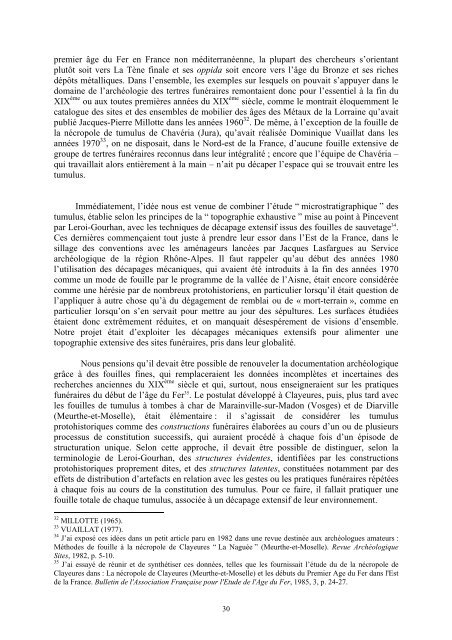Des vestiges
Des vestiges
Des vestiges
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
premier âge du Fer en France non méditerranéenne, la plupart des chercheurs s’orientant<br />
plutôt soit vers La Tène finale et ses oppida soit encore vers l’âge du Bronze et ses riches<br />
dépôts métalliques. Dans l’ensemble, les exemples sur lesquels on pouvait s’appuyer dans le<br />
domaine de l’archéologie des tertres funéraires remontaient donc pour l’essentiel à la fin du<br />
XIX ème ou aux toutes premières années du XIX ème siècle, comme le montrait éloquemment le<br />
catalogue des sites et des ensembles de mobilier des âges des Métaux de la Lorraine qu’avait<br />
publié Jacques-Pierre Millotte dans les années 1960 32 . De même, à l’exception de la fouille de<br />
la nécropole de tumulus de Chavéria (Jura), qu’avait réalisée Dominique Vuaillat dans les<br />
années 1970 33 , on ne disposait, dans le Nord-est de la France, d’aucune fouille extensive de<br />
groupe de tertres funéraires reconnus dans leur intégralité ; encore que l’équipe de Chavéria –<br />
qui travaillait alors entièrement à la main – n’ait pu décaper l’espace qui se trouvait entre les<br />
tumulus.<br />
Immédiatement, l’idée nous est venue de combiner l’étude “ microstratigraphique ” des<br />
tumulus, établie selon les principes de la “ topographie exhaustive ” mise au point à Pincevent<br />
par Leroi-Gourhan, avec les techniques de décapage extensif issus des fouilles de sauvetage 34 .<br />
Ces dernières commençaient tout juste à prendre leur essor dans l’Est de la France, dans le<br />
sillage des conventions avec les aménageurs lancées par Jacques Lasfargues au Service<br />
archéologique de la région Rhône-Alpes. Il faut rappeler qu’au début des années 1980<br />
l’utilisation des décapages mécaniques, qui avaient été introduits à la fin des années 1970<br />
comme un mode de fouille par le programme de la vallée de l’Aisne, était encore considérée<br />
comme une hérésie par de nombreux protohistoriens, en particulier lorsqu’il était question de<br />
l’appliquer à autre chose qu’à du dégagement de remblai ou de « mort-terrain », comme en<br />
particulier lorsqu’on s’en servait pour mettre au jour des sépultures. Les surfaces étudiées<br />
étaient donc extrêmement réduites, et on manquait désespérement de visions d’ensemble.<br />
Notre projet était d’exploiter les décapages mécaniques extensifs pour alimenter une<br />
topographie extensive des sites funéraires, pris dans leur globalité.<br />
Nous pensions qu’il devait être possible de renouveler la documentation archéologique<br />
grâce à des fouilles fines, qui remplaceraient les données incomplètes et incertaines des<br />
recherches anciennes du XIX ème siècle et qui, surtout, nous enseigneraient sur les pratiques<br />
funéraires du début de l’âge du Fer 35 . Le postulat développé à Clayeures, puis, plus tard avec<br />
les fouilles de tumulus à tombes à char de Marainville-sur-Madon (Vosges) et de Diarville<br />
(Meurthe-et-Moselle), était élémentaire : il s’agissait de considérer les tumulus<br />
protohistoriques comme des constructions funéraires élaborées au cours d’un ou de plusieurs<br />
processus de constitution successifs, qui auraient procédé à chaque fois d’un épisode de<br />
structuration unique. Selon cette approche, il devait être possible de distinguer, selon la<br />
terminologie de Leroi-Gourhan, des structures évidentes, identifiées par les constructions<br />
protohistoriques proprement dites, et des structures latentes, constituées notamment par des<br />
effets de distribution d’artefacts en relation avec les gestes ou les pratiques funéraires répétées<br />
à chaque fois au cours de la constitution des tumulus. Pour ce faire, il fallait pratiquer une<br />
fouille totale de chaque tumulus, associée à un décapage extensif de leur environnement.<br />
32 MILLOTTE (1965).<br />
33 VUAILLAT (1977).<br />
34 J’ai exposé ces idées dans un petit article paru en 1982 dans une revue destinée aux archéologues amateurs :<br />
Méthodes de fouille à la nécropole de Clayeures “ La Naguée ” (Meurthe-et-Moselle). Revue Archéologique<br />
Sites, 1982, p. 5-10.<br />
35 J’ai essayé de réunir et de synthétiser ces données, telles que les fournissait l’étude du de la nécropole de<br />
Clayeures dans : La nécropole de Clayeures (Meurthe-et-Moselle) et les débuts du Premier Age du Fer dans l'Est<br />
de la France. Bulletin de l'Association Française pour l'Etude de l'Age du Fer, 1985, 3, p. 24-27.<br />
30