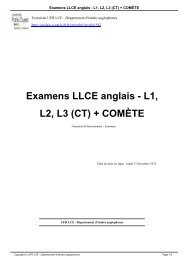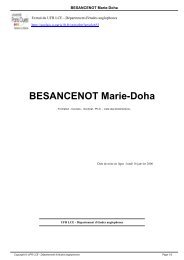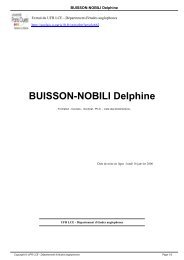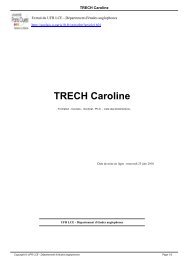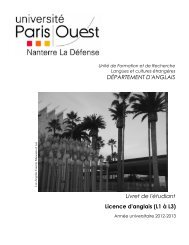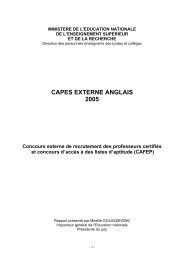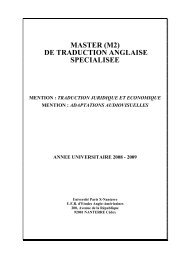Rapport du jury 2006 - Département d'études anglophones
Rapport du jury 2006 - Département d'études anglophones
Rapport du jury 2006 - Département d'études anglophones
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
spectateur un tableau ambigu des deux adversaires. Notre sympathie, tout au long de la scène, varie<br />
en permanence. Richard est-il un masochiste larmoyant qui rend trop vite les armes, animé par une<br />
pulsion catastrophiste ? Ou bien est-il contraint à l’impuissance par un manipulateur sournois ? Ni l’un<br />
ni l’autre, et un peu des deux… A la fin de l’extrait, le public se range plutôt aux côtés de Richard…<br />
encore que… tout dépend de la sensibilité de chacun, et de la mise en scène.<br />
2) Une double inversion visuelle<br />
Quoi qu’il en soit, l’enjeu principal est bien celui de la passation d’autorité. Le transfert de<br />
souveraineté s’opère ici sous la forme d’un double renversement. Tout au long de notre extrait, le haut<br />
devient bas, le bas devient haut. A l’échelle <strong>du</strong> corps, tout d’abord : on remarque un jeu cruel entre le<br />
genou posé au sol, signe de fausse obéissance, et la couronne (on retrouve la distinction<br />
shakespearienne classique entre le geste et l’intention, « for he may smile, and smile, and be a<br />
villain », dit Hamlet ; ici ce serait plutôt « for he may kneel, and kneel, and be a traitor »…) ;<br />
Bolingbroke plie le genou pour mieux s’élever — moquerie perfide bien perçue par Richard, qui<br />
observe : « Up cousin, up. Your heart is up, I know, / Thus high at least, although your knee be low »<br />
(194-5).<br />
Mais la chute la plus spectaculaire s’opère dans l’espace même de la représentation, que<br />
Shakespeare utilise à des fins dramaturgiques puissantes. Comme on le voit sur le célèbre dessin de<br />
Johannes de Witt, la scène élisabéthaine était surmontée d’une galerie, qui remplissait plusieurs<br />
fonctions selon les besoins : chambre à l’étage d’un bâtiment (c’est de là que Juliette, à la fenêtre,<br />
converse avec son Roméo), espace pour les musiciens, places de choix offertes aux spectateurs …<br />
Ici, la galerie figure les créneaux <strong>du</strong> château, et c’est là qu’apparaît Richard quelques temps avant<br />
notre extrait, comme le soleil rouge de la colère : « See, see, King Richard doth himself appear, / As<br />
doth the blushing discontented sun… » dit Bolingbroke (62-63). Les émissaires de Bolingbroke, quant<br />
à eux, entrent par le bas et lui parlent depuis la scène. Le rapport d’autorité, pleinement vertical, a<br />
encore cours pendant les négociations. Puis Richard descend dans ce qui est techniquement et<br />
métaphoriquement la… « basse cour » (« base court », c’est-à-dire les quartiers des domestiques), et<br />
pendant quelques instants échappe aux regards des spectateurs : c’est une véritable éclipse de<br />
royauté que met en scène Shakespeare ; elle prépare la chute de Richard, et l’ascension<br />
concomitante de Bolingbroke. Il faut apprécier pleinement l’effet sur scène de cette descente, de cette<br />
chute tragique : un long silence de malaise qui symbolise la vacance d’autorité (car il faut <strong>du</strong> temps--<br />
bien plus que l’échange entre Bolingbroke et Northumberland ([183-5]--pour que Richard et sa suite<br />
descendent par l’escalier intérieur). Tout cela est appuyé par la polysémie, très souvent exploitée<br />
dans le théâtre élisabéthain, <strong>du</strong> mot « base » (à la fois bas et vil), repris plusieurs fois et glosé par<br />
Richard : « Base court where kings grow base… » (180), basse cour où s’avilissent les rois vaincus<br />
(et plus tard, « you debase your princely knee / To make the base earth proud with kissing it » [190-<br />
1]).<br />
Dans sa fantaisie grandiloquente, cette chute est relayée sémantiquement par la référence<br />
mythologique à Phaéton, fils d’Hélios, le dieu soleil (« Down, down I come, like glist’ring Phaëton… »,<br />
178) qui revêt ici un double sens : a) moi, Richard, je tombe de n’avoir pas su diriger les rênes <strong>du</strong><br />
pouvoir et b) sens proleptique, car l’histoire originale de Phaéton est une dénonciation de l’hubris (ou<br />
démesure, comme celle de Prométhée qui voulait dérober aux dieux leur pouvoir) et de l’usurpation :<br />
Bolingbroke lui aussi tombera, par présomption et incompétence. Source de lumière et d’énergie, le<br />
soleil est, avec l’eau, l’un des réseaux d’images les plus importants de la pièce. Emblème de la<br />
majesté royale (« the searching eye of heaven », III,2,37), il fonctionne ici comme réflecteur ironique<br />
- 44 -