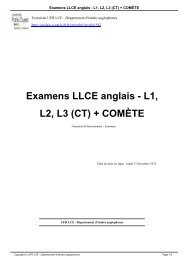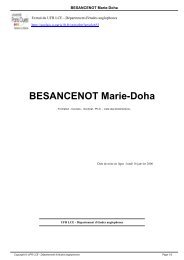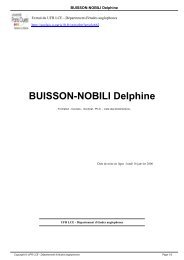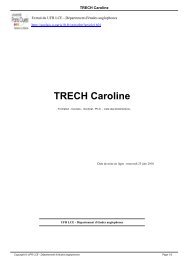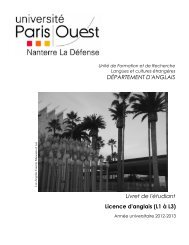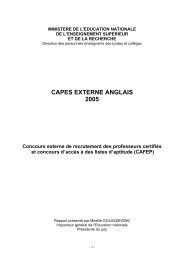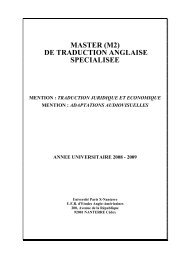Rapport du jury 2006 - Département d'études anglophones
Rapport du jury 2006 - Département d'études anglophones
Rapport du jury 2006 - Département d'études anglophones
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
que sur ses propres émotions (« I’ll give thee scope to beat », 140). Acteur grandiloquent, il est aussi<br />
spectateur désabusé de sa propre déconfiture.<br />
C’est pourquoi dans la longue tirade qui suit, il met à distance sa royauté à la troisième<br />
personne. Rien à voir ici avec l’ « illeism » que pratiquait Jules César, forme de glorification officielle,<br />
comme s’il était historiographe de son propre destin ; la troisième personne signale que Richard, tout<br />
simplement, n’est plus tout à fait ce Roi (« the King ») dont il parle, comme si les événements se<br />
déroulaient sans lui, comme si la passation de pouvoir obéissait à des mécanismes sur lesquels il n’a<br />
plus aucune prise : on remarquera l’usage constant des auxiliaires de mode (« Must he submit ? / The<br />
King shall do it. Must he be deposed ? / The King shall be contented. », 143-4) qui présentent le<br />
processus comme in<strong>du</strong>it par une obligation extérieure à laquelle on peut se résigner, somme toute,<br />
confortablement (même si l’on perçoit de la douleur dans cet enchaînement régulier, mécanique, de<br />
questions et de réponses). L’étape la plus importante, mise en relief par l’enjambement (« Must he<br />
lose / The name of King ? », 145-6), c’est la perte <strong>du</strong> titre, fatale dans une société fondée sur le code<br />
de chevalerie, sur la belle stabilité des signes, et pour un roi attaché au pouvoir créateur des mots.<br />
Mais le comble <strong>du</strong> désespoir pour un roi de droit divin, c’est de se rendre compte, implicitement, que<br />
tout cela se fait avec le consentement de Dieu ; d’où l’exclamation de dépit jouant sur la polysémie de<br />
« name » : « I’God’s name, let it go » (146).<br />
Roi, avec ou sans majuscule, Richard ne l’est plus, et d’ailleurs les deux seules occurrences<br />
<strong>du</strong> terme jusqu’à la fin de la scène seront une désignation générique (« the King’s highway », 155) et,<br />
dans un sursaut d’ironie révélateur… « King Bolingbroke » (173). Dans la tirade qui suit on note la<br />
réapparition <strong>du</strong> sujet de première personne, et un modal fortement teinté de volonté (« I’ll give my<br />
jewels for a set of beads… » 147), car Richard souhaiterait mettre en œuvre cette déchéance au lieu<br />
de la subir ; mais il ne possède même plus ce pouvoir, il ne peut qu’en rêver, déployant avec<br />
éloquence tout une fantaisie de l’évanouissement, vaste anaphore qui parcourt et annule tous les<br />
attributs symboliques, toutes les prérogatives <strong>du</strong> souverain : <strong>du</strong> faste royal au statut d’humble<br />
pénitent. Le choix d’une thématique religieuse n’est pas innocent de la part d’un roi qui plus tard se<br />
présentera comme une figure christique (cf. IV,1,239 « Though some, with Pilate, wash your<br />
hands… »). On a l’impression qu’il cherche à sa souffrance une identité plus digne de la porter : non<br />
plus ce roi dont les beaux vêtements l’humilient et conviendraient mieux à son rival, mais un frère<br />
retiré dans un monastère, soumis à l’autorité <strong>du</strong> frère prieur, occupé seulement à méditer devant ses<br />
images de dévotion. Terme à terme (« My gorgeous palace for a hermitage, / My gay apparel for an<br />
almsman’s gown… », 148-9) Richard aspire à une condition plus obscure, jusqu’à un basculement<br />
dans la logique <strong>du</strong> discours. « And my large kingdom for a little… » cell ? Non, ce n’est pas le mot<br />
atten<strong>du</strong> : « for a little grave » (153). La mort remplace l’humilité, la mort finalement moins douloureuse<br />
que le souvenir permanent de son échec. Encore une fois c’est avec les complaisances d’une de ses<br />
figures préférées, l’epizeuxis, que Richard l’envisage : « a little, little grave, an obscure grave » (154).<br />
4) Qui peut décider <strong>du</strong> sort des rois ?<br />
Tout l’extrait, nous l’avons vu, montre Richard écartelé entre la bravade, la soumission<br />
volontaire et le retranchement derrière un déterminisme trop puissant pour être combattu. Ecartelé, ou<br />
plutôt passant de l’un à l’autre, comme par exemple dans ce long développement sur les larmes<br />
royales (un des thèmes fondamentaux de la pièce). Du fantasme de puissance thaumaturgique,<br />
surnaturelle, exercée à des fins de revanche (« our sighs and they shall lodge the summer corn… »,<br />
162), Richard évolue vite vers un repli réflexif, où les larmes, agrandies à l’échelle d’un ruisseau, ne<br />
servent plus qu’à creuser sa propre tombe et celle de son fidèle Aumerle (« to drop them still upon<br />
- 46 -