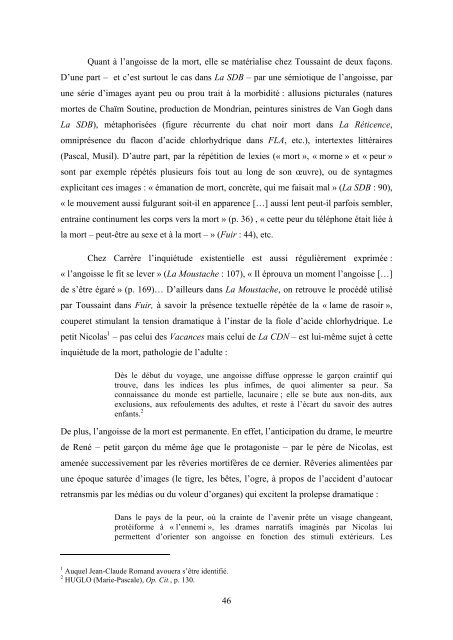Faculté de Philosophie et Lettres - Jean-Philippe Toussaint
Faculté de Philosophie et Lettres - Jean-Philippe Toussaint
Faculté de Philosophie et Lettres - Jean-Philippe Toussaint
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Quant à l’angoisse <strong>de</strong> la mort, elle se matérialise chez <strong>Toussaint</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux façons.<br />
D’une part – <strong>et</strong> c’est surtout le cas dans La SDB – par une sémiotique <strong>de</strong> l’angoisse, par<br />
une série d’images ayant peu ou prou trait à la morbidité : allusions picturales (natures<br />
mortes <strong>de</strong> Chaïm Soutine, production <strong>de</strong> Mondrian, peintures sinistres <strong>de</strong> Van Gogh dans<br />
La SDB), métaphorisées (figure récurrente du chat noir mort dans La Réticence,<br />
omniprésence du flacon d’aci<strong>de</strong> chlorhydrique dans FLA, <strong>et</strong>c.), intertextes littéraires<br />
(Pascal, Musil). D’autre part, par la répétition <strong>de</strong> lexies (« mort », « morne » <strong>et</strong> « peur »<br />
sont par exemple répétés plusieurs fois tout au long <strong>de</strong> son œuvre), ou <strong>de</strong> syntagmes<br />
explicitant ces images : « émanation <strong>de</strong> mort, concrète, qui me faisait mal » (La SDB : 90),<br />
« le mouvement aussi fulgurant soit-il en apparence […] aussi lent peut-il parfois sembler,<br />
entraine continument les corps vers la mort » (p. 36) , « c<strong>et</strong>te peur du téléphone était liée à<br />
la mort – peut-être au sexe <strong>et</strong> à la mort – » (Fuir : 44), <strong>et</strong>c.<br />
Chez Carrère l’inquiétu<strong>de</strong> existentielle est aussi régulièrement exprimée :<br />
« l’angoisse le fit se lever » (La Moustache : 107), « Il éprouva un moment l’angoisse […]<br />
<strong>de</strong> s’être égaré » (p. 169)… D’ailleurs dans La Moustache, on r<strong>et</strong>rouve le procédé utilisé<br />
par <strong>Toussaint</strong> dans Fuir, à savoir la présence textuelle répétée <strong>de</strong> la « lame <strong>de</strong> rasoir »,<br />
couper<strong>et</strong> stimulant la tension dramatique à l’instar <strong>de</strong> la fiole d’aci<strong>de</strong> chlorhydrique. Le<br />
p<strong>et</strong>it Nicolas 1 – pas celui <strong>de</strong>s Vacances mais celui <strong>de</strong> La CDN – est lui-même suj<strong>et</strong> à c<strong>et</strong>te<br />
inquiétu<strong>de</strong> <strong>de</strong> la mort, pathologie <strong>de</strong> l’adulte :<br />
Dès le début du voyage, une angoisse diffuse oppresse le garçon craintif qui<br />
trouve, dans les indices les plus infimes, <strong>de</strong> quoi alimenter sa peur. Sa<br />
connaissance du mon<strong>de</strong> est partielle, lacunaire ; elle se bute aux non-dits, aux<br />
exclusions, aux refoulements <strong>de</strong>s adultes, <strong>et</strong> reste à l’écart du savoir <strong>de</strong>s autres<br />
enfants. 2<br />
De plus, l’angoisse <strong>de</strong> la mort est permanente. En eff<strong>et</strong>, l’anticipation du drame, le meurtre<br />
<strong>de</strong> René – p<strong>et</strong>it garçon du même âge que le protagoniste – par le père <strong>de</strong> Nicolas, est<br />
amenée successivement par les rêveries mortifères <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier. Rêveries alimentées par<br />
une époque saturée d’images (le tigre, les bêtes, l’ogre, à propos <strong>de</strong> l’acci<strong>de</strong>nt d’autocar<br />
r<strong>et</strong>ransmis par les médias ou du voleur d’organes) qui excitent la prolepse dramatique :<br />
Dans le pays <strong>de</strong> la peur, où la crainte <strong>de</strong> l’avenir prête un visage changeant,<br />
protéiforme à « l’ennemi », les drames narratifs imaginés par Nicolas lui<br />
perm<strong>et</strong>tent d’orienter son angoisse en fonction <strong>de</strong>s stimuli extérieurs. Les<br />
<br />
1 Auquel <strong>Jean</strong>-Clau<strong>de</strong> Romand avouera s’être i<strong>de</strong>ntifié.<br />
2 HUGLO (Marie-Pascale), Op. Cit., p. 130.<br />
46