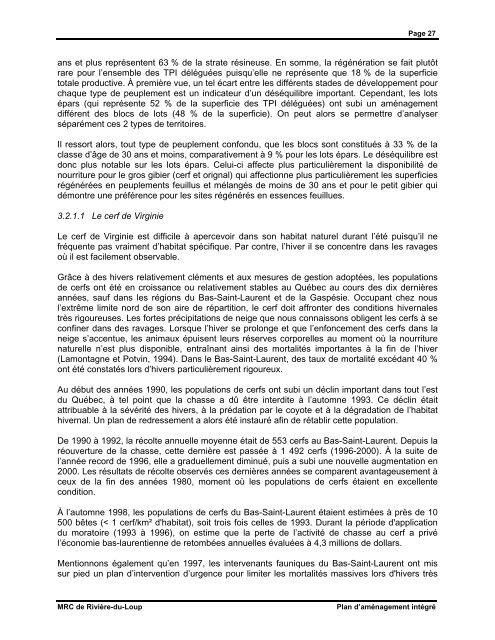Plan d'aménagement intégré - MRC de Rivière-du-Loup
Plan d'aménagement intégré - MRC de Rivière-du-Loup
Plan d'aménagement intégré - MRC de Rivière-du-Loup
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Page 27<br />
ans et plus représentent 63 % <strong>de</strong> la strate résineuse. En somme, la régénération se fait plutôt<br />
rare pour l’ensemble <strong>de</strong>s TPI déléguées puisqu’elle ne représente que 18 % <strong>de</strong> la superficie<br />
totale pro<strong>du</strong>ctive. À première vue, un tel écart entre les différents sta<strong>de</strong>s <strong>de</strong> développement pour<br />
chaque type <strong>de</strong> peuplement est un indicateur d’un déséquilibre important. Cependant, les lots<br />
épars (qui représente 52 % <strong>de</strong> la superficie <strong>de</strong>s TPI déléguées) ont subi un aménagement<br />
différent <strong>de</strong>s blocs <strong>de</strong> lots (48 % <strong>de</strong> la superficie). On peut alors se permettre d’analyser<br />
séparément ces 2 types <strong>de</strong> territoires.<br />
Il ressort alors, tout type <strong>de</strong> peuplement confon<strong>du</strong>, que les blocs sont constitués à 33 % <strong>de</strong> la<br />
classe d’âge <strong>de</strong> 30 ans et moins, comparativement à 9 % pour les lots épars. Le déséquilibre est<br />
donc plus notable sur les lots épars. Celui-ci affecte plus particulièrement la disponibilité <strong>de</strong><br />
nourriture pour le gros gibier (cerf et orignal) qui affectionne plus particulièrement les superficies<br />
régénérées en peuplements feuillus et mélangés <strong>de</strong> moins <strong>de</strong> 30 ans et pour le petit gibier qui<br />
démontre une préférence pour les sites régénérés en essences feuillues.<br />
3.2.1.1 Le cerf <strong>de</strong> Virginie<br />
Le cerf <strong>de</strong> Virginie est difficile à apercevoir dans son habitat naturel <strong>du</strong>rant l’été puisqu’il ne<br />
fréquente pas vraiment d’habitat spécifique. Par contre, l’hiver il se concentre dans les ravages<br />
où il est facilement observable.<br />
Grâce à <strong>de</strong>s hivers relativement cléments et aux mesures <strong>de</strong> gestion adoptées, les populations<br />
<strong>de</strong> cerfs ont été en croissance ou relativement stables au Québec au cours <strong>de</strong>s dix <strong>de</strong>rnières<br />
années, sauf dans les régions <strong>du</strong> Bas-Saint-Laurent et <strong>de</strong> la Gaspésie. Occupant chez nous<br />
l’extrême limite nord <strong>de</strong> son aire <strong>de</strong> répartition, le cerf doit affronter <strong>de</strong>s conditions hivernales<br />
très rigoureuses. Les fortes précipitations <strong>de</strong> neige que nous connaissons obligent les cerfs à se<br />
confiner dans <strong>de</strong>s ravages. Lorsque l’hiver se prolonge et que l’enfoncement <strong>de</strong>s cerfs dans la<br />
neige s’accentue, les animaux épuisent leurs réserves corporelles au moment où la nourriture<br />
naturelle n’est plus disponible, entraînant ainsi <strong>de</strong>s mortalités importantes à la fin <strong>de</strong> l’hiver<br />
(Lamontagne et Potvin, 1994). Dans le Bas-Saint-Laurent, <strong>de</strong>s taux <strong>de</strong> mortalité excédant 40 %<br />
ont été constatés lors d’hivers particulièrement rigoureux.<br />
Au début <strong>de</strong>s années 1990, les populations <strong>de</strong> cerfs ont subi un déclin important dans tout l’est<br />
<strong>du</strong> Québec, à tel point que la chasse a dû être interdite à l’automne 1993. Ce déclin était<br />
attribuable à la sévérité <strong>de</strong>s hivers, à la prédation par le coyote et à la dégradation <strong>de</strong> l’habitat<br />
hivernal. Un plan <strong>de</strong> redressement a alors été instauré afin <strong>de</strong> rétablir cette population.<br />
De 1990 à 1992, la récolte annuelle moyenne était <strong>de</strong> 553 cerfs au Bas-Saint-Laurent. Depuis la<br />
réouverture <strong>de</strong> la chasse, cette <strong>de</strong>rnière est passée à 1 492 cerfs (1996-2000). À la suite <strong>de</strong><br />
l’année record <strong>de</strong> 1996, elle a gra<strong>du</strong>ellement diminué, puis a subi une nouvelle augmentation en<br />
2000. Les résultats <strong>de</strong> récolte observés ces <strong>de</strong>rnières années se comparent avantageusement à<br />
ceux <strong>de</strong> la fin <strong>de</strong>s années 1980, moment où les populations <strong>de</strong> cerfs étaient en excellente<br />
condition.<br />
À l’automne 1998, les populations <strong>de</strong> cerfs <strong>du</strong> Bas-Saint-Laurent étaient estimées à près <strong>de</strong> 10<br />
500 bêtes (< 1 cerf/km² d'habitat), soit trois fois celles <strong>de</strong> 1993. Durant la pério<strong>de</strong> d'application<br />
<strong>du</strong> moratoire (1993 à 1996), on estime que la perte <strong>de</strong> l’activité <strong>de</strong> chasse au cerf a privé<br />
l’économie bas-laurentienne <strong>de</strong> retombées annuelles évaluées à 4,3 millions <strong>de</strong> dollars.<br />
Mentionnons également qu’en 1997, les intervenants fauniques <strong>du</strong> Bas-Saint-Laurent ont mis<br />
sur pied un plan d’intervention d’urgence pour limiter les mortalités massives lors d'hivers très<br />
<strong>MRC</strong> <strong>de</strong> <strong>Rivière</strong>-<strong>du</strong>-<strong>Loup</strong> <strong>Plan</strong> d’aménagement <strong>intégré</strong>