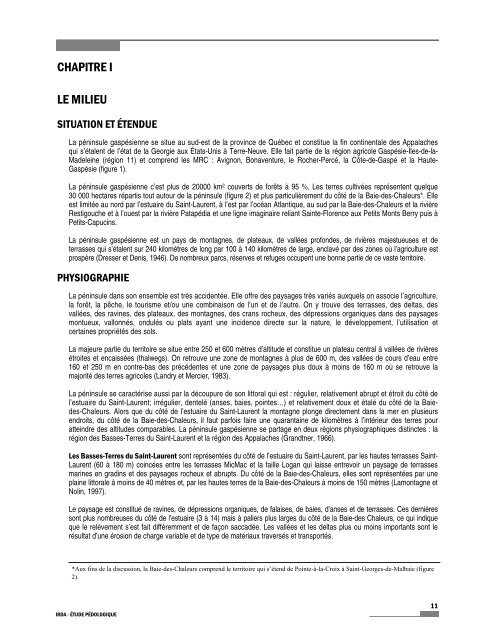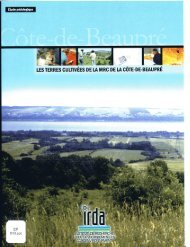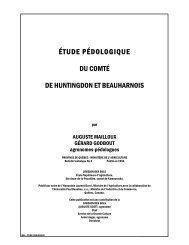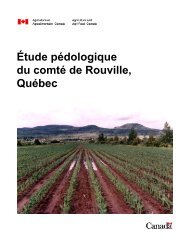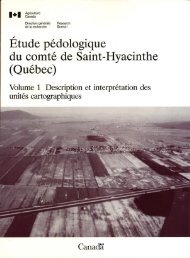Étude pédologique, les terres cultivées de la Péninsule Gaspésienne
Étude pédologique, les terres cultivées de la Péninsule Gaspésienne
Étude pédologique, les terres cultivées de la Péninsule Gaspésienne
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
CHAPITRE I<br />
LE MILIEU<br />
SITUATION ET ÉTENDUE<br />
La péninsule gaspésienne se situe au sud-est <strong>de</strong> <strong>la</strong> province <strong>de</strong> Québec et constitue <strong>la</strong> fin continentale <strong>de</strong>s Appa<strong>la</strong>ches<br />
qui s’étalent <strong>de</strong> l’état <strong>de</strong> <strong>la</strong> Georgie aux États-Unis à Terre-Neuve. Elle fait partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> région agricole Gaspésie-Î<strong>les</strong>-<strong>de</strong>-<strong>la</strong>-<br />
Ma<strong>de</strong>leine (région 11) et comprend <strong>les</strong> MRC : Avignon, Bonaventure, le Rocher-Percé, <strong>la</strong> Côte-<strong>de</strong>-Gaspé et <strong>la</strong> Haute-<br />
Gaspésie (figure 1).<br />
La péninsule gaspésienne c’est plus <strong>de</strong> 20000 km 2 couverts <strong>de</strong> forêts à 95 %. Les <strong>terres</strong> <strong>cultivées</strong> représentent quelque<br />
30 000 hectares répartis tout autour <strong>de</strong> <strong>la</strong> péninsule (figure 2) et plus particulièrement du côté <strong>de</strong> <strong>la</strong> Baie-<strong>de</strong>s-Chaleurs*. Elle<br />
est limitée au nord par l’estuaire du Saint-Laurent, à l’est par l’océan At<strong>la</strong>ntique, au sud par <strong>la</strong> Baie-<strong>de</strong>s-Chaleurs et <strong>la</strong> rivière<br />
Restigouche et à l’ouest par <strong>la</strong> rivière Patapédia et une ligne imaginaire reliant Sainte-Florence aux Petits Monts Berry puis à<br />
Petits-Capucins.<br />
La péninsule gaspésienne est un pays <strong>de</strong> montagnes, <strong>de</strong> p<strong>la</strong>teaux, <strong>de</strong> vallées profon<strong>de</strong>s, <strong>de</strong> rivières majestueuses et <strong>de</strong><br />
terrasses qui s’étalent sur 240 kilomètres <strong>de</strong> long par 100 à 140 kilomètres <strong>de</strong> <strong>la</strong>rge, enc<strong>la</strong>vé par <strong>de</strong>s zones où l’agriculture est<br />
prospère (Dresser et Denis, 1946). De nombreux parcs, réserves et refuges occupent une bonne partie <strong>de</strong> ce vaste territoire.<br />
PHYSIOGRAPHIE<br />
La péninsule dans son ensemble est très acci<strong>de</strong>ntée. Elle offre <strong>de</strong>s paysages très variés auxquels on associe l’agriculture,<br />
<strong>la</strong> forêt, <strong>la</strong> pêche, le tourisme et/ou une combinaison <strong>de</strong> l’un et <strong>de</strong> l’autre. On y trouve <strong>de</strong>s terrasses, <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ltas, <strong>de</strong>s<br />
vallées, <strong>de</strong>s ravines, <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>teaux, <strong>de</strong>s montagnes, <strong>de</strong>s crans rocheux, <strong>de</strong>s dépressions organiques dans <strong>de</strong>s paysages<br />
montueux, vallonnés, ondulés ou p<strong>la</strong>ts ayant une inci<strong>de</strong>nce directe sur <strong>la</strong> nature, le développement, l’utilisation et<br />
certaines propriétés <strong>de</strong>s sols.<br />
La majeure partie du territoire se situe entre 250 et 600 mètres d’altitu<strong>de</strong> et constitue un p<strong>la</strong>teau central à vallées <strong>de</strong> rivières<br />
étroites et encaissées (thalwegs). On retrouve une zone <strong>de</strong> montagnes à plus <strong>de</strong> 600 m, <strong>de</strong>s vallées <strong>de</strong> cours d’eau entre<br />
160 et 250 m en contre-bas <strong>de</strong>s précé<strong>de</strong>ntes et une zone <strong>de</strong> paysages plus doux à moins <strong>de</strong> 160 m où se retrouve <strong>la</strong><br />
majorité <strong>de</strong>s <strong>terres</strong> agrico<strong>les</strong> (Landry et Mercier, 1983).<br />
La péninsule se caractérise aussi par <strong>la</strong> découpure <strong>de</strong> son littoral qui est : régulier, re<strong>la</strong>tivement abrupt et étroit du côté <strong>de</strong><br />
l’estuaire du Saint-Laurent; irrégulier, <strong>de</strong>ntelé (anses, baies, pointes…) et re<strong>la</strong>tivement doux et étalé du côté <strong>de</strong> <strong>la</strong> Baie<strong>de</strong>s-Chaleurs.<br />
Alors que du côté <strong>de</strong> l’estuaire du Saint-Laurent <strong>la</strong> montagne plonge directement dans <strong>la</strong> mer en plusieurs<br />
endroits, du côté <strong>de</strong> <strong>la</strong> Baie-<strong>de</strong>s-Chaleurs, il faut parfois faire une quarantaine <strong>de</strong> kilomètres à l’intérieur <strong>de</strong>s <strong>terres</strong> pour<br />
atteindre <strong>de</strong>s altitu<strong>de</strong>s comparab<strong>les</strong>. La péninsule gaspésienne se partage en <strong>de</strong>ux régions physiographiques distinctes : <strong>la</strong><br />
région <strong>de</strong>s Basses-Terres du Saint-Laurent et <strong>la</strong> région <strong>de</strong>s Appa<strong>la</strong>ches (Grandtner, 1966).<br />
Les Basses-Terres du Saint-Laurent sont représentées du côté <strong>de</strong> l’estuaire du Saint-Laurent, par <strong>les</strong> hautes terrasses Saint-<br />
Laurent (60 à 180 m) coincées entre <strong>les</strong> terrasses MicMac et <strong>la</strong> faille Logan qui <strong>la</strong>isse entrevoir un paysage <strong>de</strong> terrasses<br />
marines en gradins et <strong>de</strong>s paysages rocheux et abrupts. Du côté <strong>de</strong> <strong>la</strong> Baie-<strong>de</strong>s-Chaleurs, el<strong>les</strong> sont représentées par une<br />
p<strong>la</strong>ine littorale à moins <strong>de</strong> 40 mètres et, par <strong>les</strong> hautes <strong>terres</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Baie-<strong>de</strong>s-Chaleurs à moins <strong>de</strong> 150 mètres (Lamontagne et<br />
Nolin, 1997).<br />
Le paysage est constitué <strong>de</strong> ravines, <strong>de</strong> dépressions organiques, <strong>de</strong> fa<strong>la</strong>ises, <strong>de</strong> baies, d’anses et <strong>de</strong> terrasses. Ces <strong>de</strong>rnières<br />
sont plus nombreuses du côté <strong>de</strong> l’estuaire (3 à 14) mais à paliers plus <strong>la</strong>rges du côté <strong>de</strong> <strong>la</strong> Baie-<strong>de</strong>s Chaleurs, ce qui indique<br />
que le relèvement s’est fait différemment et <strong>de</strong> façon saccadée. Les vallées et <strong>les</strong> <strong>de</strong>ltas plus ou moins importants sont le<br />
résultat d’une érosion <strong>de</strong> charge variable et <strong>de</strong> type <strong>de</strong> matériaux traversés et transportés.<br />
*Aux fins <strong>de</strong> <strong>la</strong> discussion, <strong>la</strong> Baie-<strong>de</strong>s-Chaleurs comprend le territoire qui s’étend <strong>de</strong> Pointe-à-<strong>la</strong>-Croix à Saint-Georges-<strong>de</strong>-Malbaie (figure<br />
2).<br />
IRDA - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />
11