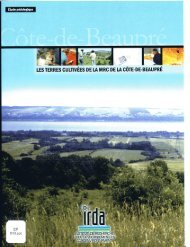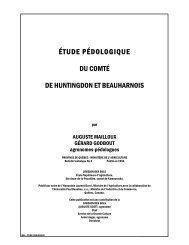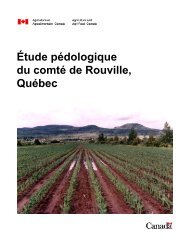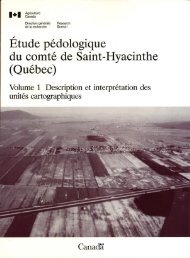Étude pédologique, les terres cultivées de la Péninsule Gaspésienne
Étude pédologique, les terres cultivées de la Péninsule Gaspésienne
Étude pédologique, les terres cultivées de la Péninsule Gaspésienne
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
VOIES DE COMMUNICATION<br />
La relief <strong>de</strong> <strong>la</strong> péninsule a eu une gran<strong>de</strong> influence sur le développement du réseau routier et l’occupation du territoire à<br />
différentes fins. En fait, <strong>les</strong> infrastructures routières se concentrent sur le pourtour <strong>de</strong> <strong>la</strong> péninsule alors que le centre n’est<br />
réellement pénétrable que par <strong>de</strong>s chemins forestiers.<br />
La route 132, dite route <strong>de</strong>s Pionniers, constitue <strong>la</strong> principale voie <strong>de</strong> communication et ceinture toute <strong>la</strong> péninsule en<br />
longeant le littoral. C’est le seul lien qui relie cette région au reste <strong>de</strong> <strong>la</strong> province. Cette même route donne également accès<br />
au Nouveau-Brunswick via le pont qui enjambe <strong>la</strong> Restigouche entre Pointe-à-<strong>la</strong>-Croix et Campbellton. La route 197 permet<br />
d’éviter le parc Forillon; <strong>la</strong> route 198 relie Gaspé à l’Anse Pleureuse et <strong>la</strong> route 299 aussi appelée, <strong>la</strong> trans-gaspésienne,<br />
rejoint Sainte-Anne-<strong>de</strong>s-Monts <strong>de</strong>puis New Richmond. Le réseau secondaire est assez bien développé et constitué <strong>de</strong> routes<br />
généralement perpendicu<strong>la</strong>ires au littoral; il est complété par quelques rangs grossièrement parallè<strong>les</strong> à <strong>la</strong> route 132. Ce<br />
réseau secondaire n’existe pratiquement pas du coté <strong>de</strong> l’estuaire et atteint sa pleine expansion du coté <strong>de</strong> <strong>la</strong> Baie-<strong>de</strong>s-<br />
Chaleurs, entre Carleton et Port-Daniel. Des chemins forestiers et <strong>de</strong>s sentiers pé<strong>de</strong>stres offrent <strong>la</strong> possibilité <strong>de</strong> pénétrer <strong>la</strong><br />
péninsule et ses nombreux parcs, refuges et réserves (Forillon, Baldwin, Port-Daniel, Chics-Chocs…).<br />
Parmi <strong>les</strong> autres infrastructures <strong>de</strong> transport, il y a <strong>la</strong> voie ferrée du CN qui s’anastomose à <strong>la</strong> route 132 <strong>de</strong>puis <strong>la</strong> vallée <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Matapédia jusqu’à Gaspé; <strong>de</strong>s aéroports pour petits transporteurs à Gaspé, Bonaventure, Pabok, Cap-<strong>de</strong>-<strong>la</strong>-Ma<strong>de</strong>leine,<br />
Sainte-Anne-<strong>de</strong>s-Monts; <strong>de</strong>s aéroports privés à quelques endroits sur le territoire et; <strong>de</strong>s eaux navigab<strong>les</strong> à <strong>de</strong>s fins<br />
récréatives et commercia<strong>les</strong> tout autour <strong>de</strong> <strong>la</strong> péninsule qui rejoignent <strong>de</strong>s marinas, <strong>de</strong>s havres et/ou <strong>de</strong>s ports plus ou moins<br />
importants. Comme partout ailleurs en province, <strong>de</strong>s lignes <strong>de</strong> transport d’électricité d’Hydro-Québec sillonnent le paysage.<br />
CLIMAT<br />
Le relief <strong>de</strong> <strong>la</strong> Gaspésie et l’eau qui l’entoure exercent une gran<strong>de</strong> influence sur son climat qui, pour l’ensemble du territoire,<br />
est <strong>de</strong> type continental humi<strong>de</strong>. Lamoureux (1985), l’associe par endroits à un climat boréal froid et d’autres auteurs, à un<br />
climat maritime, surtout du côté <strong>de</strong> <strong>la</strong> Baie-<strong>de</strong>s-Chaleurs. L’altitu<strong>de</strong>, l’exposition, <strong>les</strong> vents dominants, <strong>la</strong> situation autour <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
péninsule sont autant <strong>de</strong> facteurs contribuant aux variations loca<strong>les</strong> <strong>de</strong>s conditions climatiques qui ont influé sur le<br />
développement, l’évolution et l’utilisation <strong>de</strong>s sols. Le tableau qui suit donne un aperçu <strong>de</strong>s variations climatiques pour<br />
différentes stations <strong>de</strong> <strong>la</strong> péninsule. Il ressort du premier coup d’œil, que <strong>la</strong> Baie-<strong>de</strong>s-Chaleurs bénéficie d’un climat plus doux<br />
et plus humi<strong>de</strong> que <strong>la</strong> côte <strong>de</strong> l’estuaire du Saint-Laurent en dépit du fait que <strong>les</strong> températures moyennes ne diffèrent que par<br />
<strong>de</strong>s dixièmes <strong>de</strong> <strong>de</strong>grés. Les secteurs compris entre Sainte-Anne-<strong>de</strong>s-Monts et Cap-<strong>de</strong>-<strong>la</strong>-Ma<strong>de</strong>leine du côté <strong>de</strong> l’estuaire et,<br />
entre Port-Daniel et Nouvelle du côté <strong>de</strong> <strong>la</strong> Baie-<strong>de</strong>s-Chaleurs sont <strong>les</strong> plus favorisés au point climatique; Saint-Jean-<strong>de</strong>-<br />
Cherbourg est l’endroit le plus froid <strong>de</strong> <strong>la</strong> péninsule et Cap<strong>la</strong>n le plus chaud. Les différences majeures proviennent <strong>de</strong>s<br />
précipitations <strong>de</strong> pluies plus abondantes du côté <strong>de</strong> <strong>la</strong> Baie-<strong>de</strong>s-Chaleurs et <strong>de</strong>s chutes <strong>de</strong> neige plus importantes du côté <strong>de</strong><br />
l’estuaire du Saint-Laurent.<br />
La péninsule a <strong>les</strong> gels <strong>les</strong> plus tardifs et <strong>les</strong> plus hâtifs <strong>de</strong> <strong>la</strong> province <strong>de</strong> Québec. Selon Dubé et al. (1982) et d’autres<br />
sources, il peut geler entre <strong>les</strong> 8 et 16 mai à Cap<strong>la</strong>n et même jusqu’à <strong>la</strong> fin juin à Gaspé. À l’automne, <strong>les</strong> premières gelées<br />
apparaissent en septembre autour du 7 presque partout, Cap<strong>la</strong>n ayant <strong>les</strong> plus tardives. La longueur <strong>de</strong> <strong>la</strong> saison <strong>de</strong><br />
croissance sans gelée (base 0° C, prob. 50 %) varie <strong>de</strong> 64 à 152 jours; Cap<strong>la</strong>n, Sainte-Anne-<strong>de</strong>s-Monts et Gran<strong>de</strong>-Vallée<br />
étant <strong>les</strong> milieux <strong>les</strong> plus favorisés.<br />
La durée <strong>de</strong> <strong>la</strong> saison <strong>de</strong> croissance avec <strong>de</strong>s températures au-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong> 5° C tourne autour <strong>de</strong> 173 à 180 jours à Cap<strong>la</strong>n et<br />
<strong>de</strong> 159 et 173 jours ailleurs dans <strong>la</strong> péninsule (Montréal en compte 220). La somme <strong>de</strong>s <strong>de</strong>grés-jours annuels au-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong><br />
10° C, prob. 50 % passe par un minimum (515) du côté <strong>de</strong> l’estuaire et par un maximum (804) du côté <strong>de</strong> <strong>la</strong> Baie-<strong>de</strong>s-<br />
Chaleurs. Les unités thermiques maïs (UTM) oscillent entre 1200 et 1900 selon <strong>les</strong> secteurs. Les chiffres pour Québec et<br />
Montréal sont donnés à titre comparatif et montrent à quel point l’agriculture peut être tributaire <strong>de</strong>s conditions climatiques, du<br />
moins pour certaines productions.<br />
IRDA - ÉTUDE PÉDOLOGIQUE<br />
21