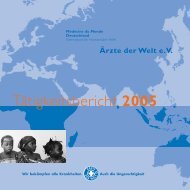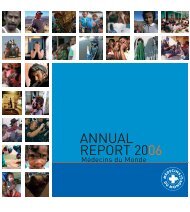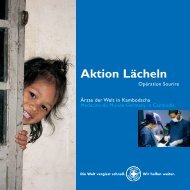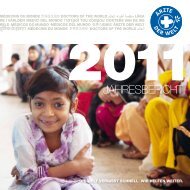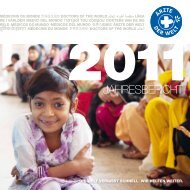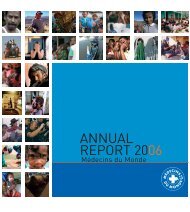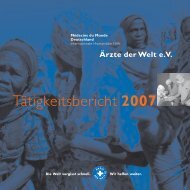MÃDECINS DU MONDE
MÃDECINS DU MONDE
MÃDECINS DU MONDE
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Personnes se prostituant<br />
RdR & Echange de seringues<br />
112/113<br />
Caractéristiques<br />
> population majoritairement originaire<br />
d’Europe de l’Est, d’Afrique<br />
subsaharienne et de Chine<br />
populaire, soit détentrice de visas<br />
de tourisme, soit en demande<br />
d’asile, soit en situation irrégulière,<br />
parfois victime de trafic<br />
Sexe, âge<br />
> très majoritairement des femmes<br />
de 20 à 40 ans, des transgenres,<br />
des hommes et parfois des mineurs<br />
Principales pathologies<br />
> gynécologiques ; pathologies<br />
liées aux conditions de la rue ;<br />
troubles psychiques liés au stress,<br />
à l’isolement et aux maltraitances ;<br />
addictions<br />
Nombre de missions<br />
> 6 équipes mobiles/missions<br />
intervenant auprès de personnes<br />
se prostituant, dans la rue, en lien<br />
souvent étroit avec les CASO et<br />
es programmes de réduction des<br />
risques liés à l’usage de drogues<br />
Nombre de bénéficiaires<br />
> données très difficiles à obtenir,<br />
sans doute près de 1 000<br />
Nombre de bénévoles<br />
> 117<br />
Partenaires<br />
> Cabiria, les Amis du bus<br />
des femmes, Aides, Ddass,<br />
Gasprom, Plate-forme de<br />
lutte contre la traite des êtres<br />
humains, CDAG, CPAM, mairies,<br />
planning familial, urgences<br />
psychiatriques, Samu social<br />
><br />
La loi de sécurité intérieure, qui a créé le délit de racolage passif, et la présence policière<br />
massive contribuent au contexte répressif qui restreint l’accès aux soins et au matériel de<br />
prévention des personnes se prostituant. Exposées aux risques d’infections sexuellement<br />
transmissibles, parfois toxicomanes, et dans certains cas victimes de trafics, ces personnes<br />
se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité, renforcée par leur criminalisation.<br />
Un soutien par la prévention et l’information<br />
Depuis 1999 en tant que thématique à part entière<br />
Activités : Dans un climat marqué par un net renforcement de la<br />
violence à leur encontre, les personnes se prostituant se trouvent<br />
en situation de grande vulnérabilité avec un accès plus difficile aux<br />
associations et au matériel de prévention. Les difficultés d’hébergement<br />
et la lenteur de l’ouverture des droits sont des obstacles<br />
supplémentaires à l’accès aux soins. L’action de Médecins du<br />
Monde se traduit notamment par des actions mobiles, de<br />
promotion de la santé et de réduction des risques liés aux<br />
pratiques prostitutionnelles, avec un accompagnement<br />
social, médical, administratif et juridique. Les équipes s’attachent<br />
à donner une information adaptée et traduite si nécessaire<br />
sur les risques liés aux IST, VIH, hépatites, et sur les droits.<br />
• Au Havre, MdM a dû cesser son activité, l’omniprésence policière<br />
ayant eu pour effet de faire complètement disparaître de la<br />
rue les personnes se prostituant.<br />
• A Poitiers, MdM, au sein du collectif l’Abri, a démarré une<br />
activité auprès de personnes se prostituant en septembre 2005.<br />
• A Rennes, la mission exploratoire menée en 2005 n’a pas<br />
débouché sur la mise en place d’un programme spécifique.<br />
Types d’interventions<br />
> Tous nos programmes proposent des orientations vers des dépistages<br />
(VIH, VHB, VHC), distribuent du matériel de prévention, font de l’écoute,<br />
de la promotion des droits de la personne, informent et orientent vers<br />
les structures de droit commun.<br />
> Metz : mise en place d’une structure itinérante avec Aides.<br />
> Montpellier : en plus des interventions en soirée dans le centre-ville,<br />
une sortie hebdomadaire, en journée, est organisée sur les routes nationales.<br />
> Nantes : accompagnement physique vers l’hôpital et pour toutes<br />
démarches de soins, d’accès aux droits, de dépôts de plainte, et dans<br />
les tribunaux pour les procès pour racolage. Aide à l’inscription à des<br />
cours d’alphabétisation. Mise en place d’ateliers santé thématiques.<br />
> Paris : information adaptée et traduite en chinois, accompagnement<br />
et orientation avec interprètes.<br />
> Poitiers : mise en place de maraudes au sein d’un collectif.<br />
> Rouen : mise en place d’un système d’alternance des sorties du bus,<br />
grâce à une synchronisation avec les actions de l’association Aides,<br />
et d’une mission de dépistage des maladies infectieuses.<br />
Perspectives :<br />
Les missions souhaitent<br />
travailler et développer<br />
le volet témoignage,<br />
notamment sur les<br />
conséquences de la loi<br />
de sécurité intérieure<br />
pour les personnes<br />
se prostituant, aux plans<br />
sanitaire et social.<br />
><br />
Le décret du 14 avril 2005 confère une reconnaissance législative à la politique de réduction<br />
des risques. Il est aujourd’hui démontré que les programmes d’échange de seringues sont<br />
efficaces : ils réduisent le partage de seringues et de pailles et, donc, le risque de transmission<br />
du sida ou de l’hépatite C. Ils limitent considérablement les risques d’overdose,<br />
ils permettent l’orientation des usagers de drogues vers les structures sanitaires et sociales.<br />
Cette approche en terme de santé publique permet aux usagers marginalisés d’avoir accès<br />
à des structures sociales, de soins, d’information, d’orientation et d’accompagnement.<br />
Aller vers une population marginalisée<br />
1996, cession de la licence du kit accès prévention au ministère de la Santé<br />
Activités : La distribution de matériel stérile, fondamentale<br />
pour réduire les risques liés à l’usage de produits,<br />
permet d’établir un contact avec une population souvent<br />
marginalisée qui, sans ces programmes, n’aurait pas accès<br />
à l’information et aux structures de prise en charge de droit<br />
commun. Le contact créé, les équipes peuvent alors transmettre<br />
de messages de prévention, écouter et orienter les usagers de drogues<br />
pour des questions d’ordre médical, social ou juridique : hébergement,<br />
ouverture de droits, régularisation des situations juridiques,<br />
sevrages, post-cures, traitements de substitution. A Paris, des tests<br />
salivaires de dépistage de l’hépatite C sont proposés et permettent,<br />
outre la prise en charge médicale en cas de résultat positif, de dialoguer<br />
avec la personne et de lui apporter une aide plus complète.<br />
D’autres outils sont utilisés dans cette démarche de réduction des<br />
risques en lien avec le contexte : pailles d’inhalation à destination<br />
des «sniffeurs», embouts de pipes à crack évitant les brûlures et les<br />
contaminations par le VHC, Sterifilt permettant de filtrer au bout de<br />
la seringue les substances non injectables. Les équipes de terrain<br />
effectuent constamment un travail de recherches et d’enquête sur les<br />
outils et les messages de prévention afin d’améliorer leur efficacité.<br />
Le travail de rue est souvent complémentaire du travail effectué dans<br />
les antennes mobiles.<br />
Types d’interventions<br />
> 4 structures mobiles : bus, camionnettes et équipes allant à pied<br />
au-devant des usagers de drogues dans la rue ou les squats.<br />
> 1 lieu fixe d’accueil de jour à Bordeaux, 1 lieu fixe pour l’échange<br />
de seringues à Paris et Marseille.<br />
> Mise à disposition de matériel d’injection stérile : tous les CASO.<br />
> 236 808 seringues données, 36% de seringues usagées rapportées.<br />
Perspectives :<br />
Favoriser les dispositifs facilitant<br />
les échanges avec les usagers<br />
sur le modèle des tests<br />
salivaires de dépistage de<br />
l’hépatite C. Le développement<br />
des polyconsommations<br />
nécessite la création de<br />
nouveaux outils, notamment<br />
liés à la consommation<br />
de crack. Depuis janvier 2006,<br />
les programmes d’échange<br />
de seringues sont reconnus<br />
comme établissements<br />
médico-sociaux et sont financés<br />
par l’assurance maladie,<br />
en tant que Caarud (Centre<br />
d’accueil et d’accompagnement<br />
de réduction des risques<br />
pour les usagers de drogues),<br />
sous condition de remplir les<br />
missions (accueil, orientation,<br />
accompagnement…).<br />
Dans le cadre du passage<br />
en Caarud, les programmes de<br />
Paris, Bordeaux et Marseille<br />
devraient quitter MdM en 2006<br />
et s’autonomiser en associations<br />
créées par les équipes de<br />
terrain soutenues par MdM.<br />
Pathologies<br />
les plus fréquentes<br />
> risques infectieux liés à l’usage<br />
de drogues par voie intraveineuse<br />
(VHC, VIH, VHB), abcès,<br />
comorbidités psychiatriques,<br />
problèmes dentaires, souffrance<br />
psychique liée à l’exclusion<br />
> risques de marginalisation, discrimination<br />
et dommages sociaux<br />
Constat de nos programmes<br />
> nette évolution vers une polyconsommation<br />
de produits injectés<br />
ou non. Persistance d’une forte<br />
prévalence de l’hépatite C chez<br />
les usagers injecteurs<br />
Nombre de bénéficiaires<br />
> file active de près de 2 600 UDVI<br />
pour plus de 12 500 passages sur<br />
les antennes mobiles et en lieux<br />
fixes. Plus de 19 000 autres<br />
passages (informations, orientations<br />
et demandes autres que du matériel)<br />
Nombre de bénévoles<br />
> 35 au sein d’équipes<br />
pluridisciplinaires<br />
Sources de financement<br />
> principalement l’Etat via la Ddass,<br />
les collectivités territoriales,<br />
les CPAM, le FNPEIS, les mairies,<br />
la Cramif<br />
Partenaires<br />
> ministère de la Santé (Direction<br />
générale de la santé), Mildt (Mission<br />
interministérielle de lutte contre<br />
la drogue et la toxicomanie), OFDT<br />
et toutes les structures de RdR<br />
des villes où nous sommes présents