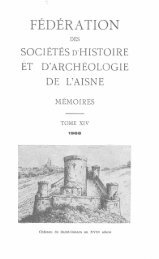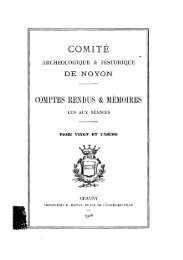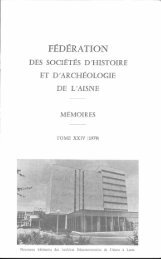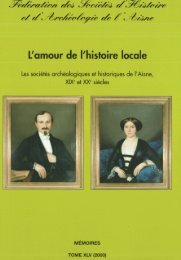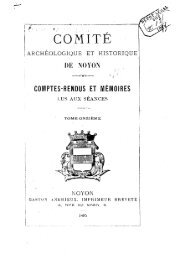lire - Free
lire - Free
lire - Free
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
14 JUIN 2003 : Le patrimoine militaire à Laon, visite organisée par le colonel<br />
Tyran.<br />
Après avoir présenté le patrimoine de l’ouest de la ville haute en juin 2002 par<br />
une belle journée ensoleillée, le colonel a poursuivi dans la partie est – la cité –<br />
cette année… mais sous la pluie !<br />
Sur la passerelle, boulevard Michelet, il a rappelé les principes de construction<br />
des fortifications, en particulier celui consistant à éviter les angles morts. À la<br />
porte des Chenizelles avec son système de défense, il a attiré notre attention sur<br />
l’étranglement de la butte à l’entrée de la Cité. C’était un lieu stratégique par<br />
excellence, et c’est pourquoi les Capétiens y installèrent le château royal avec la<br />
Tour dite de Louis d’Outremer, ensemble qui fut détruit au XIX e siècle pour laisser<br />
place à l’hôtel de ville. En longeant le rempart nord, un arrêt était de rigueur<br />
à la poterne du prévôt où se trouvait la maison du prévôt, représentant du roi<br />
imposé à la ville après les « Philippines » et la fin de la Commune. Le commentaire<br />
sur la « porte Germaine » a rappelé, face à la grande plaine du nord, l’importance<br />
du site de butte sur le chemin des invasions. Force est de constater que<br />
les remparts qui prolongent les versants abrupts rendaient la cité inexpugnable.<br />
La citadelle montre que les fortifications servaient aussi à combattre les ennemis<br />
de l’intérieur : Henri IV la fit élever afin qu’une garnison puisse surveiller les<br />
Laonnois entêtés catholiques, et les bastions, les fossés, le pont-levis attestent que<br />
l’ingénieur Estienne était loin d’être incompétent ! Sur place, ce fut l’occasion de<br />
rappeler sa réhabilitation en 1835-1847, l’explosion de la poudrière en septembre<br />
1870 et son intégration au système Séré de Rivières.<br />
18 SEPTEMBRE 2003 : De Marcel Proust à Vinteuil : une philosophie de la musique<br />
dans À la recherche du temps perdu, par M. Jean-Michel Verneiges.<br />
M. Verneiges s’est attaché à retracer la réflexion musicale de Proust qui a cherché<br />
à dégager la musique du décor des salons mondains pour la situer sur un plan<br />
supérieur.<br />
L’univers musical de Proust (1871-1922) rassemble tant des musiciens « plus<br />
conservateurs » comme Saint-Saëns, que des musiciens « plus modernes » comme<br />
Wagner, Stravinsky… Proust marque très jeune sa préférence pour ces derniers et<br />
pour la musique instrumentale sur la musique vocale, la première étant plus apte «<br />
à réveiller le fond mystérieux de l’âme ». Mais son univers musical ne se limite<br />
pas aux classiques. Proust appartient à une époque où la frontière entre les genres<br />
musicaux était plus perméable qu’aujourd’hui : il apprécie le music hall, antidote<br />
au monde des salons comme au mouvement poétique symboliste.<br />
Proust fait une grande place à la musique dans La recherche du temps perdu,<br />
roman qui révèle la quête du narrateur vers sa vocation d’écrivain, quête jalonnée<br />
par les mécanismes inconscients de la mémoire : odeur, saveur (la madeleine),<br />
phrases musicales… raniment le passé. La musique intervient dans le parcours<br />
amoureux de Swann puisque son amour pour Odette est ponctué par une sonate<br />
pour piano et violon du compositeur imaginaire Vinteuil, inspirée d’un thème de<br />
Saint-Saëns, d’une ballade de Fauré ainsi que d’autres œuvres (Parsifal). Elle<br />
196