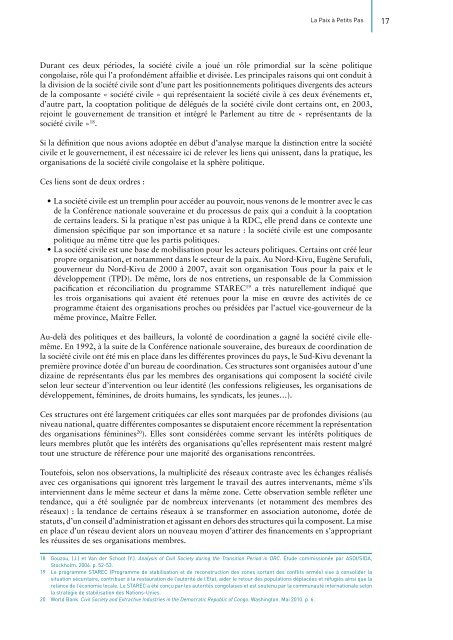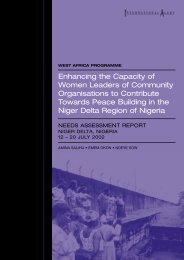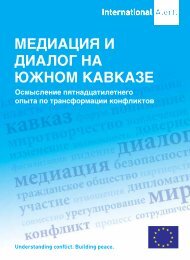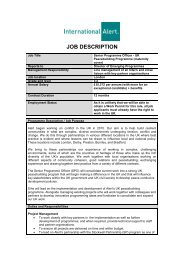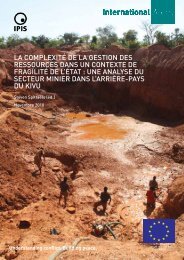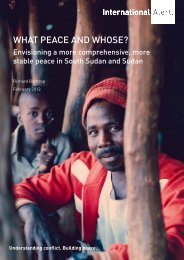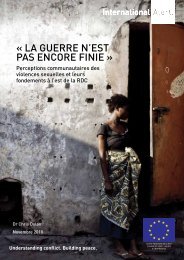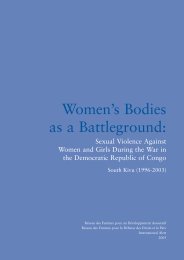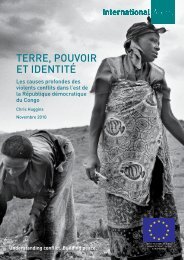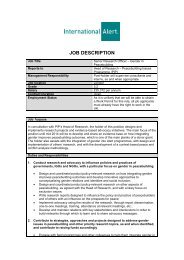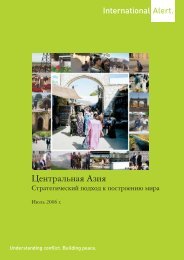LA PAIX Ã PETITS PAS - International Alert
LA PAIX Ã PETITS PAS - International Alert
LA PAIX Ã PETITS PAS - International Alert
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
La Paix à Petits Pas<br />
17<br />
Durant ces deux périodes, la société civile a joué un rôle primordial sur la scène politique<br />
congolaise, rôle qui l’a profondément affaiblie et divisée. Les principales raisons qui ont conduit à<br />
la division de la société civile sont d’une part les positionnements politiques divergents des acteurs<br />
de la composante « société civile » qui représentaient la société civile à ces deux événements et,<br />
d’autre part, la cooptation politique de délégués de la société civile dont certains ont, en 2003,<br />
rejoint le gouvernement de transition et intégré le Parlement au titre de « représentants de la<br />
société civile » 18 .<br />
Si la définition que nous avions adoptée en début d’analyse marque la distinction entre la société<br />
civile et le gouvernement, il est nécessaire ici de relever les liens qui unissent, dans la pratique, les<br />
organisations de la société civile congolaise et la sphère politique.<br />
Ces liens sont de deux ordres :<br />
• La société civile est un tremplin pour accéder au pouvoir, nous venons de le montrer avec le cas<br />
de la Conférence nationale souveraine et du processus de paix qui a conduit à la cooptation<br />
de certains leaders. Si la pratique n’est pas unique à la RDC, elle prend dans ce contexte une<br />
dimension spécifique par son importance et sa nature : la société civile est une composante<br />
politique au même titre que les partis politiques.<br />
• La société civile est une base de mobilisation pour les acteurs politiques. Certains ont créé leur<br />
propre organisation, et notamment dans le secteur de la paix. Au Nord-Kivu, Eugène Serufuli,<br />
gouverneur du Nord-Kivu de 2000 à 2007, avait son organisation Tous pour la paix et le<br />
développement (TPD). De même, lors de nos entretiens, un responsable de la Commission<br />
pacification et réconciliation du programme STAREC 19 a très naturellement indiqué que<br />
les trois organisations qui avaient été retenues pour la mise en œuvre des activités de ce<br />
programme étaient des organisations proches ou présidées par l’actuel vice-gouverneur de la<br />
même province, Maître Feller.<br />
Au-delà des politiques et des bailleurs, la volonté de coordination a gagné la société civile ellemême.<br />
En 1992, à la suite de la Conférence nationale souveraine, des bureaux de coordination de<br />
la société civile ont été mis en place dans les différentes provinces du pays, le Sud-Kivu devenant la<br />
première province dotée d’un bureau de coordination. Ces structures sont organisées autour d’une<br />
dizaine de représentants élus par les membres des organisations qui composent la société civile<br />
selon leur secteur d’intervention ou leur identité (les confessions religieuses, les organisations de<br />
développement, féminines, de droits humains, les syndicats, les jeunes…).<br />
Ces structures ont été largement critiquées car elles sont marquées par de profondes divisions (au<br />
niveau national, quatre différentes composantes se disputaient encore récemment la représentation<br />
des organisations féminines 20 ). Elles sont considérées comme servant les intérêts politiques de<br />
leurs membres plutôt que les intérêts des organisations qu’elles représentent mais restent malgré<br />
tout une structure de référence pour une majorité des organisations rencontrées.<br />
Toutefois, selon nos observations, la multiplicité des réseaux contraste avec les échanges réalisés<br />
avec ces organisations qui ignorent très largement le travail des autres intervenants, même s’ils<br />
interviennent dans le même secteur et dans la même zone. Cette observation semble refléter une<br />
tendance, qui a été soulignée par de nombreux intervenants (et notamment des membres des<br />
réseaux) : la tendance de certains réseaux à se transformer en association autonome, dotée de<br />
statuts, d’un conseil d’administration et agissant en dehors des structures qui la composent. La mise<br />
en place d’un réseau devient alors un nouveau moyen d’attirer des financements en s’appropriant<br />
les réussites de ses organisations membres.<br />
18 Gouzou, (J.) et Van der Schoot (Y.). Analysis of Civil Society during the Transition Period in DRC. Étude commissionée par ASDI/SIDA,<br />
Stockholm. 2006. p. 52-53.<br />
19 Le programme STAREC (Programme de stabilisation et de reconstruction des zones sortant des conflits armés) vise à consolider la<br />
situation sécuritaire, contribuer à la restauration de l’autorité de l’Etat, aider le retour des populations déplacées et réfugiés ainsi que la<br />
relance de l’économie locale. Le STAREC a été conçu par les autorités congolaises et est soutenu par la communauté internationale selon<br />
la stratégie de stabilisation des Nations-Unies.<br />
20 World Bank. Civil Society and Extractive Industries in the Democratic Republic of Congo. Washington. Mai 2010. p. 6.