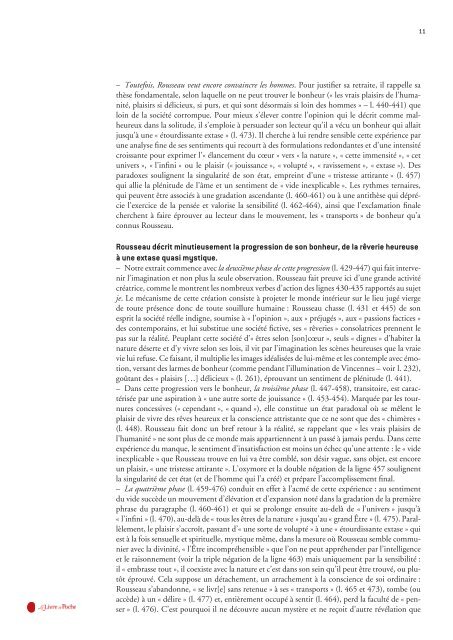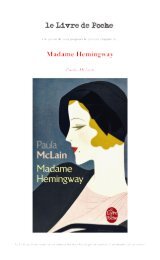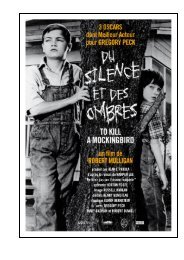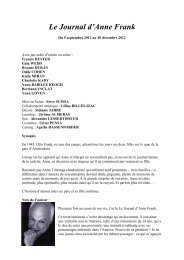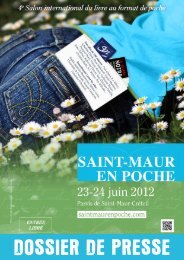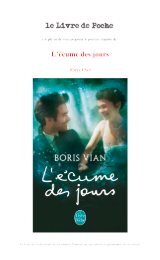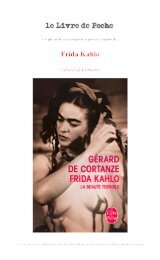Jacques Rousseau Lettres à Malesherbes - Le Livre de Poche
Jacques Rousseau Lettres à Malesherbes - Le Livre de Poche
Jacques Rousseau Lettres à Malesherbes - Le Livre de Poche
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
11– Tou te fois, Rous seau veut encore convaincre les hommes. Pour jus ti fier sa retraite, il rap pelle sathèse fon da men tale, selon laquelle on ne peut trou ver le bon heur (« les vrais plai sirs <strong>de</strong> l’huma -nité, plai sirs si déli cieux, si purs, et qui sont désor mais si loin <strong>de</strong>s hommes » – l. 440-441) queloin <strong>de</strong> la société cor rom pue. Pour mieux s’éle ver contre l’opi nion qui le décrit comme mal -heu reux dans la soli tu<strong>de</strong>, il s’emploie <strong>à</strong> per sua <strong>de</strong>r son lec teur qu’il a vécu un bon heur qui allaitjus qu’<strong>à</strong> une « étour dis sante extase » (l. 473). Il cherche <strong>à</strong> lui rendre sen sible cette expé rience parune ana lyse fine <strong>de</strong> ses sen ti ments qui recourt <strong>à</strong> <strong>de</strong>s for mu la tions redon dantes et d’une inten sitécrois sante pour expri mer l’« élan ce ment du cœur » vers « la nature », « cette immen sité », « cetuni vers », « l’infini » ou le plai sir (« jouis sance », « volupté », « ravis se ment », « extase »). Despara doxes sou lignent la sin gu la rité <strong>de</strong> son état, empreint d’une « tris tesse atti rante » (l. 457)qui allie la plé ni tu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’âme et un sen ti ment <strong>de</strong> « vi<strong>de</strong> inex pli cable ». <strong>Le</strong>s rythmes ter naires,qui peuvent être asso ciés <strong>à</strong> une gra da tion ascen dante (l. 460-461) ou <strong>à</strong> une anti thèse qui dépré -cie l’exer cice <strong>de</strong> la pen sée et valo rise la sen si bi lité (l. 462-464), ainsi que l’excla ma tion finalecherchent <strong>à</strong> faire éprou ver au lec teur dans le mou ve ment, les « trans ports » <strong>de</strong> bon heur qu’aconnus Rous seau.Rous seau décrit minu tieu se ment la pro gres sion <strong>de</strong> son bon heur, <strong>de</strong> la rêve rie heu reuse<strong>à</strong> une extase quasi mys tique.– Notre extrait commence avec la <strong>de</strong>uxième phase <strong>de</strong> cette pro gression (l. 429-447) qui fait inter venirl’ima gi na tion et non plus la seule obser vation. <strong>Rousseau</strong> fait preuve ici d’une gran<strong>de</strong> activitécréa trice, comme le montrent les nom breux verbes d’action <strong>de</strong>s lignes 430-435 rap portés au sujetje. <strong>Le</strong> méca nisme <strong>de</strong> cette créa tion consiste <strong>à</strong> pro jeter le mon<strong>de</strong> intérieur sur le lieu jugé vierge<strong>de</strong> toute pré sence donc <strong>de</strong> toute souillure humaine : Rous seau chasse (l. 431 et 445) <strong>de</strong> sonesprit la société réelle indigne, sou mise <strong>à</strong> « l’opinion », aux « préjugés », aux « passions factices »<strong>de</strong>s contem porains, et lui substitue une société fictive, ses « rêveries » consolatrices prennent lepas sur la réa lité. Peu plant cette société d’« êtres selon [son]cœur », seuls « dignes » d’habi ter lanature déserte et d’y vivre selon ses lois, il vit par l’ima gination les scènes heureuses que la vraievie lui refuse. Ce fai sant, il mul tiplie les images idéalisées <strong>de</strong> lui-même et les contemple avec émo -tion, ver sant <strong>de</strong>s larmes <strong>de</strong> bon heur (comme pen dant l’illumination <strong>de</strong> Vincennes – voir l. 232),goû tant <strong>de</strong>s « plai sirs […] déli cieux » (l. 261), éprou vant un sentiment <strong>de</strong> plénitu<strong>de</strong> (l. 441).– Dans cette pro gression vers le bonheur, la troisième phase (l. 447-458), transitoire, est carac -térisée par une aspira tion <strong>à</strong> « une autre sorte <strong>de</strong> jouis sance » (l. 453-454). Marquée par les tournuresconces sives (« cependant », « quand »), elle constitue un état para doxal où se mêlent leplai sir <strong>de</strong> vivre <strong>de</strong>s rêves heu reux et la conscience attris tante que ce ne sont que <strong>de</strong>s « chi mères »(l. 448). Rous seau fait donc un bref retour <strong>à</strong> la réa lité, se rappelant que « les vrais plaisirs <strong>de</strong>l’huma nité » ne sont plus <strong>de</strong> ce mon<strong>de</strong> mais appar tiennent <strong>à</strong> un passé <strong>à</strong> jamais perdu. Dans cetteexpé rience du manque, le sen timent d’insatis faction est moins un échec qu’une attente : le « vi<strong>de</strong>inexplicable » que <strong>Rousseau</strong> trouve en lui va être comblé, son dés ir vague, sans objet, est encoreun plaisir, « une tristesse attirante ». L’oxymore et la double négation <strong>de</strong> la ligne 457 sou lignentla sin gu la rité <strong>de</strong> cet état (et <strong>de</strong> l’homme qui l’a créé) et pré pare l’accomplissement final.– La qua trième phase (l. 459-476) conduit en effet <strong>à</strong> l’acmé <strong>de</strong> cette expé rience : au sen ti mentdu vi<strong>de</strong> suc cè<strong>de</strong> un mou ve ment d’élé va tion et d’expan sion noté dans la gra da tion <strong>de</strong> la pre mièrephrase du para graphe (l. 460-461) et qui se pro longe ensuite au- <strong>de</strong>l<strong>à</strong> <strong>de</strong> « l’uni vers » jus qu’<strong>à</strong>« l’infini » (l. 470), au- <strong>de</strong>l<strong>à</strong> <strong>de</strong> « tous les êtres <strong>de</strong> la nature » jus qu’au « grand Être » (l. 475). Paral -lè le ment, le plai sir s’accroît, pas sant d’« une sorte <strong>de</strong> volupté » <strong>à</strong> une « étour dis sante extase » quiest <strong>à</strong> la fois sen suelle et spi ri tuelle, mys tique même, dans la mesure où Rous seau semble commu -nier avec la divi nité, « l’Être incom pré hen sible » que l’on ne peut appré hen <strong>de</strong>r par l’intel li genceet le rai son ne ment (voir la triple néga tion <strong>de</strong> la ligne 463) mais uni que ment par la sen si bi lité :il « embrasse tout », il coexiste avec la nature et c’est dans son sein qu’il peut être trouvé, ou plu -tôt éprouvé. Cela sup pose un déta che ment, un arra che ment <strong>à</strong> la conscience <strong>de</strong> soi ordi naire :Rous seau s’aban donne, « se livr[e] sans rete nue » <strong>à</strong> ses « trans ports » (l. 465 et 473), tombe (ouaccè<strong>de</strong>) <strong>à</strong> un « délire » (l. 477) et, entiè re ment occupé <strong>à</strong> sen tir (l. 464), perd la faculté <strong>de</strong> « pen -ser » (l. 476). C’est pour quoi il ne découvre aucun mys tère et ne reçoit d’autre révé la tion que