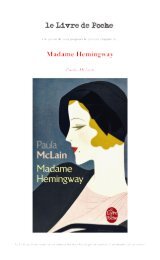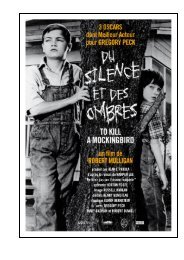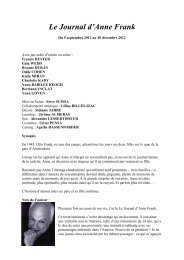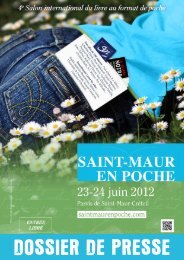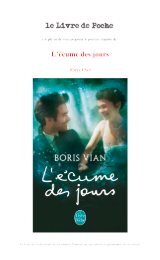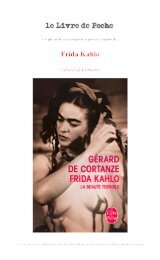Jacques Rousseau Lettres à Malesherbes - Le Livre de Poche
Jacques Rousseau Lettres à Malesherbes - Le Livre de Poche
Jacques Rousseau Lettres à Malesherbes - Le Livre de Poche
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
19Dans ces <strong>de</strong>ux récits, l’aveu <strong>de</strong> la faute répond <strong>à</strong> une exi gence <strong>de</strong> vérité mais celle- ci est tem pé réepar le souci fla grant <strong>de</strong> trou ver <strong>à</strong> cette faute <strong>de</strong>s cir constances atté nuantes qui font d’elles unesimple « fai blesse ».Pro po si tion <strong>de</strong> commen taireLa réponse <strong>à</strong> la ques tion ini tiale a mon tré que Rous seau a pris soin <strong>de</strong> dis tin guer soi gneu se -ment le récit <strong>à</strong> charge <strong>de</strong> sa faute et l’exposé <strong>de</strong>s inten tions et <strong>de</strong>s sen ti ments qui la lui ont faitcommettre : l’évo ca tion <strong>de</strong> la faute ne se réduit pas <strong>à</strong> l’aveu, <strong>à</strong> l’accu sa tion, moment essen tield’une confes sion, elle se pro longe, dans un <strong>de</strong>uxième moment qui équi libre et oriente d’ailleurssecrè te ment le pre mier, par l’énu mé ra tion <strong>de</strong>s cir constances, néces sai re ment atté nuantes, <strong>de</strong>cette faute. L’auto bio gra phie se fait ici récit et plai doyer : il convient donc d’étu dier d’abordl’argu men ta tion pro duite puis d’éva luer sa vali dité avant d’ana ly ser l’image que Rous seau donne<strong>de</strong> lui- même.1. Rous seau pré sente une série d’argu ments <strong>de</strong>s ti nés <strong>à</strong> atté nuer sa culpa bi litéUn bref pré am bule pré pare le lec teur <strong>à</strong> accep ter les argu ments qui vont suivre : Rous seau rap -pelle que, confor mé ment <strong>à</strong> l’enga ge ment énoncé dans le pré am bule, il s’est accusé sans détouret ce gage <strong>de</strong> sa sin cé rité ne peut que sus ci ter la confiance du lec teur ; mais cette totale sin cé ritéjus ti fie aussi l’exposé <strong>de</strong> ses « dis po si tions inté rieures » et il ne doit pas craindre <strong>de</strong> « [s’]excu ser »quand « la vérité » l’oblige aussi <strong>à</strong> par ler en sa faveur.– Rous seau trouve dans ses « dis po si tions inté rieures » <strong>de</strong>ux argu ments prou vant qu’iln’a pas agi par « méchan ceté ». <strong>Le</strong> mot ne pour rait lui être appli qué que par <strong>de</strong>s per sonnesqui le condamnent sans le connaître vrai ment et jugent sur <strong>de</strong>s appa rences ; en effet, selon unpara doxe reven di qué (« il est bizarre mais il est vrai »), la pre mière phrase sub sti tue <strong>à</strong> ce motcelui d’« ami tié », qui signi fie ici « amour » (offrir un ruban <strong>à</strong> une jeune fille était d’ailleurs unemanière <strong>de</strong> lui faire la cour). Ce pre mier argu ment révèle que le jeune homme était animé parun sen ti ment posi tif, que son cœur était bon. <strong>Le</strong> lec teur a été dis posé <strong>à</strong> accep ter cette expli ca -tion par la <strong>de</strong>s crip tion ini tiale <strong>de</strong> Marion (« on ne pou vait la voir sans l’aimer »). Un <strong>de</strong>uxièmeargu ment est aus si tôt invo qué : le « trouble » du cou pable <strong>de</strong>vant « la honte » qui le mena çaitlui a inter dit d’avouer, et cet argu ment est d’ailleurs <strong>à</strong> triple détente. Il confirme d’abord que lejeune Rous seau avait le cœur bon puisque, comme on l’a vu, un méchant aurait été insen sible<strong>à</strong> la honte. Il sug gère aussi que dans cette cir constance, il n’était plus lui- même, « un troubleuni ver sel [lui] ôtait tout autre sen ti ment », il n’agis sait pas selon sa véri table nature ; ainsi, cen’est pas par insen si bi lité qu’il a per sisté dans sa calom nie mais jus te ment par excès <strong>de</strong> sen si bi lité(autre para doxe, qui explique qu’un « cœur déchiré » par le « repen tir » reste muet) : la honted’avoir commis une faute lui en a fait commettre une plus gran<strong>de</strong> pour tenter d’y échap per. Cetargu ment incri mine enfin le « mon<strong>de</strong> » qui assiste <strong>à</strong> la scène et qui rend impos sible l’aveu. Ainsi,Rous seau pou vait appa raître <strong>à</strong> Marion comme l’incar na tion même <strong>de</strong> l’impu <strong>de</strong>nce alors quecelle- ci n’était que l’effet <strong>de</strong> son bon cœur, <strong>de</strong> son tem pé rament pas sionné (que le texte sou lignepar <strong>de</strong>s répé titions, <strong>de</strong>s ana phores et <strong>de</strong>s gra da tions ascen dantes) dans <strong>de</strong>s cir constances par ti cu -lières. (Sur l’impor tance <strong>de</strong> la honte chez Rous seau, voir ci- <strong>de</strong>ssous le Texte B.)– Rous seau s’attri bue en outre <strong>de</strong>s cir constances atté nuantes, pro dui sant par l<strong>à</strong> <strong>de</strong>ux nou -veaux argu ments pour sa défense. Il explique d’abord sa per sé vé rance dans le crime par l’atti tu<strong>de</strong>inap pro priée <strong>de</strong> son entou rage : M. <strong>de</strong> La Roque a eu tort <strong>de</strong> vou loir obte nir un aveu public ;pressé <strong>de</strong> rendre son juge ment il s’est mon tré peu déli cat et peu habile, n’a pas compris queRous seau n’était plus lui- même, qu’il avait besoin d’encou ra ge ments pour agir selon son cœuret sur mon ter son amour- propre. L’erreur fatale <strong>de</strong> l’aris to crate qui n’a pas fait ce qu’« il fal -lait » est sou li gnée par les mots « mais » et « quand » expri mant l’oppo si tion. L’auteur invoqueensuite sa jeu nesse, qu’il accen tue <strong>à</strong> <strong>de</strong>s sein en par lant <strong>de</strong> son « enfance » alors qu’il avait déj<strong>à</strong>seize ans. Il se gar<strong>de</strong> <strong>de</strong> récla mer une indul gence auto ma tique du fait <strong>de</strong> son âge, il se montremême par ti cu liè re ment sévère envers les crimes <strong>de</strong> la jeu nesse mais c’est pour mieux les oppo ser<strong>à</strong> sa faute, qu’il pré sente main te nant comme une « fai blesse » (voir les <strong>de</strong>ux tour nures res tric -tives) : le jeune Rous seau n’avait donc pas <strong>de</strong> noirs <strong>de</strong>s seins, il a seule ment man qué <strong>de</strong> cou rage