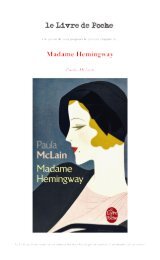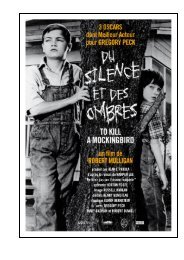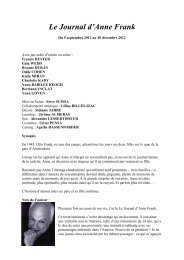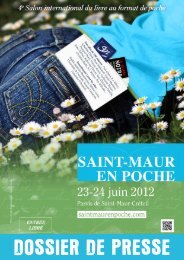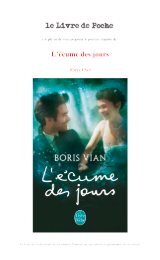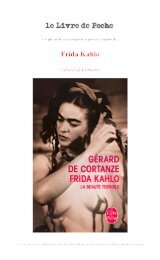Jacques Rousseau Lettres à Malesherbes - Le Livre de Poche
Jacques Rousseau Lettres à Malesherbes - Le Livre de Poche
Jacques Rousseau Lettres à Malesherbes - Le Livre de Poche
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
13Une per son na lité para doxalePara doxal, Rous seau l’est par sa sin gu la rité qui le dis tingue <strong>de</strong>s autres et par sa capa cité <strong>à</strong> réunir<strong>de</strong>s contraires. Cela vaut pour l’homme comme pour l’écri vain.– L’homme se défi nit par un trait majeur <strong>de</strong> son tem pé rament (une « pas sion domi nante »,l. 115) : un « indomp table esprit <strong>de</strong> liberté » (l. 87), un amour <strong>de</strong> l’« indé pen dance » (l. 22, 314)qui prend la forme d’une « indo lence » (l. 124), d’une « paresse […] incroyable » (l. 91). C’estce refus <strong>de</strong>s contraintes (l. 98-104) qui explique son « amour natu rel pour la soli tu<strong>de</strong> » (l. 38)et le rend impropre <strong>à</strong> la vie active et <strong>à</strong> la vie sociale. Chez lui, l’amour <strong>de</strong> la liberté a en outreun aspect poli tique : Rous seau « hai[t] sou ve rai ne ment l’injus tice » (l. 32-33) et éprouve « unevio lente aver sion pour les états qui dominent les autres » (l. 649-650), « [il] hai[t] les grands »(l. 657). Une série <strong>de</strong> para doxes compose son por trait : s’il fuit les hommes (l. 34-35), ce n’estpas par misan thro pie (l. 30-31) mais parce qu’ils s’écartent trop <strong>de</strong> son idéal (« c’est parce que jeles aime que je les fuis » – l. 624) et qu’il leur pré fère <strong>de</strong>s « êtres selon [son] cœur » (l. 431) ; il ale goût du « plai sir » (l. 21), le dés ir <strong>de</strong> « jouir » (l. 119, 84) mais recherche <strong>de</strong>s plai sirs « purs »(l. 441) dans la soli tu<strong>de</strong> <strong>de</strong> la nature et la rêve rie (3 e lettre) ; il a « un cœur très aimant, mais quipeut se suf fire <strong>à</strong> lui- même » (l. 620), « l’intime ami tié [lui] est […] chère » (l. 96-97) mais il s’estséparé <strong>de</strong> ses anciens amis les « phi lo sophes », notam ment Di<strong>de</strong>rot (« ils ne m’aimaient pas »,(l. 640) ; il « hai[t] les grands » mais goûte une « inti mité déli cieuse » (l. 694) auprès <strong>de</strong> M. <strong>de</strong>Luxembourg ; il se dit dénué <strong>de</strong> vanité (l. 22) mais « [a] pour [lui] une haute estime » (l. 541) ettient <strong>à</strong> démen tir la mau vaise opi nion que l’on a <strong>de</strong> lui (1 re lettre) ; il a « un tem pé rament ar<strong>de</strong>nt,bilieux facile <strong>à</strong> s’affec ter et sen sible <strong>à</strong> l’excès » (l. 161-162) mais ne connaît plus la « mélan co lie »(l. 45) <strong>de</strong>puis qu’il s’est retiré <strong>à</strong> la cam pagne.– L’écri vain est tout aussi para doxal. Il a connu le suc cès, il est <strong>de</strong>venu célèbre, il est pro tégépar M. <strong>de</strong> <strong>Malesherbes</strong>, direc teur <strong>de</strong> la Librai rie et ami <strong>de</strong>s « phi lo sophes », mais il méprise les« gens <strong>de</strong> lettres » (l. 542) que fré quente <strong>Malesherbes</strong>, les « bar bouilleurs » (l. 252), « ces tas<strong>de</strong> dés œu vrés payés <strong>de</strong> la graisse du peuple pour aller six fois la semaine bavar <strong>de</strong>r dans une aca -dé mie » (l. 546-548). Ils condamnent sa vie soli taire qui le rend « inutile <strong>à</strong> tout le mon<strong>de</strong> » ?Il leur retourne l’accu sa tion et les traite <strong>de</strong> para sites. Tou te fois, ce juge ment l’a tou ché : c’estun homme blessé qui cherche <strong>à</strong> se dis culper et mul ti plie les argu ments dans un mou ve mentexalté, ora toire (l. 542-606), qui culmine dans l’ana phore <strong>de</strong>s lignes 554-560. Est- il convain -cant ? Est- il lui- même convaincu ? On peut en dou ter dans la mesure où il ter mine en invo -quant comme ultime argu ment son propre sen ti ment (« je me crois tout <strong>à</strong> fait quitte avec [lasociété] ») et en réaf fi r mant <strong>de</strong> manière hyper bo lique son dés ir <strong>de</strong> vivre « pour [lui] seul » etnon en écri vain.Rous seau, en effet, dit n’être <strong>de</strong>venu écri vain que par acci <strong>de</strong>nt, « presque mal gré [lui] » et n’avoird’autre talent que celui que lui donne une forte convic tion (l. 250-261), il dépré cie d’ailleurs leslettres qu’il est en train d’écrire et qui ne seraient que « fatras » (l. 329, 722). Ce fai sant, il se valo -rise : contrai re ment <strong>à</strong> un « fai seur <strong>de</strong> livres » (l. 707) qui recher che rait le seul suc cès, il n’écritque pour faire connaître « la vérité », <strong>à</strong> laquelle il se dit « pas sion né ment atta ché » (l. 259). Sonécri ture est authen tique, c’est pour quoi, s’il se moque <strong>de</strong> sa célé brité (l. 604-606), il a le souci<strong>de</strong> la pos té rité (l. 669).L’accumulation <strong>de</strong>s paradoxes assure la singularité <strong>de</strong> <strong>Rousseau</strong>, son unicité, tout en la jus tifiantpuisque cet auto portrait le valorise en l’opposant <strong>à</strong> ses contem porains, constamment discrédités.Quelle est la part <strong>de</strong> l’auto justi fi cation ?La pre mière <strong>de</strong>s <strong><strong>Le</strong>ttres</strong> <strong>à</strong> <strong>Malesherbes</strong> per met d’ana ly ser ainsi le pro jet Rous seau :1. Il se connaît par fai te ment (« Per sonne au mon<strong>de</strong> ne me connaît que moi seul », l. 138) et ila une bonne opi nion <strong>de</strong> lui- même (« <strong>de</strong> tous les hommes que j’ai connus en ma vie, aucun nefut meilleur que moi », l. 152-153).2. Il souffre <strong>de</strong> se savoir mal jugé, « d’être connu <strong>à</strong> <strong>de</strong>mi » (l. 157).3. Il va donc se peindre tota le ment, « sans fard et sans mo<strong>de</strong>s tie » (« tel que je me vois, et telque je suis », l. 134), <strong>de</strong> façon <strong>à</strong> modi fier le juge ment d’autrui. D’où la struc ture d’oppo si tionqui sous- tend ces lettres : Rous seau rejette les images fausses <strong>de</strong> lui- même au pro fit <strong>de</strong> celles qu’il