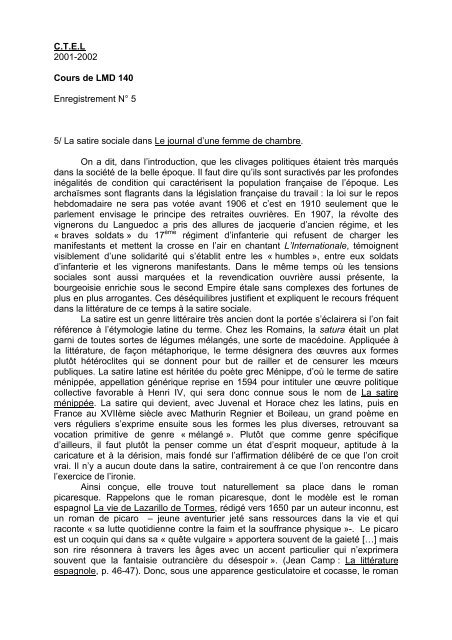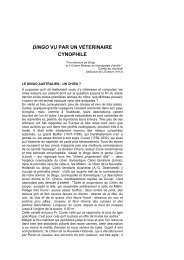NOT, André, « La satire sociale dans Le Journal d'une femme
NOT, André, « La satire sociale dans Le Journal d'une femme
NOT, André, « La satire sociale dans Le Journal d'une femme
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
C.T.E.L2001-2002Cours de LMD 140Enregistrement N° 55/ <strong>La</strong> <strong>satire</strong> <strong>sociale</strong> <strong>dans</strong> <strong>Le</strong> journal d’une <strong>femme</strong> de chambre.On a dit, <strong>dans</strong> l’introduction, que les clivages politiques étaient très marqués<strong>dans</strong> la société de la belle époque. Il faut dire qu’ils sont suractivés par les profondesinégalités de condition qui caractérisent la population française de l’époque. <strong>Le</strong>sarchaïsmes sont flagrants <strong>dans</strong> la législation française du travail : la loi sur le reposhebdomadaire ne sera pas votée avant 1906 et c’est en 1910 seulement que leparlement envisage le principe des retraites ouvrières. En 1907, la révolte desvignerons du <strong>La</strong>nguedoc a pris des allures de jacquerie d’ancien régime, et les<strong>«</strong> braves soldats » du 17 ème régiment d’infanterie qui refusent de charger lesmanifestants et mettent la crosse en l’air en chantant L’Internationale, témoignentvisiblement d’une solidarité qui s’établit entre les <strong>«</strong> humbles », entre eux soldatsd’infanterie et les vignerons manifestants. Dans le même temps où les tensions<strong>sociale</strong>s sont aussi marquées et la revendication ouvrière aussi présente, labourgeoisie enrichie sous le second Empire étale sans complexes des fortunes deplus en plus arrogantes. Ces déséquilibres justifient et expliquent le recours fréquent<strong>dans</strong> la littérature de ce temps à la <strong>satire</strong> <strong>sociale</strong>.<strong>La</strong> <strong>satire</strong> est un genre littéraire très ancien dont la portée s’éclairera si l’on faitréférence à l’étymologie latine du terme. Chez les Romains, la satura était un platgarni de toutes sortes de légumes mélangés, une sorte de macédoine. Appliquée àla littérature, de façon métaphorique, le terme désignera des œuvres aux formesplutôt hétéroclites qui se donnent pour but de railler et de censurer les mœurspubliques. <strong>La</strong> <strong>satire</strong> latine est héritée du poète grec Ménippe, d’où le terme de <strong>satire</strong>ménippée, appellation générique reprise en 1594 pour intituler une œuvre politiquecollective favorable à Henri IV, qui sera donc connue sous le nom de <strong>La</strong> <strong>satire</strong>ménippée. <strong>La</strong> <strong>satire</strong> qui devient, avec Juvenal et Horace chez les latins, puis enFrance au XVIIème siècle avec Mathurin Regnier et Boileau, un grand poème envers réguliers s’exprime ensuite sous les formes les plus diverses, retrouvant savocation primitive de genre <strong>«</strong> mélangé ». Plutôt que comme genre spécifiqued’ailleurs, il faut plutôt la penser comme un état d’esprit moqueur, aptitude à lacaricature et à la dérision, mais fondé sur l’affirmation délibéré de ce que l’on croitvrai. Il n’y a aucun doute <strong>dans</strong> la <strong>satire</strong>, contrairement à ce que l’on rencontre <strong>dans</strong>l’exercice de l’ironie.Ainsi conçue, elle trouve tout naturellement sa place <strong>dans</strong> le romanpicaresque. Rappelons que le roman picaresque, dont le modèle est le romanespagnol <strong>La</strong> vie de <strong>La</strong>zarillo de Tormes, rédigé vers 1650 par un auteur inconnu, estun roman de picaro – jeune aventurier jeté sans ressources <strong>dans</strong> la vie et quiraconte <strong>«</strong> sa lutte quotidienne contre la faim et la souffrance physique »-. <strong>Le</strong> picaroest un coquin qui <strong>dans</strong> sa <strong>«</strong> quête vulgaire » apportera souvent de la gaieté […] maisson rire résonnera à travers les âges avec un accent particulier qui n’exprimerasouvent que la fantaisie outrancière du désespoir ». (Jean Camp : <strong>La</strong> littératureespagnole, p. 46-47). Donc, sous une apparence gesticulatoire et cocasse, le roman