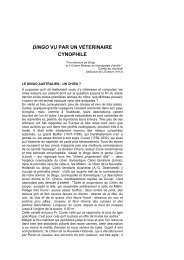NOT, André, « La satire sociale dans Le Journal d'une femme
NOT, André, « La satire sociale dans Le Journal d'une femme
NOT, André, « La satire sociale dans Le Journal d'une femme
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
éalise. » (p.580) Aucune psychologie à la Paul Bourget, là de<strong>dans</strong>, mais simplementun déterminisme sociologique qui conduit le personnage à composer – elle ne réalised’ailleurs qu’une partie de son rêve – compte tenu de ce que les événements et sonstatut ont fait d’elle.Dans le détail, la distribution du texte selon l’ordre du journal ou l’ordre dessouvenirs se fait souvent par le même processus. On en trouvera un exemple auchapitre VI.<strong>Le</strong> début reprend le fil abandonné au chapitre IV (scène avec Monsieur <strong>dans</strong>le jardin) et amène une nouvelle rencontre entre Célestine et ce soupirant surexcité.Puis, successivement, le récit enchaîne le récit de la salle de bains (Célestinesurprenant involontairement son maître <strong>dans</strong> le plus simple appareil) et la scène dudîner où Monsieur, croyant Célestine loin de lui, proteste de son innocence (<strong>«</strong> uneroulure pareille, une sale fille qui a peut-être de mauvaises maladies »). À partir deces événements ponctuels, Célestine se met à songer à l’intimité de ses maîtres,ceux du prieuré d’abord, puis les autres, en général ; et ceux du prieuré ne sontqu’une modalité du maître en général 7 . <strong>Le</strong>s maîtres du prieuré sont comme tous lesmaîtres et, donc, Célestine se met, à partir de ce qu’elle vient de vivre, à songer àson statut qui la met <strong>dans</strong> une sorte d’intimité gênante avec les maîtres. Uneobsession du voyeurisme se manifeste, alternant avec la méfiance que suscitent lesentreprises de séduction des maîtres. Puis, après une ligne sautée (tracetypographique d’un changement de plan), le texte enchaîne : <strong>«</strong> Rue Lincoln, parexemple, ça se passait le vendredi régulièrement… » (p.457). Nous voilà donctransportés <strong>dans</strong> un autre cas particulier, <strong>dans</strong> une place antérieure de Célestine ;nous voilà passés du plan du journal intime au plan des <strong>«</strong> mémoires ». Suit une séried’anecdotes scabreuses, enchaînées sans lien véritable, et les phrases de début deparagraphe le prouvent abondamment : <strong>«</strong> Et ceci me rappelle notre fameux voyageen Belgique » (p.458), <strong>«</strong> Encore un mot sur Madame… » (P.463). Enfin, après unenouvelle ligne sautée, retour au plan du journal : <strong>«</strong> Ce soir nous sommes restés pluslongtemps que de coutume à la cuisine. » (p.464)L’alternance, on le voit, conduit de l’expérience du prieuré aux expériencesantérieures par la transition d’un développement général, au présent de loi le plussouvent, sur la nature des rapports entre serviteurs et maîtres. En même temps quele texte affirme les contrastes entre les charmes de la vie parisienne et la sinistremonotonie de la campagne, il reconnaît, sous ces apparences si différentes, lesmêmes rapports de force, les mêmes abus et les mêmes hypocrisies. À l’idéalromanesque de la singularité psychologique s’oppose ainsi l’écriture d’une conditionhumaine, on pourrait presque dire, avant Sartre et à sa manière, d’une situation oùle personnage est pensé comme un sujet pensant sa propre histoire et élaborant sonpropre destin.Surtout à l’élaboration explicative, parfaitement construite par un narrateur quicherche plus à démontrer qu’à raconter, bref au roman à thèse, marque dupsychologisme à la Bourget, s’oppose chez Mirbeau, la juxtaposition d’événementsanecdotiques et contingents dont la conclusion est toujours laissée à la charge dulecteur sans que jamais le texte ne se mêle de l’infléchir. Autrement dit, là où leroman psychologique façon Bourget fonctionne comme construction à thèse, leroman mirbelien garde une certaine ouverture du sens et confère une certaine partde responsabilité au lecteur.Ce recours au fragmentaire, à l’inachevé et au contingent correspond bien àcette <strong>«</strong> modernité » que nous avons tâché de définir, <strong>dans</strong> le deuxième entretien, à7 on remarquera que très fréquemment, Célestine, <strong>dans</strong> le détail de ses aventures passées, ne nomme pas sesmaîtres par leur nom de famille, mais, chaque fois, les appelle indifféremment <strong>«</strong> Monsieur », <strong>«</strong> Madame ».