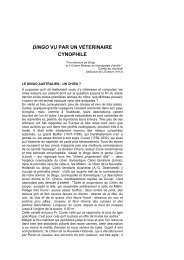NOT, André, « La satire sociale dans Le Journal d'une femme
NOT, André, « La satire sociale dans Le Journal d'une femme
NOT, André, « La satire sociale dans Le Journal d'une femme
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
C.T.E.L2001-2002Cours de LMD 140Enregistrement N° 7<strong>La</strong> crise du théâtre à la fin du XIXème siècleA première lecture, on peut trouver le texte d’Ubu roi choquant ou plussimplement dérisoire et dénué d’intérêt. Cette parodie grotesque de Macbeth avec salangue scatologique 8 , son vocabulaire mi-puéril mi faussement médiéval exaspère,encore aujourd’hui, plus d’un spectateur. <strong>Le</strong> portrait que Gide fait de Jarry, à la findes Faux-monnayeurs, n’est pas fait pour améliorer sa crédibilité : <strong>«</strong> Une sorte deJocrisse étrange, à la face enfarinée, à l’œil de jais, aux cheveux plaqués commeune calotte de moleskine[…] Vêtu en traditionnel gugusse d’hippodrome[…]martelant les syllabes, inventant de bizarres mots, en estropiant bizarrement certainsautres […] voix sans timbre, sans chaleur, sans intonation, sans relief » (op.cit.Folio,p.285-288).<strong>La</strong> tentation est donc grande de considérer non seulement Ubu roi mais aussitous les autres textes qui constituent en quelque sorte la <strong>«</strong> somme d’Ubu », la<strong>«</strong> geste d’Ubu », comme autant de canulars, certes savoureux à leur époque, maisdont le pouvoir de subvertion s’est considérablement éventé à la longue. À rebours,si l’on est réfractaire aux recherches formelles du théâtre contemporain, on peut voirl’œuvre de Jarry comme un fâcheux précédent inaugurant un siècle d’ineptiesscéniques. Cet entretien aura pour but de montrer à quel point ces deux attitudessont d’ordre épidermique et relèvent seulement d’une étourderie réactive qu’uneréflexion historique un peu précise peut finalement dissiper.Dans l’ouvrage collectif <strong>Le</strong> Théâtre en France publié sous la direction deJacqueline de Jomaron, Michel Corvin a rédigé un chapitre intitulé <strong>«</strong> Subversions, deJarry à Artaud. » Il y signale que, entre 1896 et 1950, Ubu roi n’a été monté que cinqfois. Cette réussite très confidentielle tient, selon lui, au trop grand écart entrel’esthétique de Jarry et l’horizon d’attente du public. Cette notion d’<strong>«</strong> horizond’attente » est empruntée aux théoriciens de la réception. Je la préciserai en citantHans Robert Jauss : <strong>«</strong> <strong>Le</strong> texte nouveau évoque pour le lecteur (ou l’auditeur)l’horizon des attentes et des règles du jeu avec lequel des textes antérieurs l’ontfamiliarisé ; cet horizon est ensuite, au fil de la lecture, varié, corrigé, modifié ousimplement reproduit. » (Pour une esthétique de la réception, p.13). Michel Corvin,rappelant que, <strong>dans</strong> les années 20, <strong>«</strong> les metteurs en scène les plus ouverts à lacréation contemporaine, tel Pitoëff, montaient de l’Anouilh ou du Cocteau », décrit lespublics de théâtre comme réfractaires, <strong>dans</strong> leur diversité, au théâtre de Jarry : <strong>«</strong> <strong>Le</strong>grand public, de bourgeois ou d’employés, qui fait ses délices du Boulevard (Guitry,Pagnol, bientôt Achard et Bourdet) ; le public cultivé qui s’intéresse à <strong>«</strong> ce qui sefait » mais reste très tributaire de son approche littéraire de théâtre […] va voirVildrac, <strong>Le</strong>normand, Salacrou, Giraudoux et les grands étrangers ; […] le public8 Je rappelle qu’à la première, le <strong>«</strong> merdre » avait été accueilli par les répliques du public qui s’était mis à crier<strong>«</strong> mangre », et qu’un peu plus tard on avait entendu le metteur en scène Luniépo traité de <strong>«</strong> Luniépo dechambre ».