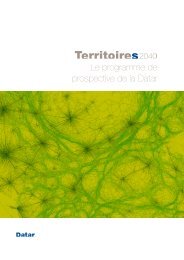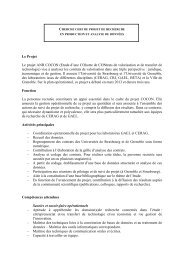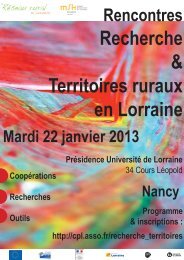pdf_colloque_final_14mars2011 - Pacte
pdf_colloque_final_14mars2011 - Pacte
pdf_colloque_final_14mars2011 - Pacte
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Mobilités spatiales et ressources métropolitaines : l’accessibilité en questionsqualité de l’accessibilité en transports collectifs aux points d’ancrage des activitésmétropolitaines. L’ambition est de « donner à voir » dans le contexte lillois, la capacité duréseau de TC à « co-construire » la stratégie multipolaire du fonctionnement métropolitain.Dans le cadre de notre démarche méthodologique et opérationnelle, nous avons choiside décliner deux questionnements : en premier lieu, comment rendre compte desconditions d’accessibilité en transport collectif aux sites stratégiques de l’airemétropolitaine ? En second lieu, comment mesurer la vulnérabilité du réseau detransport collectif et la plus ou moins grande fragilité de l’accessibilité du territoire ?L’accessibilité en transport collectif est mesurée sur la base d’une relation entrel’espace nodal central (Lille-Flandres et Lille-Europe) assurant le point d’entrée international,national et régional dans la métropole lilloise, et les 5 sites stratégiques lors d’un jourouvrable de base. En complément, l’accessibilité des 5 sites stratégiques à partir de toutl’espace de Lille Métropole Communauté Urbaine permet de définir les « conditions demobilité » aux pôles d’emplois, témoignant en négatif du degré de dépendance automobiledes territoires de la métropole lilloise. Nos choix méthodologiques combinent troisdimensions de l’accessibilité : le temps, la fréquence et la pénibilité. La première dimension est mesurée par le « temps moyen » qui correspond à uneréalité horaire pondérée par plusieurs mesures des plus courts chemin à des instantsdifférents (par exemple arrivée 8h, 8h15, 8h30, 8h45, 9h pour les heures de pointe dumatin). Ces différentes requêtes témoignent de la durée du trajet en fonction du servicede transport et de la variabilité de l’offre. La deuxième est mise en évidence par la fréquence des relations qui caractérise lenombre de possibilités d’effectuer le trajet sur une période donnée (par exemplel’heure de pointe du matin). La dernière est exprimée par le nombre de correspondances nécessaires pour effectuerles trajets demandés. Il s’agit en quelque sorte d’un indicateur de pénibilité dudéplacement.Une mesure fine de l’accessibilité au niveau de chaque site stratégique permet decompléter les investigations à l’échelle de LMCU. L’accès à pied, en vélo ou en TC danschaque zone d’activité (souvent très étalée) à partir des réseaux lourds de transport collectiftémoigne de l’importance du « dernier kilomètre » dans la chaine de déplacement. Ainsi, enplus de montrer comment les transports collectifs permettent de répondre à la desserte dessites métropolitains, l’échelle du projet urbain permet, à l’inverse, d’identifier commentl’agencement des zones d’activités s’organise par rapport au réseau lourd de transportcollectif.‐ 15 ‐Ensuite, nous cherchons de manière plus exploratoire à tester la connectivité duréseau. L’enjeu est de rendre compte de sa morphologie en évaluant « la multiplicité desliaisons directes et/ou alternatives assurées dans le système par le réseau » (Dupuy, 1985).L’évaluation est complétée, pour chaque site stratégique, par une comparaison deCOLLOQUE MSFS, PACTE Grenoble 24 et 25 Mars 2011,Des approches géographiques renouvelées de l’accessibilité structurelle aux territoires | Session 1