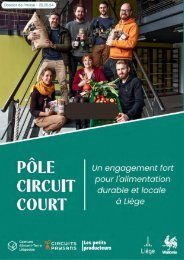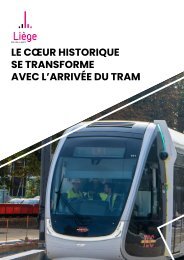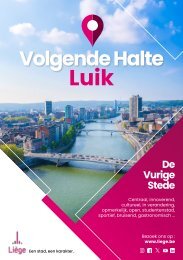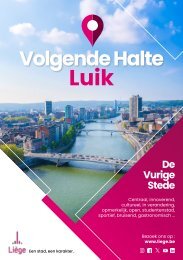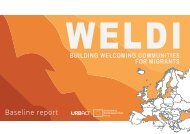Liège Musées n°4
Bulletin des musées de la Ville de Liège. A lire notamment : de précieux flacons aux saveurs orientales, Petits bouts de textiles multimillénaires, sesterce inédit de Trajan, amulettes scaraboïdes...
Bulletin des musées de la Ville de Liège.
A lire notamment : de précieux flacons aux saveurs orientales, Petits bouts de textiles multimillénaires, sesterce inédit de Trajan, amulettes scaraboïdes...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Des fibres 100 % naturelles<br />
L’utilisation de fibres végétales semble être exclusive<br />
dans les textiles néolithiques, les premiers tissus en<br />
laine provenant uniquement de sites de l’Âge du<br />
bronze. Ce constat doit cependant être nuancé. En<br />
effet, la présence d’ovi-caprinés dans le cheptel<br />
néolithique laisse supposer que cette ressource<br />
n’est pas restée inexploitée. L’emploi de la laine à<br />
l’époque néolithique est envisageable pour plusieurs<br />
raisons. Tout d’abord la combinaison laine-lin possède des<br />
propriétés intéressantes : la laine apporte la chaleur et le lin la<br />
rigidité. En outre, on constate des variations dans l’exploitation<br />
de la culture du lin : elle est abondante au iv e millénaire (Néolithique<br />
moyen) et décline à partir du iii e millénaire. Cette évolution<br />
est inversement proportionnelle à celle de la domestication du<br />
mouton. Enfin, les pesons de métiers deviennent de plus en plus légers, phénomène<br />
à mettre peut-être en relation avec un changement dans le choix de matière<br />
des fils de chaîne.<br />
Nos étoffes cordées attestent l’emploi de deux fibres : le liber,<br />
épais et robuste, est utilisé pour les éléments passifs et le lin, plus<br />
fin et fragile, pour les fils actifs.<br />
Les fibres de liber sont situées entre l’écorce et le tronc d’arbre. Les libers utilisés<br />
dans la confection des textiles sont surtout ceux de chêne et de tilleul. Ces fibres<br />
sont employées directement, sans être filées. Le liber, assoupli et affiné, est très<br />
fréquent dans la confection des étoffes cordées.<br />
Le lin est une des matières premières les plus anciennement exploitées<br />
dans le tissage. Les premières découvertes de lin non domestiqué<br />
(linum bienne) ont été faites en Turquie et sont datées<br />
du viii e millénaire. La forme domestiquée la plus ancienne (linum<br />
usitatissinum) a été découverte en Irak et date du vi e millénaire. Le<br />
lin domestiqué se serait répandu du Proche-Orient via les Balkans<br />
et le Danube jusqu’en Europe où il apparaît dès le Néolithique ancien.<br />
Les découvertes d’étoffes de lin sont rares au Néolithique moyen<br />
et atteignent leur présence maximale au Néolithique récent.<br />
D’après Séverine Monjoie, « Textiles néolithiques conservés<br />
au musée Curtius », Bulletin de l’Institut archéologique<br />
liégeois, t. CXI, 2003, p. 5-14.<br />
Des documents uniques<br />
Ces trois petits bouts de textile toujours présentés sous les plaques de verre qui les<br />
protègent depuis des dizaines d’années sont des documents vraiment insolites que<br />
peu de visiteurs doivent admirer… Mais ils sont là, sous vos yeux, fragiles mais<br />
stables, prêts à témoigner de la dextérité des artisans d’un très très lointain passé.<br />
Ces quelques lignes en attestent.<br />
•<br />
<strong>Liège</strong>•museum<br />
n° 4, juin 2012<br />
9