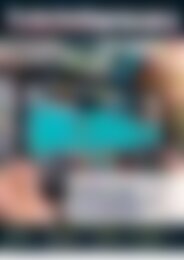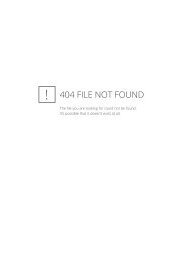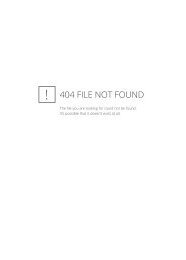Qualité Références n° 53
Perpectives 2011 : OUTILS & METHODES DE MANAGEMENT
Perpectives 2011 : OUTILS & METHODES DE MANAGEMENT
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
DOSSIER<br />
<br />
moral et éthique de la responsabilité sociale.<br />
Faute de penser cette instrumentation des<br />
normes de responsabilité sociétale par les<br />
organisations, cette mise en œuvre des normes<br />
ISO demeure difficile, d’autant que l’ISO<br />
ne constitue pas nécessairement l’instance<br />
qui pourrait paraître la plus légitime pour poursuivre<br />
ces enjeux d’ordre démocratique. Peutêtre<br />
les communautés professionnelles et les<br />
syndicats pourraient-ils être conviés à cette<br />
mise en œuvre, à travers des structures qui<br />
demeurent à inventer : ce qu’il faut aujourd’hui<br />
construire, ce sont les outils juridiques<br />
ou philosophiques capables d’accompagner<br />
l’évolution du rôle des organisations.<br />
De leur côté, Thierry Fouque et Frédéric<br />
Gautier (Professeurs de gestion à Nanterre)<br />
montrent que la mise en œuvre des principes<br />
de responsabilité sociétale de la<br />
norme ISO26000 ne sauraient se dispenser<br />
de prendre en compte la manière dont se<br />
coordonnent les entreprises dans les<br />
processus de production transnationale à<br />
travers l’intégration de la chaîne logistique.<br />
Celle-ci désigne l’ensemble des flux physiques,<br />
des processus et des informations<br />
associés, en vue de l’approvisionnement,<br />
la détention, la circulation et la mise à disposition<br />
des produits depuis leur conception<br />
jusqu’au client final. La question est dès<br />
lors de savoir comment les règles issues<br />
de la norme ISO 26000 peuvent prendre<br />
place dans cette chaîne logistique. L’expérience<br />
de la mise en oeuvre des politiques<br />
de management dans ces chaînes montre<br />
DR<br />
la difficulté qu’il existe à diffuser des règles<br />
à destination des fournisseurs, a fortiori<br />
pour les fournisseurs de rang 2 ou 3.<br />
Dans cette diffusion, les mécanismes de<br />
certification jouent un rôle important. La<br />
norme ISO 26000, en fermant la voie d’une<br />
certification de portée internationale rend<br />
cette tâche ardue. Dès lors, la diffusion des<br />
lignes directrices devrait davantage valoriser<br />
la diffusion d’informations sur la<br />
responsabilité sociétale et le dialogue entre<br />
les différentes organisations d’une chaîne<br />
logistique.<br />
Les rapports du normatif<br />
et du juridique<br />
Du côté du droit, Frédéric Guiomard (Maître<br />
de conférences à Nanterre) montre la<br />
tension qui existe aujourd’hui entre une<br />
norme ISO qui a la prétention de définir<br />
elle-même les règles applicables à la<br />
responsabilité des entreprises et les effets<br />
assez limités dans l’ordre juridique de ce<br />
texte. La norme ISO conduit à sélectionner<br />
les règles qui pourraient régir le comportement<br />
des entreprises, en isolant, au sein<br />
des normes juridiques internationales celles<br />
qui seraient le mieux à même d’encadrer<br />
l’activité des entreprises. Dans ce « selfservice<br />
» normatif (selon l’expression<br />
d’Alain Supiot), certaines normes sont valorisées<br />
(comme la définition de standards<br />
généraux encadrant les conditions de travail<br />
ou les discriminations), mais d’autres ne<br />
sont mentionnées que très évasivement<br />
L’ouvrage de référence<br />
L’ISO 26000 vient de sortir, c’est une innovation de taille<br />
dans le domaine de la responsabilité sociétale. Mais quel<br />
est son rôle exactement ? Quel impact va-t-elle jouer sur<br />
le cadre de travail des organisations ? Quels seront les<br />
outils opérationnels à mettre en place ? Cet ouvrage, qui<br />
lui est consacré, permet de répondre à toutes ces questions<br />
et éclaire le lecteur sur les changements concrets<br />
qu’elle implique. L’ISO 26000 est la toute nouvelle norme<br />
fondamentale. Elle symbolise une seule et même compréhension<br />
de la responsabilité sociétale au niveau mondial.<br />
Elle favorise l’innovation, afin de répondre aux enjeux d’aujourd’hui<br />
et de demain en matière de développement<br />
durable. Dans ce contexte, il fallait un livre pour la décrypter sans verser dans la<br />
théorie complexe. Il le fallait aussi pour que les lecteurs saisissent toutes les pistes<br />
de mise en œuvre de la norme ISO 26000. Il fallait enfin un outil pour que les entreprises<br />
s’évaluent à l’aune de cette nouvelle norme. Les 8 auteurs de cet ouvrage rigoureux<br />
et accessible, passionnant à bien des égards, sont tous des spécialistes de la<br />
norme ISO 26000 : Mérylle Aubrun, Franck Bermond, Emilie Brun, Jean-Louis Cortot,<br />
Karen Delchet-Cochet, Olivier Graffin, Alain Jounot et Adrien Ponrouch. «ISO 26000<br />
Responsabilité sociétale – Comprendre, déployer, évaluer», éditions Afnor, 305 pages.<br />
(respect des contrats, contrôle des opérations<br />
de restructuration, paiement des<br />
salaires...), ou sont oubliées (garantie de<br />
l’intervention de l’Etat, délimitation de la<br />
responsabilité dans les groupes de sociétés,<br />
intervention des juges...). Du côté des effets,<br />
la norme ne peut s’appliquer directement<br />
mais elle pourrait être amenée à produire<br />
certains effets au moyen d’une incorporation<br />
dans les contrats ou les règles des<br />
entreprises, et dans l’évolution des règles<br />
de la responsabilité civile.<br />
Sophie Robin Olivier (Professeur à Nanterre)<br />
s’interroge de son côté sur la manière<br />
dont la norme ISO va se combiner avec les<br />
nombreuses normes nationales et internationales<br />
relatives aux questions abordées<br />
par ce texte. A première vue, la norme,<br />
dépourvue d’effet impératif, pourrait aisément<br />
se combiner avec le droit existant, de<br />
par son langage technique, plus compréhensible<br />
que la norme juridique pour les<br />
acteurs de l’entreprise, et par sa vocation<br />
à diffuser les idées et une communauté de<br />
vues. Toutefois, la question apparaît immédiatement<br />
plus complexe en raison de la<br />
multiplicité des normes en jeu. Les lignes<br />
directrices ont fait prévaloir un certain<br />
nombre de choix normatifs : ainsi la volonté<br />
d’une promotion de la lutte contre les discriminations<br />
insiste sur les actions correctrices.<br />
Mais comment pourra-t-on combiner<br />
ces normes avec celles de l’Union européenne<br />
qui demeurent très prudentes sur<br />
le terrain des actions positives ?<br />
Il en sera de même pour interpréter le sens<br />
des normes qui auront intégré la norme<br />
ISO à des contrats : quelle méthode choisir<br />
pour combiner ces normes issues de l’ISO<br />
et celles du droit national qui n’auraient pas<br />
la même signification ? La norme ISO paraît<br />
privilégier l’application de la norme la plus<br />
favorable. Il est cependant des matières<br />
dans lesquelles il est impossible de déterminer<br />
laquelle est la plus favorable : ainsi<br />
dans la conception des discriminations, qui<br />
pourra dire que le choix de collecter des<br />
données raciales afin de réaliser des actions<br />
positives ou celui d’une interdiction pure<br />
et simple des discriminations ? Le choix<br />
dépendra ici nécessairement du juge saisi.<br />
Limites de l’évaluation<br />
des politiques sociétales<br />
Enfin, Guillaume Delalieux, (Maître de<br />
conférences en gestion, IAE de Valenciennes)<br />
montre de son côté que l’analyse<br />
doit dépasser une réflexion d’ordre<br />
QUALITÉ RÉFÉRENCES ➤ JUILLET, AOÛT, SEPTEMBRE 2011 ➤ PAGE 36