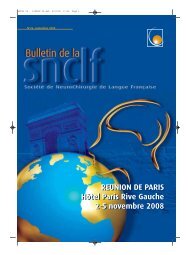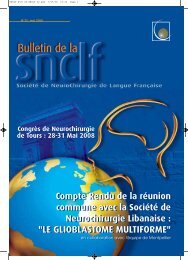SNCLF n°29:SNCLF 22.qxd
SNCLF n°29:SNCLF 22.qxd
SNCLF n°29:SNCLF 22.qxd
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Résultats ou Cas rapporté<br />
L’exérèse a été considérée comme sub-totale pour 2 patients<br />
et incomplète pour 10. La fissure orbitaire supérieure a été<br />
ouverte pour tous les patients. La paroi latérale du canal<br />
optique a été ouverte pour 10 patients. Une procédure de<br />
neuronavigation à partir d’un scanner en coupes osseuses a<br />
été utilisée pour 6 patients. L’exophtalmie a été réduite pour<br />
tous les patients. La baisse de l’acuité visuelle a été améliorée<br />
pour 7 patients sur 8. Le résultat esthétique était satisfaisant.<br />
Le délai moyen de suivi après la radiothérapie était de 53,8<br />
mois. Tous les reliquats tumoraux apparaissaient stables lors<br />
de la dernière imagerie de contrôle.<br />
Conclusion<br />
Ces résultats nous encouragent à poursuivre le développement<br />
de cette association thérapeutique. Le suivi de cette<br />
série de patients doit se poursuivre pour évaluer à plus long<br />
terme le devenir des reliquats méningiomateux.<br />
035 : Hernie médullaire transdurale spontannée<br />
Fahed ZAIRI,<br />
Laurent THINES, Philippe BOURGEOIS, Alkis BOU-<br />
RAS, Richard ASSAKER<br />
LILLE - Service de Neurochirurgie<br />
Introduction<br />
La hernie médullaire trans-durale est une pathologie méconnue<br />
dont le diagnostic est souvent établi de façon tardive. De<br />
nombreux diagnostics différents sont évoqués à tort, dont le plus<br />
fréquent est le kyste arachnoïdien. Le but de cette présentation<br />
est de rapporter la symptomatologie clinique de cette pathologie<br />
ainsi que les signes radiologiques habituels. Nous effectuons<br />
une revue de 90 cas publiés dans la littérature, et analysons<br />
les différentes options thérapeutiques proposées.<br />
Matériel - Méthode<br />
Nous rapportons trois cas de patients atteints de hernies<br />
médullaires trans-durales, opérés au CHU de Lille. Ces trois<br />
patients ont souffert d’un délai diagnostic moyen de 2 ans.<br />
Une patiente était suivie pour une myélopathie inflammatoire,<br />
la seconde pour un kyste arachnoïdien postérieur et la<br />
dernière pour une hernie discale calcifiée. Les diagnostics<br />
ont été secondairement redressés et les patientes opérées. Il<br />
s‘agit pour les trois cas, d’une hernie médullaire à travers une<br />
déhiscence durale antérieure. Les trois cas concernent la<br />
moelle thoracique et ont bénéficié de procédures chirurgicales<br />
différentes. Une patiente a bénéficié d’une suture « bord<br />
à bord », la seconde d’un élargissement de la déhiscence permettant<br />
de libérer la moelle de son anneau dural, et la dernière<br />
de la mise en place d’une plastie<br />
Résultats ou Cas rapporté<br />
Aucune complication opératoire ou post-opératoire n’a été rencontrée.<br />
Les trois patients ont présenté une amélioration de<br />
la symptomatologie clinique quelque soit la procédure chirurgicale<br />
adoptée. Le bilan radiologique par IRM confirme<br />
la libération médullaire. Aucune récidive n’a été rapportée<br />
Communications Orales<br />
Conclusion<br />
La hernie médullaire est une cause curable de myélopathie<br />
dorsale. La connaissance de cette pathologie, des signes cliniques<br />
et radiologiques doit permettre de réduire le délai diagnostic<br />
et de proposer une solution chirurgicale précocement,<br />
améliorant ainsi le pronostic.<br />
036 : STIMULATION CORTICALE ET EPILEPSIE FOCALE:<br />
Résultats d’un modèle expérimental chez le<br />
primate non humain<br />
T BLAUWBLOMME,<br />
B.Piallat, S.Chabardes<br />
INSERM U 836, équipe 7, Nano Technologies et Cerveau,<br />
Grenoble Institut des Neurosciences<br />
Introduction<br />
Plusieurs études cliniques tentent actuellement de déterminer<br />
la place de la neuromodulation dans les épilepsies pharmacorésistantes.<br />
Leurs résultats hétérogènes pourraient s’expliquer<br />
par le manque d’expérimentations animales préalables,<br />
et la méconnaissance des paramètres de stimulation<br />
optimaux. Notre étude propose d’établir un modèle primate<br />
de crises d’épilepsie de la région centrale, et d’étudier les<br />
effets de la stimulation corticale chronique ou intermittente.<br />
Matériel - Méthode<br />
Deux électrodes quadripolaires épidurales et deux canules d’injection<br />
étaient positionnées en regard du cortex moteur droit<br />
d’un singe macaca fascicularis en conditions stéréotaxiques. Les<br />
crises d’épilepsie étaient induites par injection intra corticale de<br />
2000 à 6000 UI de Pénicilline G et enregistrées en EEG video. Les<br />
critères d’études étaient: nombre et durée des crises et des pointes<br />
inter critiques. L’analyse statistique comparait les périodes stimulées<br />
et les périodes contrôle selon une ANOVA non paramétrique<br />
ou une régression multiple. Les paramètres de stimulation<br />
étaient: stimulation bipolaire, pulses monophasiques (80 à 300µS),<br />
I=80 % seuil moteur, F= 1, 25, 130, 200 ou 500 Hz. La stimulation<br />
était chronique (2 heures) ou aigue (closed loop, 5 secondes).<br />
Résultats ou Cas rapporté<br />
L’injection de Pénicilline permettait d’obtenir des crises focales<br />
hémicorporelles gauches pendant 24 heures. Trois injections<br />
contrôles ont montré: un pattern de décharge similaire<br />
lors de l’analyse temps-fréquence, une durée moyenne des<br />
crises comparables entre les 3 essais et une variabilité du<br />
nombre de crises en fonction du temps et entre les injections.<br />
Lors de la stimulation en closed loop à 25 Hz et 130 Hz,<br />
aucune crise n’ a pu être arrêtée, et la durée des crises n’était<br />
pas diminuée significativement (p=0.064).<br />
Conclusion<br />
Nous avons développé un modèle de crises d’épilepsie de la<br />
région centrale chez le primate. Nos résultats préliminaires ne<br />
montrent pas d’efficacité de la stimulation corticale du foyer<br />
épileptogène. Nous déterminons actuellement l’effet de la<br />
stimulation très haute fréquence en closed loop et de la stimulation<br />
chronique.<br />
35