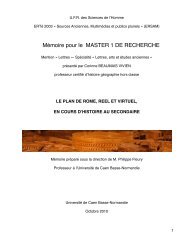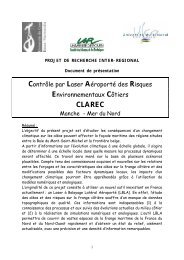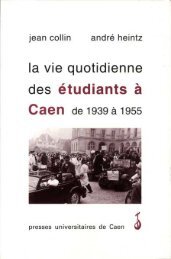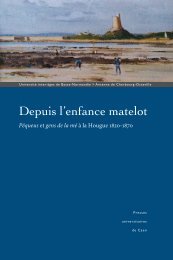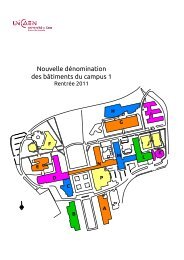Le petit monde de Raymond Bigot - Université de Caen Basse ...
Le petit monde de Raymond Bigot - Université de Caen Basse ...
Le petit monde de Raymond Bigot - Université de Caen Basse ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
il acquiert <strong>de</strong> quoi payer son laboureur ainsi en épuisant son corps et en abrégeant sa vie.<br />
Son bled alimente sa famille au moins une partie <strong>de</strong> l’année, la paille nourrit, l’hiver, une<br />
vache dont le lait et le veau sont d’un grand secours au ménage, il se voit à l’abri d’une<br />
famine absolue. Et si ces ressources ne suffisent pas à la subsistance <strong>de</strong> toute la maison, la<br />
femme passe les nuits à filer. (…) <strong>Le</strong>s mauvaises terres du Pays d’Ouche qui sont impropres à<br />
ces espèces <strong>de</strong> prairies artificielles pourraient peut-être produire <strong>de</strong>s genêts pour la nourriture<br />
<strong>de</strong>s moutons ou <strong>de</strong>s joncs marins pour le chauffage. <strong>Le</strong> défaut <strong>de</strong> qualité dans les laines <strong>de</strong><br />
cette province vient peut-être <strong>de</strong> ce qu’on tient les moutons dans <strong>de</strong>s étables trop étroites ;<br />
trop bien fermées et par conséquence trop chau<strong>de</strong>s. »<br />
A cette époque, l’agriculture et l’élevage (<strong>de</strong>s moutons en particuliers) sont déjà imbriqués : le<br />
mouton procure la vian<strong>de</strong> (pour la consommation <strong>de</strong>s ménages), la laine (pour la production<br />
<strong>de</strong>s toiles) et <strong>de</strong>s déjections qui <strong>de</strong>viennent <strong>de</strong>s engrais (‘Dans l'industrie rurale, tout part<br />
donc <strong>de</strong> l'engrais et tout y ramène’). Tous les paysans qui le peuvent ont <strong>de</strong>s moutons.<br />
Il existe aussi une industrie textile rurale semblable à celle rencontrée en Gran<strong>de</strong> Bretagne. En<br />
1762, un édit royal avait accordé aux habitants <strong>de</strong>s campagnes le droit <strong>de</strong> fabriquer <strong>de</strong>s<br />
étoffes sans faire partie d'une corporation. Arrive la Révolution. <strong>Le</strong> bouleversement <strong>de</strong><br />
l’administration du pays s’accompagne d’une transformation profon<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’industrie. Dans le<br />
pays d’Auge, l’industrie reine est le tissage <strong>de</strong>s étoffes <strong>de</strong> laine 38 . Mais à cette époque, la<br />
laine est handicapée parce qu’on ne sait pas la peigner mécaniquement.<br />
Cette ‘<strong>petit</strong>e industrie familiale’ impliquait un contrôle rigoureux <strong>de</strong> la qualité (la visite et le<br />
marquage <strong>de</strong>s étoffes au retour du moulin à foulon, le recours aux seules laines françaises)<br />
ainsi qu’une division du travail qui participait à l’armature du lien social : le travail à domicile,<br />
la vente à un intermédiaire, qui l’enregistre à la halle à domicile ou à la foire, le commerce <strong>de</strong><br />
gros et <strong>de</strong> semi-gros, la revente sur les foires, etc. Elle pénétrait intimement la vie rurale sous<br />
la forme d'une industrie domestique qui, à vrai dire, tendait à se concentrer dans certains<br />
bourgs, dont Bienfaite et la Cressonnière.<br />
<strong>Le</strong> 19 ème siècle est celui <strong>de</strong> la mécanisation progressive, qui s’accompagne ipso facto <strong>de</strong> la<br />
création <strong>de</strong>s fabriques. Tous les sta<strong>de</strong>s <strong>de</strong> transformation sont mécanisés à la fin du siècle et<br />
le développement <strong>de</strong>s grands troupeaux <strong>de</strong> l’hémisphère sud contribue au développement d’un<br />
marché mondial <strong>de</strong>s laines. La <strong>petit</strong>e industrie familiale <strong>de</strong> la vallée d’Auge ne résistera pas à<br />
cette tendance lour<strong>de</strong> 39 . <strong>Le</strong>s fabriques, portées par les innovations techniques, enregistrent<br />
les tisserands dans leurs murs d’usine, les salarient, les prolétarisent. Fin du tissage à<br />
domicile. Exo<strong>de</strong> <strong>de</strong>s tisserands. Michel Pierre est le <strong>de</strong>rnier tisserand <strong>de</strong> la famille 40 .<br />
38<br />
On pourra lire « La fabrication <strong>de</strong>s frocs dans la région d’Orbec à la fin <strong>de</strong> l’Ancien Régime », <strong>de</strong> Henri Pellerin,<br />
dans ‘<strong>Le</strong> Pays d’Auge’, 1966, n°10.<br />
39<br />
« Mais le travail à domicile a un prix : l’absence <strong>de</strong> scolarisation <strong>de</strong>s enfants. Une enquête industrielle fut faite par<br />
l'Association norman<strong>de</strong> dans les villes <strong>de</strong> Flers et Domfront en 1838. L'instruction dans les familles industrielles est<br />
malheureusement fort négligée, et c'est un fait d'autant plus regrettable que les enfants, riches ou pauvres, peuvent,<br />
presque partout, trouver <strong>de</strong>s maîtres capables, à <strong>de</strong>s distances assez rapprochées. Généralement, aussitôt après leur<br />
première communion, les enfants sachant à peine lire et écrire quittent l'école pour n'y plus revenir. » Congrès agricole<br />
et industriel <strong>de</strong> l'Association norman<strong>de</strong> : session <strong>de</strong> 1852. Extrait <strong>de</strong> l’Annuaire <strong>de</strong>s cinq départements <strong>de</strong> l'ancienne<br />
Normandie, 19e année, 1853, pp. 124-308. Nombreux sont ceux parmi nos ascendants qui ne savaient pas signer leur<br />
nom. Mais en 1850 c’est fini : le résultat <strong>de</strong>s les lois sur le travail <strong>de</strong>s enfants, <strong>de</strong> l’ascension sociale et <strong>de</strong> l’école<br />
universelle. Au point qu’on félicitera Paul l’architecte pour son excellente écriture.<br />
40<br />
« (Vers 1825), la fabrication du froc, qui était concentrée dans les communes <strong>de</strong> Bienfaite, Tordouet, la Chapelle-<br />
Yvon, le Ronceray, donnait à ces communes une mo<strong>de</strong>ste aisance, et surtout le bien être résultant <strong>de</strong> l'esprit <strong>de</strong> famille.<br />
Aujourd'hui la population <strong>de</strong> ce village (Bienfaite) compte à peine cent habitants; le progrès industriel ayant<br />
monopolisé, au chef lieu d'arrondissement, l'ancienne fabrication <strong>de</strong>s frocs, les enfants <strong>de</strong> ces vieux fabricants ont dû<br />
abandonner le toit <strong>de</strong> leurs ancêtres, pour aller à Lisieux ou ailleurs chercher le morceau <strong>de</strong> pain nécessaire à leur<br />
46<br />
46