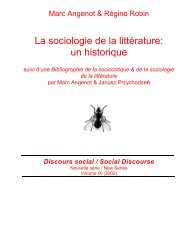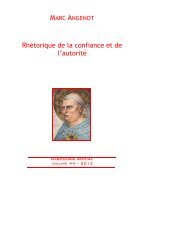D'où venons-nous? - Marc Angenot
D'où venons-nous? - Marc Angenot
D'où venons-nous? - Marc Angenot
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
jusqu’au jour sidérant de 1991 où l’URSS elle-même, sans coup férir et d’un jour<br />
à l’autre, a disparu de la carte du monde. Les historiens, perplexes, montreront que<br />
jamais dans l’histoire un puissant empire n’est disparu ainsi sans livrer combat,<br />
sans troubles majeurs et du jour au lendemain. Le passé d’une illusion, va titrer<br />
l’historien François Furet à propos des espérances communistes perdues. Mais audelà<br />
de l’«immense espoir à l’Est» qui s’est évanoui, c’est l’idée de justice sociale,<br />
née en Occident vers 1830 avec un néologisme, «socialisme» (on le date de 1832<br />
comme antonyme d’un autre mot récent, «individualisme»), qui en a pris un coup<br />
et semble s’enfoncer dans le passé idéologique.<br />
La France, écrit Duhamel, est en «panne d’idéologie» car, va-t-il ajouter, il<br />
n’y a pas que le communisme, le socialisme révolutionnaire qui se sont effondrés:<br />
tous les projets sociaux classiques se sont sclérosés, les grands principes civiques<br />
se sont affaissés, il ne reste plus aux Français que «la politique-spectacle» (Alain<br />
Duhamel est l’inventeur de l’expression). La fin des idéologies radicales qui<br />
soulage les uns, fatigués des enthousiasmes de masse, est identifiée par d’autres<br />
comme l’entrée dans une ère de ramollissement mental. «Les temps sont durs, les<br />
idées sont molles», ironise Fr.-Bernard Huyghe dans La soft-idéologie (1987).<br />
Si l’on envisage dès lors la faillite historique dont la fin du XXème siècle<br />
semble avoir consommé la démonstration, il faut d’abord la reconnaître multiple:<br />
échec au «coût» humain atroce des socialismes d’État, à quoi s’ajoutent les échecs<br />
de la plupart des mouvements émancipateurs apparus dans le premier monde et<br />
dans ce qu’on nomme encore le «tiers» monde, blocage des réformes<br />
social-démocratiques et de leur égalitarisme «modéré», crise de la pensée<br />
progressiste et des projets émancipateurs de toutes natures. «Épuisement de<br />
l’espoir» formule Krysztof Pomian, «Effacement de l’avenir» analyse dans un gros<br />
livre qui vient de paraître Pierre-André Taguieff 5 : il est difficile de trouver, sur l’idée<br />
de départ au moins, un accord plus unanime des observateurs alors même que<br />
leur espérance civique (c’est évident des deux penseurs cités) n’avait été<br />
aucunement investie dans l’URSS et ses satellites. La pensée progressiste et<br />
égalitaire sous ses multiples formes, l’optimisme de la perfectibilité humaine<br />
apparu un peu avant 1789 se trouvent dévalués, privés de fondement à mesure que<br />
s’efface toute alternative utopique. 6<br />
Cette crise de l’idée de progrès remonte, certes, bien plus haut que le bilan<br />
reconnu négatif de l’URSS et la chute du communisme. Cette crise, mais elle hante<br />
le siècle, le XX ème siècle tout entier l’alimente! La Première Guerre mondiale avait<br />
porté un premier coup brutal aux espérances et aux illusions pacifistes et<br />
humanitaires. Dès 1945, des philosophes ont crié qu’Auschwitz, ce «saut dans la<br />
barbarie» (Adorno) mettait un terme aux illusions du progrès sauf pour le dernier<br />
des jobards. La seconde moitié du siècle n’aura été à cet égard qu’une période de<br />
latence et de refoulement avant que la faillite du progrès ne se déclare au grand<br />
jour et que des idéologies nouvelles ou retapées ne se bricolent dans le vide ainsi<br />
8