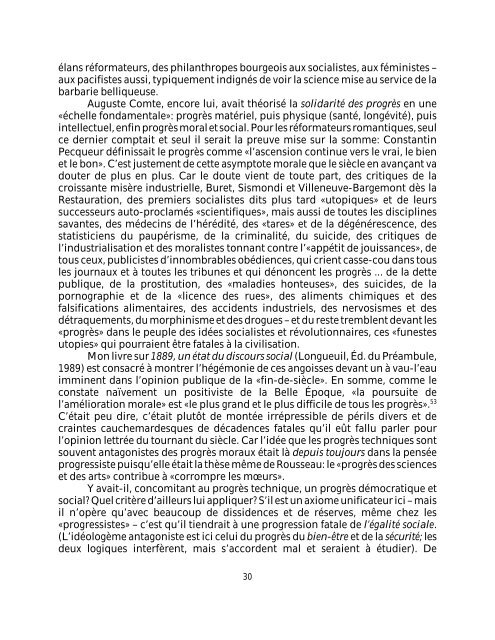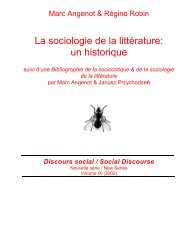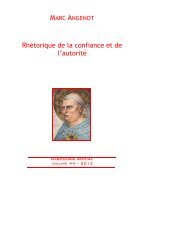D'où venons-nous? - Marc Angenot
D'où venons-nous? - Marc Angenot
D'où venons-nous? - Marc Angenot
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
élans réformateurs, des philanthropes bourgeois aux socialistes, aux féministes –<br />
aux pacifistes aussi, typiquement indignés de voir la science mise au service de la<br />
barbarie belliqueuse.<br />
Auguste Comte, encore lui, avait théorisé la solidarité des progrès en une<br />
«échelle fondamentale»: progrès matériel, puis physique (santé, longévité), puis<br />
intellectuel, enfin progrès moral et social. Pour les réformateurs romantiques, seul<br />
ce dernier comptait et seul il serait la preuve mise sur la somme: Constantin<br />
Pecqueur définissait le progrès comme «l’ascension continue vers le vrai, le bien<br />
et le bon». C’est justement de cette asymptote morale que le siècle en avançant va<br />
douter de plus en plus. Car le doute vient de toute part, des critiques de la<br />
croissante misère industrielle, Buret, Sismondi et Villeneuve-Bargemont dès la<br />
Restauration, des premiers socialistes dits plus tard «utopiques» et de leurs<br />
successeurs auto-proclamés «scientifiques», mais aussi de toutes les disciplines<br />
savantes, des médecins de l’hérédité, des «tares» et de la dégénérescence, des<br />
statisticiens du paupérisme, de la criminalité, du suicide, des critiques de<br />
l’industrialisation et des moralistes tonnant contre l’«appétit de jouissances», de<br />
tous ceux, publicistes d’innombrables obédiences, qui crient casse-cou dans tous<br />
les journaux et à toutes les tribunes et qui dénoncent les progrès ... de la dette<br />
publique, de la prostitution, des «maladies honteuses», des suicides, de la<br />
pornographie et de la «licence des rues», des aliments chimiques et des<br />
falsifications alimentaires, des accidents industriels, des nervosismes et des<br />
détraquements, du morphinisme et des drogues – et du reste tremblent devant les<br />
«progrès» dans le peuple des idées socialistes et révolutionnaires, ces «funestes<br />
utopies» qui pourraient être fatales à la civilisation.<br />
Mon livre sur 1889, un état du discours social (Longueuil, Éd. du Préambule,<br />
1989) est consacré à montrer l’hégémonie de ces angoisses devant un à vau-l’eau<br />
imminent dans l’opinion publique de la «fin-de-siècle». En somme, comme le<br />
constate naïvement un positiviste de la Belle Époque, «la poursuite de<br />
l’amélioration morale» est «le plus grand et le plus difficile de tous les progrès». 53<br />
C’était peu dire, c’était plutôt de montée irrépressible de périls divers et de<br />
craintes cauchemardesques de décadences fatales qu’il eût fallu parler pour<br />
l’opinion lettrée du tournant du siècle. Car l’idée que les progrès techniques sont<br />
souvent antagonistes des progrès moraux était là depuis toujours dans la pensée<br />
progressiste puisqu’elle était la thèse même de Rousseau: le «progrès des sciences<br />
et des arts» contribue à «corrompre les mœurs».<br />
Y avait-il, concomitant au progrès technique, un progrès démocratique et<br />
social? Quel critère d’ailleurs lui appliquer? S’il est un axiome unificateur ici – mais<br />
il n’opère qu’avec beaucoup de dissidences et de réserves, même chez les<br />
«progressistes» – c’est qu’il tiendrait à une progression fatale de l’égalité sociale.<br />
(L’idéologème antagoniste est ici celui du progrès du bien-être et de la sécurité; les<br />
deux logiques interfèrent, mais s’accordent mal et seraient à étudier). De<br />
30