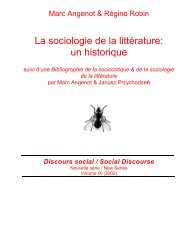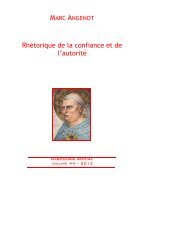D'où venons-nous? - Marc Angenot
D'où venons-nous? - Marc Angenot
D'où venons-nous? - Marc Angenot
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Ce nouveau paradigme, les philosophes des Lumières l’avaient dégagé et<br />
mis en place, mais ce sont les doctrinaires «humanitaires» du romantisme qui vont<br />
inscrire la «destinée» de l’humanité dans des systèmes totaux, tandis que les<br />
mouvements sociaux nés de la révolution industrielle vont fulminer leur<br />
dénonciation du «paupérisme», de l’injustice qui opprime les misérables et les<br />
exploités sous l’invocation de l’Humanité en marche et de ses droits inaliénables.<br />
Devenue objet d’une religion scientifique avec Auguste Comte – c’est<br />
l’Apostolat positiviste ou «Religion de l’Humanité» – elle devient également un de<br />
ces «mots» avec lesquels des hommes modernes ont été préparés à mourir. «Vive<br />
l’humanité!», tel fut le dernier cri de Jean-Baptiste Millière, fusillé pendant la<br />
Semaine sanglante. Comte publie en 1852 le Catéchisme positiviste de la Religion<br />
de l’humanité, mais le projet de fonder une telle religion «scientifique» était dans<br />
tous les esprits progressistes depuis le règne de Charles X. «La religion peut-elle<br />
être autre chose que la théorie de la loi de l’humanité? (...) La science religieuse est<br />
donc la plus étendue des sciences puisqu’elle les résume toutes. La seule religion<br />
est celle que la science ne peut ébranler.» Phraséologie typique des penseurs<br />
quarante-huitards. 24 L’humanité, c’est ce qui permettait de parler de fraternité,<br />
égalité, solidarité: «On aime Dieu dès qu’on aime l’humanité. On la sert dès qu’on<br />
pratique la fraternité.» Auguste Comte? Oui, c’est à ce philosophe «bourgeois» un<br />
peu ringard que je me réfère volontiers dans les quelques pages qui suivent, plutôt<br />
qu’aux doctrinaires socialistes: ce serait trop facile et il m’importe de dégager une<br />
manière de penser qui fut celle de tout le monde.<br />
Que disait le discours humanitaire depuis Condorcet qui en est la source<br />
première? 25 Que l’homme est sans doute ceci et cela «par nature» (qu’il possède<br />
dès lors des «droits naturels»), mais plus encore qu’il est moralement «perfectible»<br />
et que cette perfectibilité «est réellement infinie»; que l’humanité, depuis ses<br />
origines sauvages et barbares, avait «progressé» invinciblement, irréfutablement,<br />
et que, du tableau de ses progrès immenses et à peu près réguliers jusqu’ici, en<br />
dépit de décadences intermittentes et de la vaine résistance des suppôts du passé,<br />
on pouvait extrapoler une «loi» prédictive et conclure «que la nature n’a mis aucun<br />
terme à nos espérances».<br />
Le sujet du récit du progrès, ce ne sont donc pas les hommes, c’est, au delà<br />
de leur succession contingente, l’Humanité, le «Grand Être» comtien qui accomplit<br />
sa destinée. Le XIX ème siècle pense avoir déchiffré le sens de cette destinée, ses<br />
penseurs montrent d’où <strong>nous</strong> <strong>venons</strong> et où <strong>nous</strong> allons en une «irrésistible<br />
progression» dans laquelle s’absorbent les heurs et les malheurs du petit homme<br />
individuel, ceux des générations et des peuples. Le récit du progrès est centré sur<br />
la métaphore de l’homme unique. Comte l’avait trouvée chez Pascal qui à ce titre<br />
(et à quelques autres) préfigure le discours de la modernité: «Toute la succession<br />
des hommes, pendant la longue suite des siècles, doit être considérée comme un<br />
seul homme qui subsiste toujours et qui apprend continuellement.» 26<br />
18