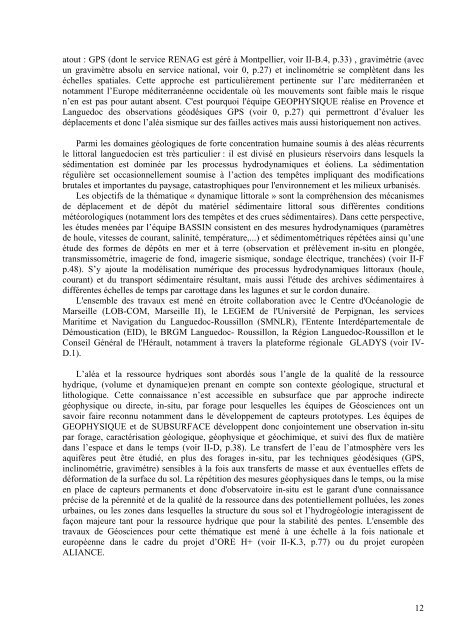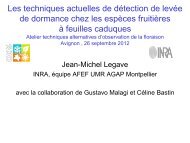Observatoire de R echerche M editérannéen de l'Environnement
Observatoire de R echerche M editérannéen de l'Environnement
Observatoire de R echerche M editérannéen de l'Environnement
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
atout : GPS (dont le service RENAG est géré à Montpellier, voir II-B.4, p.33) , gravimétrie (avec<br />
un gravimètre absolu en service national, voir 0, p.27) et inclinométrie se complètent dans les<br />
échelles spatiales. Cette approche est particulièrement pertinente sur l’arc méditerranéen et<br />
notamment l’Europe méditerranéenne occi<strong>de</strong>ntale où les mouvements sont faible mais le risque<br />
n’en est pas pour autant absent. C'est pourquoi l'équipe GEOPHYSIQUE réalise en Provence et<br />
Languedoc <strong>de</strong>s observations géodésiques GPS (voir 0, p.27) qui permettront d’évaluer les<br />
déplacements et donc l’aléa sismique sur <strong>de</strong>s failles actives mais aussi historiquement non actives.<br />
Parmi les domaines géologiques <strong>de</strong> forte concentration humaine soumis à <strong>de</strong>s aléas récurrents<br />
le littoral languedocien est très particulier : il est divisé en plusieurs réservoirs dans lesquels la<br />
sédimentation est dominée par les processus hydrodynamiques et éoliens. La sédimentation<br />
régulière set occasionnellement soumise à l’action <strong>de</strong>s tempêtes impliquant <strong>de</strong>s modifications<br />
brutales et importantes du paysage, catastrophiques pour l'environnement et les milieux urbanisés.<br />
Les objectifs <strong>de</strong> la thématique « dynamique littorale » sont la compréhension <strong>de</strong>s mécanismes<br />
<strong>de</strong> déplacement et <strong>de</strong> dépôt du matériel sédimentaire littoral sous différentes conditions<br />
météorologiques (notamment lors <strong>de</strong>s tempêtes et <strong>de</strong>s crues sédimentaires). Dans cette perspective,<br />
les étu<strong>de</strong>s menées par l’équipe BASSIN consistent en <strong>de</strong>s mesures hydrodynamiques (paramètres<br />
<strong>de</strong> houle, vitesses <strong>de</strong> courant, salinité, température,...) et sédimentométriques répétées ainsi qu’une<br />
étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s formes <strong>de</strong> dépôts en mer et à terre (observation et prélèvement in-situ en plongée,<br />
transmissométrie, imagerie <strong>de</strong> fond, imagerie sismique, sondage électrique, tranchées) (voir II-F<br />
p.48). S’y ajoute la modélisation numérique <strong>de</strong>s processus hydrodynamiques littoraux (houle,<br />
courant) et du transport sédimentaire résultant, mais aussi l'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s archives sédimentaires à<br />
différentes échelles <strong>de</strong> temps par carottage dans les lagunes et sur le cordon dunaire.<br />
L'ensemble <strong>de</strong>s travaux est mené en étroite collaboration avec le Centre d'Océanologie <strong>de</strong><br />
Marseille (LOB-COM, Marseille II), le LEGEM <strong>de</strong> l'Université <strong>de</strong> Perpignan, les services<br />
Maritime et Navigation du Languedoc-Roussillon (SMNLR), l'Entente Interdépartementale <strong>de</strong><br />
Démoustication (EID), le BRGM Languedoc- Roussillon, la Région Languedoc-Roussillon et le<br />
Conseil Général <strong>de</strong> l'Hérault, notamment à travers la plateforme régionale GLADYS (voir IV-<br />
D.1).<br />
L’aléa et la ressource hydriques sont abordés sous l’angle <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong> la ressource<br />
hydrique, (volume et dynamique)en prenant en compte son contexte géologique, structural et<br />
lithologique. Cette connaissance n’est accessible en subsurface que par approche indirecte<br />
géophysique ou directe, in-situ, par forage pour lesquelles les équipes <strong>de</strong> Géosciences ont un<br />
savoir faire reconnu notamment dans le développement <strong>de</strong> capteurs prototypes. Les équipes <strong>de</strong><br />
GEOPHYSIQUE et <strong>de</strong> SUBSURFACE développent donc conjointement une observation in-situ<br />
par forage, caractérisation géologique, géophysique et géochimique, et suivi <strong>de</strong>s flux <strong>de</strong> matière<br />
dans l’espace et dans le temps (voir II-D, p.38). Le transfert <strong>de</strong> l’eau <strong>de</strong> l’atmosphère vers les<br />
aquifères peut être étudié, en plus <strong>de</strong>s forages in-situ, par les techniques géodésiques (GPS,<br />
inclinométrie, gravimétre) sensibles à la fois aux transferts <strong>de</strong> masse et aux éventuelles effets <strong>de</strong><br />
déformation <strong>de</strong> la surface du sol. La répétition <strong>de</strong>s mesures géophysiques dans le temps, ou la mise<br />
en place <strong>de</strong> capteurs permanents et donc d'observatoire in-situ est le garant d'une connaissance<br />
précise <strong>de</strong> la pérennité et <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong> la ressource dans <strong>de</strong>s potentiellement polluées, les zones<br />
urbaines, ou les zones dans lesquelles la structure du sous sol et l’hydrogéologie interagissent <strong>de</strong><br />
façon majeure tant pour la ressource hydrique que pour la stabilité <strong>de</strong>s pentes. L'ensemble <strong>de</strong>s<br />
travaux <strong>de</strong> Géosciences pour cette thématique est mené à une échelle à la fois nationale et<br />
européenne dans le cadre du projet d’ORE H+ (voir II-K.3, p.77) ou du projet européen<br />
ALIANCE.<br />
12