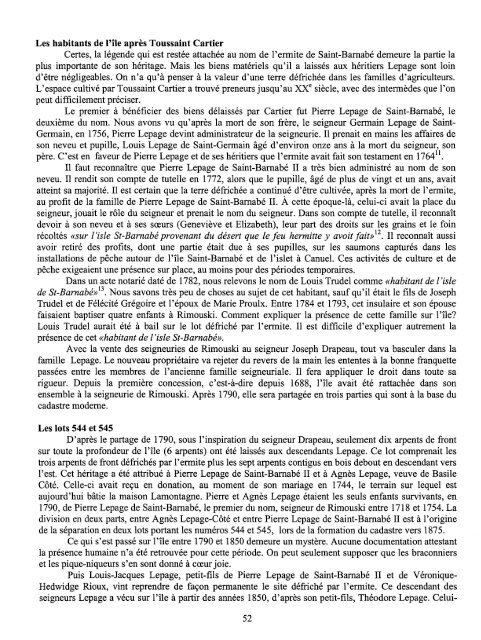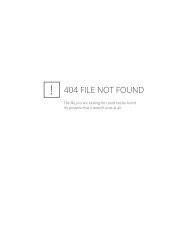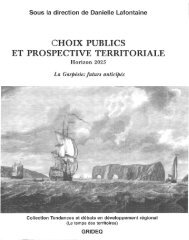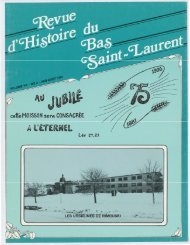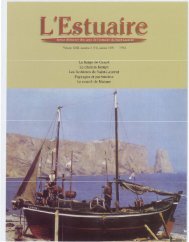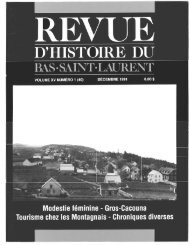Télécharger (13Mb) - Université du Québec à Rimouski
Télécharger (13Mb) - Université du Québec à Rimouski
Télécharger (13Mb) - Université du Québec à Rimouski
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Les habitants de l'île après Toussaint Cartier<br />
Certes, la légende qui est restée attachée au nom de l'ermite de Saint-Barnabé demeure la partie la<br />
plus importante de son héritage. Mais les biens matériels qu'il a laissés aux héritiers Lepage sont loin<br />
d'être négligeables. On n'a qu'à penser à la valeur d'une terre défrichée dans les familles d'agriculteurs.<br />
L'espace cultivé par Toussaint Cartier a trouvé preneurs jusqu'au XX e siècle, avec des intermèdes que l'on<br />
peut difficilement préciser.<br />
Le premier à bénéficier des biens délaissés par Cartier fut Pierre Lepage de Saint-Barnabé, le<br />
deuxième <strong>du</strong> nom. Nous avons vu qu'après la mort de son frère, le seigneur Germain Lepage de Saint<br />
Germain, en 1756, Pierre Lepage devint administrateur de la seigneurie. Il prenait en mains les affaires de<br />
son neveu et pupille, Louis Lepage de Saint-Germain âgé d'environ onze ans à la mort <strong>du</strong> seigneur, son<br />
père. C'est en faveur de Pierre Lepage et de ses héritiers que l'ermite avait fait son testament en 1764 11 •<br />
Il faut reconnaître que Pierre Lepage de Saint-Barnabé II a très bien administré au nom de son<br />
neveu. Il rendit son compte de tutelle en 1772, alors que le pupille, âgé de plus de vingt et un ans, avait<br />
atteint sa majorité. Il est certain que la terre défrichée a continué d'être cultivée, après la mort de l'ermite,<br />
au profit de la famille de Pierre Lepage de Saint-Barnabé II. À cette époque-là, celui-ci avait la place <strong>du</strong><br />
seigneur, jouait le rôle <strong>du</strong> seigneur et prenait le nom <strong>du</strong> seigneur. Dans son compte de tutelle, il reconnaît<br />
devoir à son neveu et à ses sœurs (Geneviève et Elizabeth), leur part des droits sur les grains et le foin<br />
récoltés «sur l'isle St-Barnabé provenant <strong>du</strong> désert que le feu hermitte y avoit fait» 12. Il reconnaît aussi<br />
avoir retiré des profits, dont une partie était <strong>du</strong>e à ses pupilles, sur les saumons capturés dans les<br />
installations de pêche autour de l'île Saint-Barnabé et de l'islet à Canuel. Ces activités de culture et de<br />
pêche exigeaient une présence sur place, au moins pour des périodes temporaires.<br />
Dans un acte notarié daté de 1782, nous relevons le nom de Louis Trudel comme «habitant de l'isle<br />
de St-Barnabé»13. Nous savons très peu de choses au sujet de cet habitant, sauf qu'il était le fils de Joseph<br />
Trudel et de Félécité Grégoire et l'époux de Marie Proulx. Entre 1784 et 1793, cet insulaire et son épouse<br />
faisaient baptiser quatre enfants à <strong>Rimouski</strong>. Comment expliquer la présence de cette famille sur l'île?<br />
Louis Trudel aurait été à bail sur le lot défriché par l'ermite. Il est difficile d'expliquer autrement la<br />
présence de cet «habitant de l'isle St-Barnabé».<br />
Avec la vente des seigneuries de <strong>Rimouski</strong> au seigneur Joseph Drapeau, tout va basculer dans la<br />
famille Lepage. Le nouveau propriétaire va rejeter <strong>du</strong> revers de la main les ententes à la bonne franquette<br />
passées entre les membres de l'ancienne famille seigneuriale. Il fera appliquer le droit dans toute sa<br />
rigueur. Depuis la première concession, c'est-à-dire depuis 1688, l'île avait été rattachée dans son<br />
ensemble à la seigneurie de <strong>Rimouski</strong>. Après 1790, elle sera partagée en trois parties qui sont à la base <strong>du</strong><br />
cadastre moderne.<br />
Les lots 544 et 545<br />
D'après le partage de 1790, sous l'inspiration <strong>du</strong> seigneur Drapeau, seulement dix arpents de front<br />
sur toute la profondeur de l'île (6 arpents) ont été laissés aux descendants Lepage. Ce lot comprenait les<br />
trois arpents de front défrichés par l'ermite plus les sept arpents contigus en bois debout en descendant vers<br />
l'est. Cet héritage a été attribué à Pierre Lepage de Saint-Barnabé II et à Agnès Lepage, veuve de Basile<br />
Côté. Celle-ci avait reçu en donation, au moment de son mariage en 1744, le terrain sur lequel est<br />
aujourd'hui bâtie la maison Lamontagne. Pierre et Agnès Lepage étaient les seuls enfants survivants, en<br />
1790, de Pierre Lepage de Saint-Barnabé, le premier <strong>du</strong> nom, seigneur de <strong>Rimouski</strong> entre 1718 et 1754. La<br />
division en deux parts, entre Agnès Lepage-Côté et entre Pierre Lepage de Saint-Barnabé II est à l'origine<br />
de la séparation en deux lots portant les numéros 544 et 545, lors de la formation <strong>du</strong> cadastre vers 1875.<br />
Ce qui s'est passé sur l'île entre 1790 et 1850 demeure un mystère. Aucune documentation attestant<br />
la présence humaine n'a été retrouvée pour cette période. On peut seulement supposer que les braconniers<br />
et les pique-niqueurs s'en sont donné à cœur joie.<br />
Puis Louis-Jacques Lepage, petit-fils de Pierre Lepage de Saint-Barnabé II et de Véronique<br />
Hedwidge Rioux, vint reprendre de façon permanente le site défriché par l'ermite. Ce descendant des<br />
seigneurs Lepage a vécu sur l'île à partir des années 1850, d'après son petit-fils, Théodore Lepage. Celui-<br />
52