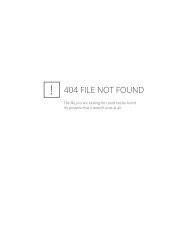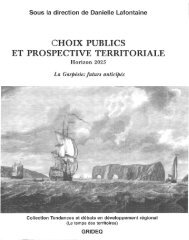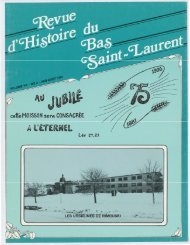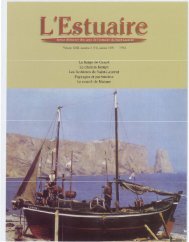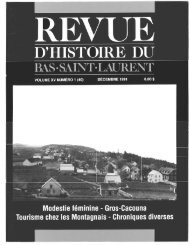Télécharger (13Mb) - Université du Québec à Rimouski
Télécharger (13Mb) - Université du Québec à Rimouski
Télécharger (13Mb) - Université du Québec à Rimouski
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
- Carte de la seigneurie de <strong>Rimouski</strong>, sans date et sans nom d'auteur, vers 1840, déposée à la Direction de<br />
l'information foncière sur le territoire public, (DIFTP), ministère des Ressources naturelles, 5700, 4 e avenue Ouest,<br />
Charlesbourg. Complète la carte de Ballantyne en donnant les mesures des terrains des propriétaires de <strong>Rimouski</strong>,<br />
vers 1840. Probablement par Ballantyne lui-même; les numéros des lots sont identiques à ceux de la carte de 1840,<br />
par cet arpenteur.<br />
- Plan officiel de la ville de Saint-Germain de <strong>Rimouski</strong>. DIFTP, 30 juin 1877. Plan <strong>du</strong> cadastre de <strong>Rimouski</strong>. Le<br />
découpage des lots d'origine y est parfaitement visible.<br />
- Plan officiel de la révision cadastrale de la ville de Saint-Germain de <strong>Rimouski</strong>, 30 janvier 1948. Permet<br />
d'identifier les noms des rues tracées sur les limites des lots d'origine. Cette dernière carte nous amène à repérer<br />
l'avenue Blais sur la ligne de séparation entre l'arrière-fief de Paul Lepage et la terre de Pierre Laurent.<br />
En ayant comme point de repère la ligne de séparation entre la terre de Nicolas Lepage de la Faussaie et la<br />
terre de l'église, il est facile de placer les trois arpents donnés à la fabrique, en 1742, par le seigneur Pierre Lepage.<br />
C'est cette ligne de séparation entre la terre de l'église et la terre de Nicolas Lepage qui deviendra l'avenue de la<br />
Cathédrale. À la suite des trois arpents de la terre de l'église jusqu'à l'embouchure <strong>du</strong> ruisseau Boucher, on retrouve<br />
les vingt arpents déclarés par le seigneur Pierre Lepage dans l'aveu et dénombrement de 1724 et qui lui avaient été<br />
concédés par René Lepage, son père. Dans une concession datée de 1711, le seigneur René Lepage nous apprend<br />
que le lot de son fils Pierre doit s'étendre jusqu'au domaine (et non jusqu'au lot de Germain Lepage de saint<br />
François)8.<br />
Nous avons vu qu'en 1733, l'arrière-fief de Nicolas Lepage était borné à l'ouest par le domaine. En 1742, ce<br />
même arrière-fief avait pour borne à l'ouest la terre de l'église. Que s'était-il passé entre-temps?<br />
Entre 1733 et 1742, certains des membres de la famille Lepage avaient fait des donations à la fabrique. Sans<br />
qu'il ne soit fait mention nulle part de la construction d'un bâtiment d'église, les documents de l'époque nous<br />
apprennent que Nicolas avait donné six cents livres devant servir à l'achat d'une cloche, de vases sacrés d'argent,<br />
d'un missel et d'un tableau de Saint-Germain. Quant au seigneur Pierre Lepage, il avait fait donation d'un calice et<br />
d'une patène en argent, et des ornements d'église nécessaires pour célébrer le sacrifice de la messe. Le seigneur<br />
faisait aussi donation, en 1742, d'un terrain de trois arpents de front où l'église et le presbytère étaient bâtis. En<br />
1792, le seigneur Drapeau ajoutait un arpent à la donation d'origine. Les quatre arpents de front qui appartiennent à<br />
la fabrique depuis ce temps-là sont facilement repérables sur la carte <strong>du</strong> cadastre de 1877.<br />
Pendant la décennie de 1730, le seigneur se préparait à déménager pour aller occuper sa maison au bord de<br />
la rivière, qui devenait par le fait même le nouveau manoir seigneurial. La mère, Marie-Madeleine Gagnon,<br />
demeurait encore avec la famille de son fils. En 1735, elle faisait son testament S.S.p .. devant le père Ambroise<br />
Rouillard. Cette dame donnait ses meubles au seigneur, son fils. Elle donnait aussi ses animaux, ce qui nous amène à<br />
penser que le domaine n'allait plus servir comme établissement agricole 9 •<br />
L'aveu et dénombrement de 1724 nous a appris que: «[Sur le domaine], il y a une maison moitié colombage<br />
et moitié pièces sur, pièces de cinq.te deux pieds de long sur vingt deux de large [00 .]». Depuis l'arrivée de René<br />
Lepage à <strong>Rimouski</strong>, la partie de cette construction en pièce sur pièce aurait servi d'habitation à la famille. Puis, vers<br />
1712, on aurait ajouté la partie de colombage pour servir de chapelle. Cet ajout aurait été fait à l'instigation de<br />
Germain Lepage, aîné. Les dimensions de tout ce bâtiment étaient plutôt imposantes (23' 1/2 par 55', mesures<br />
anglaises), si on les compare à celles des petites maisons de colonisation de cette époque.<br />
Quant au site de ce bâtiment, peut-on le voir ailleurs que sur le terrain donné par le seigneur à l'Église en<br />
1742? Sur les seize arpents qui vont de l'avenue de la Cathédrale à l'avenue Blais, c'est-à-dire sur les arrière-fiefs<br />
de Nicolas et de Paul Lepage, nous avons vu qu'en 1733, il n'y avait encore que des «circonstances et<br />
dépendances». On ne peut donc chercher l'ancien manoir sur cet espace lO • Puisque les deux arrière-fiefs en question<br />
sont des subdivisions <strong>du</strong> premier domaine, les dépendances seraient-elles l'étable, la grange et l'écurie déclarées par<br />
le seigneur à l'aveu et dénombrement de l724?<br />
On a objecté que l'ancien manoir n'avait pu servir d'église ou de chapelle parce qu'on y a inhumé les corps<br />
de certains membres de la famille seigneuriaie ll . Si certains faits nous paraissent aujourd'hui inconcevables, il faut<br />
se reporter à cette époque-là. Qu'on se rappelle l'image terrifiante des morts que l'on a jetés derrière l'église pendant<br />
l'épidémie de 1758. Au printemps suivant, ils étaient encore là. Il a fallu les paroles de reproches de la seigneuresse<br />
pour que les militaires français se résignent à enterrer leurs morts 12 • Puis que penser de l'attitude de Germain Lepage<br />
aîné, lorsqu'il rédigeait son testament en 1713? L'aïeul demandait alors à ses proches de laisser son corps dans la<br />
chapelle jusqu'à ce que Dieu vienne l'enterrer 13 • Nous supposons que la famille n'a pas exécuté la demande <strong>du</strong><br />
81