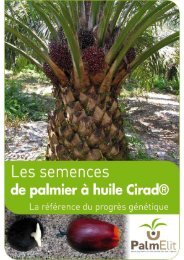Le Cirad en 2007
Le Cirad en 2007
Le Cirad en 2007
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
10 > <strong>Le</strong> <strong>Cirad</strong> <strong>en</strong> <strong>2007</strong><br />
Un nouveau modèle pour<br />
expliquer le photopériodisme<br />
des sorghos africains<br />
Explorer et exploiter<br />
la biodiversité<br />
La s<strong>en</strong>sibilité à la photopériode est une adaptation ess<strong>en</strong>tielle des espèces annuelles<br />
cultivées dans les régions tropicales. C’est un mécanisme d’ajustem<strong>en</strong>t de leur cycle aux<br />
contraintes climatiques, principalem<strong>en</strong>t pluviométriques. Il permet d’échapper, grâce à<br />
une date de floraison adaptée et indép<strong>en</strong>dante de la date de semis, aux stress hydriques<br />
<strong>en</strong> fin de cycle et aux contraintes biotiques. Un nouveau modèle pour r<strong>en</strong>dre compte de<br />
ce mécanisme vi<strong>en</strong>t d’être proposé dans le cadre d’une thèse réalisée au <strong>Cirad</strong>.<br />
La complexité de la réaction<br />
photopériodique du sorgho a fait l’objet de<br />
nombreuses études, mais aucune n’a pu aboutir<br />
à un modèle unique qui expliquerait la plasticité<br />
et la diversité de la phénologie de cette espèce.<br />
Une nouvelle étude, réalisée au <strong>Cirad</strong>, propose un<br />
modèle innovant, appelé Impati<strong>en</strong>ce, qui repose<br />
sur un concept emprunté aux sci<strong>en</strong>ces du comportem<strong>en</strong>t<br />
animal : dans le cas d’une att<strong>en</strong>te<br />
prolongée du « bon » signal <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>tal,<br />
la plante abaisse progressivem<strong>en</strong>t son exig<strong>en</strong>ce<br />
par rapport à la durée du jour qui décl<strong>en</strong>che sa<br />
floraison. Ce modèle, très simple, a été validé avec<br />
succès pour toute une gamme de génotypes.<br />
Deux applications pratiques <strong>en</strong> sont issues, l’une<br />
pour les recherches <strong>en</strong> génétique, l’autre dans le<br />
cadre agronomique et écologique. Pour la génétique,<br />
une méthode de phénotypage des plantes<br />
a été développée à l’aide du modèle. Elle permet<br />
de paramétrer la s<strong>en</strong>sibilité variétale à la photopériode<br />
des génotypes. Ce mode de caractérisation<br />
du matériel se prête aux études de génétique<br />
moléculaire, par QTL (quantitative trait loci) ou<br />
par cartographie d’association à l’aide de marqueurs,<br />
et donc à la sélection de génotypes adaptés<br />
à un <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t climatique spécifique.<br />
Pour une utilisation agroécologique, le modèle<br />
Impati<strong>en</strong>ce a été incorporé au modèle de simulation<br />
de croissance SarraH. L’outil résultant permet<br />
d’id<strong>en</strong>tifier les zones où l’adaptation des variétés<br />
est optimale, <strong>en</strong> se fondant sur l’adéquation de<br />
leur réponse photopériodique aux caractéristiques<br />
de durée de la saison des pluies <strong>en</strong> Afrique de<br />
l’Ouest. Il permet égalem<strong>en</strong>t d’analyser la flexibilité<br />
des cal<strong>en</strong>driers culturaux <strong>en</strong> fonction du lieu<br />
et du génotype et de déterminer le pot<strong>en</strong>tiel de<br />
production et ses variations interannuelles.<br />
Deux études complém<strong>en</strong>taires vi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t étayer<br />
ces recherches. La première vise à déterminer<br />
les caractéristiques de l’agrobiodiversité des<br />
sorghos africains <strong>en</strong> relation avec la typologie<br />
des contraintes <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>tales. La seconde<br />
analyse l’élaboration du r<strong>en</strong>dem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> fonction<br />
d’idéotypes privilégiés par la sélection. Il s’agit<br />
notamm<strong>en</strong>t de créer des variétés combinant un<br />
profil spécifique de réponse photopériodique et<br />
un indice de récolte amélioré pour une meilleure<br />
adaptation aux aléas climatiques et une meilleure<br />
production.<br />
En effet, <strong>en</strong> raison des particularités de leur rythme<br />
de développem<strong>en</strong>t et de croissance, les sorghos<br />
photopériodiques, traditionnellem<strong>en</strong>t de grande<br />
taille, prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t une panicule de taille limitée,<br />
qui <strong>en</strong>traîne un faible indice de récolte et limite<br />
le r<strong>en</strong>dem<strong>en</strong>t. En comparant des matériels différ<strong>en</strong>ts<br />
mais appar<strong>en</strong>tés, on a pu déterminer que le<br />
photopériodisme associé à une réduction de taille<br />
et à la sénesc<strong>en</strong>ce tardive des feuilles conduit à<br />
une meilleure répartition des assimilats, d’où un<br />
indice de récolte amélioré et des r<strong>en</strong>dem<strong>en</strong>ts<br />
s<strong>en</strong>siblem<strong>en</strong>t plus élevés et stables. <strong>Le</strong>s études se<br />
poursuiv<strong>en</strong>t pour valider sur une base plus large<br />
ces résultats. Si elles confirm<strong>en</strong>t ces premières<br />
données, il sera alors possible de jeter les bases


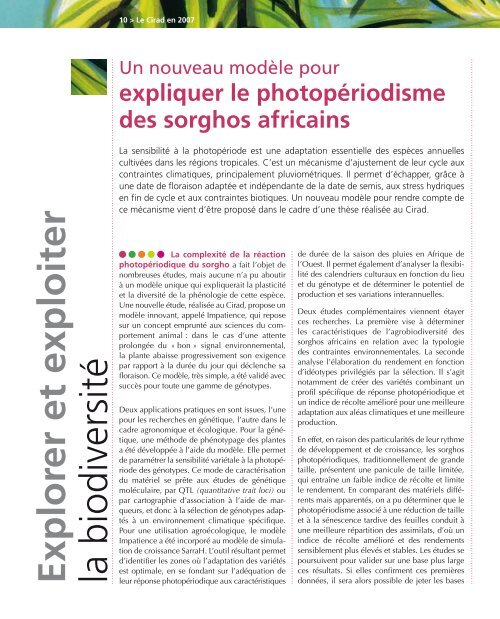
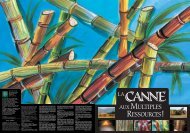

![Version française [pdf, 376,65 ko] - Cirad](https://img.yumpu.com/26838166/1/184x260/version-franaaise-pdf-37665-ko-cirad.jpg?quality=85)
![VIP N°4 [FR] - Cirad](https://img.yumpu.com/26838163/1/184x260/vip-na4-fr-cirad.jpg?quality=85)
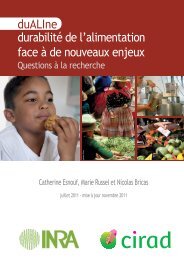

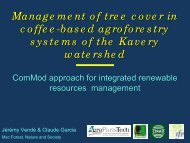



![VIP N.4 [ESP]--> PDF - Cirad](https://img.yumpu.com/26838123/1/184x260/vip-n4-esp-pdf-cirad.jpg?quality=85)
![Version française [pdf, 493,34 ko] - Cirad](https://img.yumpu.com/26838117/1/184x260/version-franaaise-pdf-49334-ko-cirad.jpg?quality=85)
![Version française [pdf, 180,31 ko] - Cirad](https://img.yumpu.com/26838111/1/184x260/version-franaaise-pdf-18031-ko-cirad.jpg?quality=85)