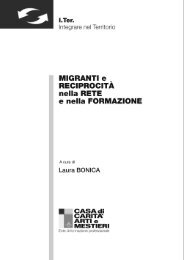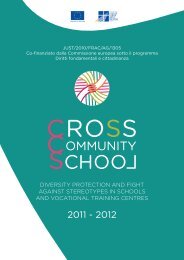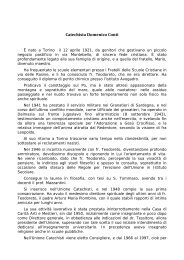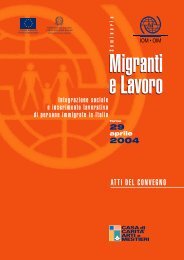Français
Français
Français
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Pour la communauté<br />
Reseau local<br />
Ecole/enseignants<br />
Employeur<br />
Bénévolat<br />
L e r é s e a u c o m m u n<br />
Communauté<br />
Ussm<br />
Services<br />
Territoriaux<br />
Psycologue<br />
Pour l’USSM<br />
Autorité judiciaire<br />
Médiateurs culturels<br />
Forces de l’ordre<br />
b) la famille, même étant un acteur toujours nommé dans les récits des cas, souvent n’est pas considérée un<br />
nœud actif du réseau. Au cour de la confrontation avec les opérateur, est émergé comme l’aspect de la<br />
relation avec la famille, bien étant “bien présent dans l’esprit de touts les opérateurs” comme l’objectif du travail et<br />
comme un aspect indispensable pour intervenir dans une optique de réparation, résulte vraiment problématique<br />
dans sa gestion opérationnelle ( comment peut-on faire pour travailler aussi sur et avec la famille?).<br />
Cette difficulté semble venir au moins de deux facteurs, qui portent avec soi des ambivalences de fond<br />
- il n’est pas toujours clair et il n’y a pas toujours un mandat pour travailler sur la famille (“nous sommes du pénale,<br />
nous ne sommes pas des assistantes sociales territoriales, il est difficile comprendre quel est le rôle que nous pouvons jouer”)<br />
- l’intervention de communauté est une intervention d’éloignement de la famille, de certaines modèles et<br />
relations, comment travailler donc sur la double voie éloignement d’une part et recomposition de l’autre?<br />
Un premier élément constructif relevé par la confrontation est qu’on ne peut pas mettre de cote la famille<br />
et les liens familiaux, même quand elle parait absente, et qu’une des voies possible est celle de expliciter<br />
davantage, dans les hypothèses d’intervention sur le cas, ce qu’on demande à la famille et ce qu’on veut<br />
obtenir.<br />
c. l’image de réseau qui remonte à la surface est celle d’un réseau assez “formel”: en outre de la famille d’autres<br />
nœuds informels ne viennent pas à la surface, nœuds liés au contexte de provenance du mineur, et les<br />
nœuds non institutionnels semblent de toute façon moins significatifs.<br />
A la lumière de ce qu’on a dit au point précédent, par rapport à l’importance de ne pas exclure les liens<br />
précédents du mineur, les opérateurs partagent l’importance de trouver le moyen de reconnaître et valoriser<br />
les acteurs du réseau personnel du mineur, qui peuvent devenir des ressources positives pour soutenir un<br />
procès de nouvelle élaboration du délit, que les services peuvent activer et inclure dans le parcours relatif au<br />
project. Quelques-un des interrogatifs posés par le groupe de formation ont mis en pleine lumière combien<br />
il est difficile, au contraire, cueillir et développer ce type de liens, combien peu on peut les repérer et surtout<br />
combien peu on il vient utilisés ensuite comme des “leviers” dans le projeter l’intervention éducative.<br />
d. un réseau fonctionne le mieux, aux yeux des opérateurs, là où il y a des rapports personnels précédents<br />
entre les opérateurs. D’une part cet aspect est absolument compréhensible en tant que relation solide qui<br />
permet de pouvoir compter sur une communication plus aisée et sur des modalités opérationnelle connues<br />
et partagées.<br />
Toutefois, surtout à la lumière de ce qui est émergé aux points a. et c., cet aspect fait entrevoir un certain<br />
risque de fermeture et de fossilisation, c’est-à-dire l’activation d’un réseau statique, qui a de la peine à<br />
expérimenter de nouvelles connexions.<br />
e. Finalement l’analyse des fiches a mis en évidence comment les éléments critiques du réseau ont souvent<br />
affaire à une insuffisante définition des rôles et des fonctions entre les acteurs et à l’apparition d’espaces de<br />
champs de recouvrement qui engendrent de l’ambiguïté.<br />
Les éléments de bon fonctionnements et dysfonctionnement du parcours de communauté et dans sa gestion.<br />
Les éléments émergés ci-dessous résument, dans les expériences racontés, les principaux aspects qui ont été<br />
identifiés comme de leviers positifs pour une intervention efficace ou bien, au contraire, contrariants et critiques.<br />
Comme on peut déduire des deux tableaux, il y a des élément spéculaires: facteurs de bon fonctionnement où présents<br />
et de dysfonctionnement où absents.<br />
Entre ceux-ci, il y a la relation entre services, où l’on relève comme élément critique la relation personnelle<br />
entre opérateurs liée surtout à une déclinaison peu claire et confuse des rôles et des fonctions: “chevauchement des rôles<br />
entre éducateurs de la communauté et éducateurs de l’IPM”; “présence jugeante de l’opérateur du CGM...”; “confusion des rôles entre<br />
assistante sociale et psychologue”...<br />
a. De cette façon même l’aspect de l’implication de la famille réapparaît dans sa double valence: fonctionnelle<br />
où elle coopère, disfonctionnel quant on n’arrive pas à l’accrocher à l’intérieur du parcours relatif au projet<br />
sur le mineur.<br />
79