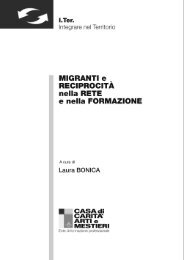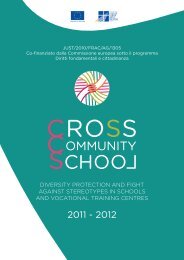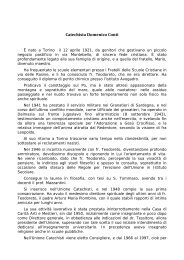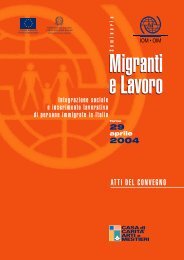Français
Français
Français
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
2.2. La recherche <strong>Français</strong>e<br />
Le travail fait en France a voulu réaliser un recueil de pratiques des professionnels accompagnant des « jeunes<br />
mineurs en prise avec la justice ». La recherche a été effectuée par Mlle Noémie DURR, psychosociologue, pour le<br />
compte de l’Association “Ecole et Famille – Centre de proximité et ressources” qui travaille sur un département de<br />
la région parisienne. Le but de l’Association est de relier les liens entre l’école e la famille, de valider et activer des<br />
pratiques thérapeutiques de réseau, en utilisant en particulier l’outil de la Clinique de Concertation. Il s’agit d’une<br />
association qui gère des fonds publics, provenant de différentes institutions. L’Association est organisée en pôles<br />
différents, parmi lesquels le “Pôle recherche” a été chargé du travail du projet Part.A.G.E.R.<br />
2 . 2 . 1 . P r é a m b u l e<br />
Les professionnels concernés dans la recherche ont été choisis parmi ceux qui travaillent ou ont travaillé<br />
avec des « jeunes en prise avec la justice », à savoir des professionnels exerçant des AEMO (Action Educative en Milieu<br />
Ouvert) judiciaires ou administratives, des professionnels de la prévention spécialisée, et aussi des professionnels du<br />
S.E.S.S.A.D. (Service d’Education Spécialisée et de Soin A Domicile) qui est un organisme français qui accompagne des<br />
jeunes sur leur temps scolaire et effectue avec eux un accompagnement éducatif et psychologique.<br />
La recherche s’est effectuée pour une première partie à Lille, dans le nord de la France, à l’occasion des<br />
rencontres nationales des acteurs de l’action éducative en milieu ouvert, par des entretiens plutôt spontanés.<br />
La deuxième partie à Paris avec des entretiens plus structurés, un temps pris plus importants, parce que<br />
les intervenants dans certaines occasions ont proposé à la chercheuse de visiter les contextes dans lesquels ils travaillent,<br />
avec une implication majeure.<br />
2 . 2 . 2 . L e d e s s i n d e l a r e c h e r c h e<br />
La recherche a été réalisée à travers 24 entretiens semi directifs. Pour chaque entretien, on a demandé au<br />
professionnel de dérouler une situation précise et concrète d’un travail auprès d’un « jeune mineur ayant été en prise<br />
avec la justice »; une situation ayant activé un certain nombre de professionnels et leur tenant à cœur. La chercheuse<br />
considère important de ne pas influencer le discours en posant des questions trop précises, posant son attention<br />
sur les situations « telles qu’elles lui étaient contées ». D’où le choix de travailler à partir d’entretiens semi-directifs,<br />
demandant que certaines thématiques fussent abordées :<br />
• la présentation de la structure, de l’équipe, du type de travail effectué ;<br />
• le déroulé aussi précis que possible d’une situation : le parcours d’un jeune dans un réseau et le parcours du<br />
professionnel chargé de la mesure de protection, d’accompagnement, d’action éducative en milieu ouvert ;<br />
• la demande de donner un retour aux personnes concernées dont il est question dans l’exposé<br />
• la recherche des ressources sur lesquelles ce professionnel en particulier s’est appuyé ou qu’il a mises en<br />
route lui-même.<br />
Pendant l’entretien l’interviewer a représenté le récit du professionnel en utilisant l’outil du sociogénogramme<br />
13 , et il est parfois arrivé à la fin de l’interview de partager ses sentiments avec le professionnel et de relever ce qui<br />
émergeait du sociogénogramme sur les interactions entre les institutions. Dans telles situations il est souvent arrivé<br />
que l’intervenant interviewé s’apercevait de n’avoir pas mentionné dans le récit des activations de professionnels ou<br />
d’institutions, ou bien des relais entre les institutions qui s’étaient de toute façon passés, et qu’il demandé d’ajouter<br />
des flèches. Ce fait témoigne comment l’outils du sociognogramme nous aide à représenter la complexité des situations<br />
et des interventions et nous aide à retrouver les fils du réseau.<br />
Les situations choisies ont, en général, mobilisé beaucoup d’énergie, une implication émotive des professionnels,<br />
ont pu parfois être douloureuses ou au contraire encourageantes.<br />
2 . 2 . 3 . R é s u l t a t s<br />
Un premier point qui émerge de l’analyse des interviews concerne le vécu très différent entre les professionnels<br />
exerçant dans de grandes institutions avec des professionnels appartenant à des équipes plus petites et<br />
travaillant dans des structures de proximité, c’est à dire plus proches des usagers. Les premiers disent se sentir<br />
« coincés », enfermés, dans des circuits de travail « pré établis », dans des parcours quasi obligatoires avec le jeune « à<br />
suivre » sans la possibilité d’une attention particulière aux détails de ce parcours d’aide et de contrôle .<br />
Ils parlent même « d’un parcours du combattant » tant ils doivent procurer des efforts pour respecter ce parcours<br />
protocolaire : courrier, rendez vous chez le juge, chez l’inspecteur pour l’aide à l’enfance, accompagnements chez<br />
le thérapuete, chez le psychiatre, rapports aux juges.<br />
13 Voir description à page 74<br />
91